mardi, 17 février, 2026
Par Aude le mardi, 17 février, 2026, 11h56 - Lectures
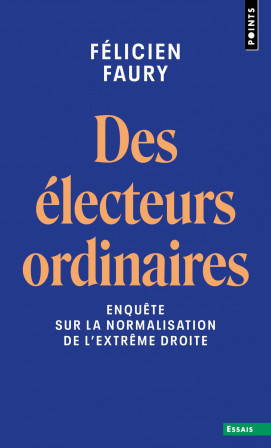 Félicien Faury, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite (2024), Points, 2026, 244 pages, 10,20 €
Félicien Faury, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite (2024), Points, 2026, 244 pages, 10,20 €
Pendant plusieurs années, le sociologue et politiste Félicien Faury a vécu de manière intermittente en Provence-Alpes-Côte d’Azur (désormais Sud), une région toujours gouvernée à droite mais où le FN puis le RN fait florès depuis quelques dizaines d’années. Il livre ici, suite à sa thèse, une enquête qualitative sur les électeurs et électrices RN de la région, plus précisément d’une petite ville anonyme où il a multiplié les rencontres et les entretiens. C’est l’occasion d’entendre les électeurs et électrices RN dans leurs propres mots.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 13 février, 2026
Par Aude le vendredi, 13 février, 2026, 19h08 - Textes
Beaucoup a été dit sur la sortie d’Emmanuel Macron à propos des jeux vidéos et de leurs effets sur les plus jeunes. Représentant l’auto-proclamé « camp de la raison », il souhaite s’appuyer sur des études scientifiques qui permettront de mesurer les dimensions du problème et de suggérer des pistes d’action. Et en même temps, il fait son Robert du Café du Commerce en pestant sur les jeux vidéo qui rendent les jeunes violents, tout le monde sait ça, ma bonne dame. L’exercice n’est pas si incohérent car dans la mise en scène de son recours à la science il n’y a déjà que de la crasse démagogique. Il annonce des résultats de recherche pour dans quatre mois (c’est un fin connaisseur du rythme lent de la science) et a déjà établi tout seul les prémisses de la démarche scientifique.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 11 février, 2026
Par Aude le mercredi, 11 février, 2026, 17h59 - Lectures
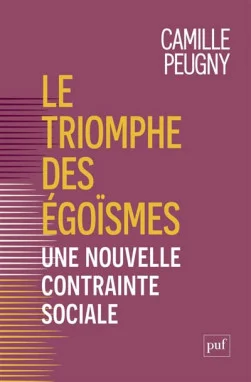 Camille Peugny, Le Triomphe des égoïsmes. Une nouvelle contrainte sociale, PUF, 2026, 240 pages, 18 €
Camille Peugny, Le Triomphe des égoïsmes. Une nouvelle contrainte sociale, PUF, 2026, 240 pages, 18 €
Le Triomphe des égoïsmes a été souvent présenté comme une réponse au livre de Vincent Tiberj, La Droitisation française, paru fin 2024 chez le même éditeur. Tiberj, qui est politiste, avait tiré de l’analyse d’enquêtes sur les valeurs, répliquées à intervalles réguliers sur des décennies, que les Français·es étaient de plus en plus ouvert·es et tolérant·es sur les questions sociétales (Islam, place des femmes, (homo)sexualité, etc.) mais maintenaient aussi des demandes de redistribution économique, ce qui est déjà beaucoup quand on considère l’envahissement de l’espace public par les opinions droitières. Peugny, qui remercie à la fin de son ouvrage Tiberj pour ses encouragements, remet en question ces conclusions en faisant valoir d’autres observations, plus sociologiques. Selon le sociologue, l’égoïsme est une « nouvelle contrainte sociale » qui tient au remplacement de la lutte des classes par la lutte des places. Et cela reconfigure en profondeur le paysage politique.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 2 février, 2026
Par Aude le lundi, 2 février, 2026, 17h55 - Lectures
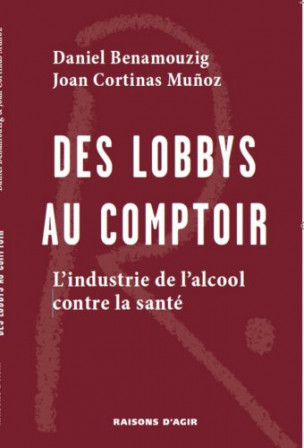 Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au comptoir. L’Industrie de l'alcool contre la santé, Raisons d'agir, 2025, 170 pages, 14 €
Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au comptoir. L’Industrie de l'alcool contre la santé, Raisons d'agir, 2025, 170 pages, 14 €
Déjà auteurs d’un livre passionnant sur les lobbys de l’agro-alimentaire, Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz reviennent avec une étude des lobbys de l’alcool contre les politiques de santé publique. À votre santé ! L’alcool en France, c’est d’abord le vin qui représente 60 000 emplois. C’est le lobby qui bénéficie des meilleurs relais politiques en raison des nombreuses régions de production viticole. La bière est surtout présente dans le Nord et l’Est et emploie dix fois moins de personnes. Le cidre, les spiritueux sont moins bien implantés. Tous ces secteurs sont très concentrés économiquement, même le secteur viti-vinicole, ce qui permet l’organisation de groupes de pression très bien dotés, qui ont été actifs à de nombreuses occasions ces dernières années : détricotage de la loi Évin sur la publicité en 2015, tentative de faire entrer la consommation d’alcool dans les stades en 2019, limitation de la taille du pictogramme « femmes enceintes » sur les bouteilles en 2018-2021 ou refus de soutien à l’initiative du Défi de janvier en 2019-2020, pour les principales occasions de dévoiler leur travail d’influence, souvent couronné de succès.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 31 janvier, 2026
Par Aude le samedi, 31 janvier, 2026, 12h52 - Textes
J’avoue que devant les énormités que sortent à tout bout de champ les fascistes (1) et qui sont relayées complaisamment par la société du spectacle (plus c’est gros, plus c’est de l’info), rire apporte un peu de baume au cœur. Rire avec Stephen Colbert de la déliquescence cognitive de Donald Trump et de son comportement de gosse de 6 ans particulièrement inculte et rancunier, rire avec Guillaume Meurice de l’hypocrisie de Pascal Praud en gardien de la neutralité entre différentes tendances de l’extrême droite, c’est déjà ça de pris. Je ne m’en prive pas mais ça m’interroge. Non pas car rire serait inapproprié devant la brutalité de l’extrême droite et la menace qu’elle représente pour le vernis de démocratie et de droits humains des régimes libéraux. Ces rires-là témoignent d’une colère sourde, ce ne sont pas (comme souvent l’humour français dominant) de simples prétextes à rigolade qui banalisent le naufrage de nos sociétés dans pire encore.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 14 janvier, 2026
Par Aude le mercredi, 14 janvier, 2026, 08h57 - Lectures
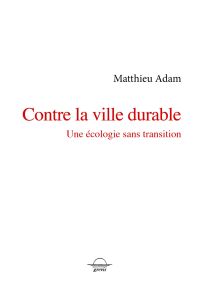 Matthieu Adam, Contre la ville durable. Une écologie sans transition, Grevis, 2025, 140 pages, 13 €
Matthieu Adam, Contre la ville durable. Une écologie sans transition, Grevis, 2025, 140 pages, 13 €
Le géographe Matthieu Adam est déjà connu du public pour sa direction avec Émeline Comby du recueil Le Capital dans la cité (Amsterdam, 2020). Contre la ville durable est une autre contribution sur ce que le capital fait à la ville, cette fois sous des oripeaux verts. L’auteur ne dénonce pas un greenwashing éhonté ni ne remet en cause la durabilité des réalisations techniques. Les techniques de construction sont moins émettrices, les bâtiments consomment moins d’énergie, Adam le reconnaît mais il interroge les conditions de production de la vie durable, soit les constructions et les écoquartiers dûment labellisées. Revenant aux sources de l’élaboration de l’écologie aujourd’hui dominante, il montre avec Romain Felli (Les Deux Âmes de l’écologie, L’Harmattan, 2008) que la « durabilité » est partout « après avoir escamoté les principes fondateurs du développement durable », un compromis par ailleurs discutable mais qui inclut les dimensions sociale et démocratique dans ses trois piliers.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 3 janvier, 2026
Par Aude le samedi, 3 janvier, 2026, 12h23 - Textes
Une fois n’est pas coutume, je republie ce texte déjà paru en janvier 2025 car le sujet me semble important : entre la surestimation de la liberté individuelle et le refus de régulations collectives, les politiques de l’alcool sont emblématiques du fonctionnement des sociétés libérales. Si le Défi de janvier (Dry January) est l’occasion de faire le point sur un rapport personnel à l’alcool, il pourrait aussi donner lieu à une réflexion collective sur le sujet.
En France il est interdit de servir de l’alcool à des gens « manifestement ivres » (1). Des personnes qui ont leur compte et n’ont plus besoin d’un peu d’alcool pour lubrifier la vie sociale et faire tomber quelques inhibitions, des personnes qui ne sont plus en mesure d’apprécier un bon verre, des personnes qui n’auront plus que des désavantages à poursuivre leur consommation ce soir-là et auraient plutôt besoin de grands verres d’eau. Des personnes qui vont rentrer chez elles à leurs risques et périls dont les moindres sont de tomber par terre et de se faire mal, de perdre ou de se faire voler des biens précieux, qui le lendemain vont avoir des symptômes pénibles.
En France on aime l’alcool, avec modération bien sûr, et une fois ceci écrit sur les publicités (car la pub pour l’alcool est revenue discrètement) on laisse à chacun·e la responsabilité de sa consommation, serait-elle débridée et désinhibée par les premiers verres, serait-elle difficile à contrôler en raison d’une addiction. Pourtant on a les moyens de ne pas laisser chacun·e seul·e avec ses difficultés mais, même si l’intérêt du plus grand nombre y gagne, l’intérêt immédiat est bien de faire consommer, tant pour les bars que pour les producteurs d’alcool représentés par des groupes de pression puissants.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 16 décembre, 2025
Par Aude le mardi, 16 décembre, 2025, 08h02 - Textes
 Dans le billet précédent, nous avons vu que l’autodétermination de la « race » est un terrain de luttes et que les prétentions à se déclarer membre d’une minorité ethnique font l’objet de fortes critiques chaque fois qu’elles sont remises en cause par les communautés concernées. L’autodétermination du genre, en revanche, est un principe qui est largement reconnu en Europe occidentale, dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine. Le backlash initié par l’administration Trump représente un drame pour les personnes trans, assignées de nouveau à leur sexe de naissance, en les privant de papiers (donc potentiellement d’accès au soins, de mobilité, etc.). Cela semble devoir commander un soutien inconditionnel à ce principe. Il me semble pourtant douteux de soumettre à l’autodétermination une procédure de changement de genre.
Dans le billet précédent, nous avons vu que l’autodétermination de la « race » est un terrain de luttes et que les prétentions à se déclarer membre d’une minorité ethnique font l’objet de fortes critiques chaque fois qu’elles sont remises en cause par les communautés concernées. L’autodétermination du genre, en revanche, est un principe qui est largement reconnu en Europe occidentale, dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine. Le backlash initié par l’administration Trump représente un drame pour les personnes trans, assignées de nouveau à leur sexe de naissance, en les privant de papiers (donc potentiellement d’accès au soins, de mobilité, etc.). Cela semble devoir commander un soutien inconditionnel à ce principe. Il me semble pourtant douteux de soumettre à l’autodétermination une procédure de changement de genre.
Lire la suite...
aucun rétrolien
Par Aude le mardi, 16 décembre, 2025, 07h49 - Textes
 Par « race » j’entends ici ce qui fonde le racisme et les logiques de discrimination, domination et exploitation au motif de l’origine attestée ou supposée des personnes. Il ne s’agit pas de valider la « race » comme une notion biologique, de même que dans le billet suivant il n’est pas question du sexe mais du genre, ou rapports sociaux fondés sur le sexe.
Par « race » j’entends ici ce qui fonde le racisme et les logiques de discrimination, domination et exploitation au motif de l’origine attestée ou supposée des personnes. Il ne s’agit pas de valider la « race » comme une notion biologique, de même que dans le billet suivant il n’est pas question du sexe mais du genre, ou rapports sociaux fondés sur le sexe.
Au Canada, depuis un arrêté qui a reconnu en 2003 des droits de chasse et de pêche aux Métis (avec une majuscule), le nombre de personnes blanches réclamant la reconnaissance de leur identité métis se chiffre en centaines de milliers. L’arrêté pose comme condition de la reconnaissance des droits l’appartenance à des communautés reconnues, comme le sont les communautés métis depuis 1982. C’est évidemment car ils et elles étaient métissées et francophones que les Métis s’appellent ainsi mais ce nom d’origine française signifie bien plus que cette origine. Dans l’Ouest canadien, les descendant·es de femmes autochtones et de trappeurs français forment depuis plus de deux siècles une communauté politique, un temps incarnée par la figure de Louis Riel qui réunit Métis et autochtones dans une lutte armée contre le colon britannique. Aujourd’hui des personnes blanches, surtout dans l’Est canadien, réclament cette identité au motif d’une ancêtre autochtone du XVIIe siècle dans une ascendance par ailleurs blanche. Ce faisant, elles biologisent l’ethnicité en confondant le fait d’être métissé·e et celui d’appartenir à une communauté qui en français comme en anglais se nomme métis.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 4 décembre, 2025
Par Aude le jeudi, 4 décembre, 2025, 07h52 - Textes
Ce mois-ci, celles et ceux qui en ont les moyens sont incité·es à soutenir des associations qui leur tiennent à cœur, associations militantes ou bien chargées de missions de service public mal financées par l’État. Et c’est un petit plaisir de savoir que c’est ça de moins que l’État n’aura pas pour financer sa prochaine guerre ou la nouvelle vaisselle de l’Élysée. Sauf que cette disposition n’est pas utilisée que par des ménages altruistes, c’est aussi une des stratégies de contournement de l’impôt des grandes entreprises.
Quand chacun·e donne de son côté, ce sont les causes les plus consensuelles qui sont privilégiées, aux dépens de celles plus difficiles, moins concrètes, plus lointaines. Lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, tout le monde s’était précipité pour donner. Lors de méga-feux en Amazonie brésilienne quelques semaines plus tard, une levée de fonds avait été tentée qui avait obtenu beaucoup moins de succès. Les actes dispersés et sous le coup de l’émotion ne rendent pas compte des priorités que des personnes qui se concertent seraient capables de mettre entre une église et une richesse naturelle indispensable à la préservation de nos conditions de vie à court terme. Ensemble on peut réfléchir aux moyens à réunir. Tout·e seul·e on suit ses premiers mouvements. Et tout le monde arrose là où c’est déjà mouillé.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 1 décembre, 2025
Par Aude le lundi, 1 décembre, 2025, 08h54 - Lectures
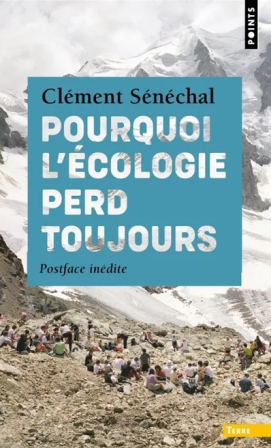 Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours, Points, 2025
Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours, Points, 2025
Clément Sénéchal a fait paraître l’an dernier au Seuil un pamphlet contre l’écologie bourgeoise et réformiste. Celui-ci sort maintenant en poche, doté d’une postface dans laquelle l’auteur revient sur la réception de son propos. Même si je partage nombre des constats que fait Sénéchal, ancien salarié de Greenpeace, son livre m’a aussi souvent agacée.
L’ouvrage commence sur le récit d’une résignation, une opération de désobéissance civile qui abandonne sa cible, une base militaire en Alaska, avant de l’atteindre car il y a des obstacles et car elle a déjà fait un peu parler d’elle. L’ONG que ce coup d’éclat inaugure, Greenpeace, qui entend comme son nom l’indique lier préoccupations environnementales et pacifisme (et même lutte contre le nucléaire civil ou militaire), sort de cette équipée avec deux orientations : faire une com qui ressemble à de l’action directe sans en avoir les objectifs et s’attaquer plutôt aux grandes causes environnementales susceptibles d’intéresser les donateurs.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 20 novembre, 2025
Par Aude le jeudi, 20 novembre, 2025, 20h20 - Textes
Il y a plus de deux siècles, le libéralisme triomphant promettait des droits à chacun. Les êtres humains (mâles) ne seraient plus sujets mais citoyens. Aujourd’hui les États libéraux n’ont plus à la bouche que les devoirs de leurs citoyens et citoyennes, à mesure qu’ils érodent leurs droits et en font... des sujets.
Le malaise se sent notamment dans le monde associatif. Nous avons depuis longtemps naturalisé le fait que l’État pouvait refuser des subventions aux opposants politiques du parti au pouvoir. Comme si en prenant le pouvoir un parti pouvait dévoyer l’État en le mettant tout à fait à son service. En Malaisie le parti au pouvoir entre 1956 et 2008 avait pris l’habitude de distribuer des aides aux particuliers dans ses propres locaux. Distribuer les aides CAF dans les locaux de LR choquerait quelque peu. Pour éviter toute dérive, les subventions au monde associatif (et aux entreprises d’ailleurs, qui reçoivent la plus grosse part des aides) doivent être attribuées selon des processus certes déterminés politiquement et qui peuvent évoluer au fil des alternances mais qui doivent être mis en œuvre de manière neutre (1). Et les seuls refus de principe doivent être réservés aux associations qui s’opposent par principe à l’État ou à l’État de droit, les anarchistes (qui n’en demandent pas) et celles d’extrême droite (qui ne devraient pas en recevoir car elles pratiquent une discrimination intenable en droit).
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 16 novembre, 2025
Par Aude le dimanche, 16 novembre, 2025, 12h15 - Textes
Avant d’entamer ce billet, je voudrais préciser un peu d’où je parle. J’ai été élevée dans le catholicisme, baptisée et catéchisée. Je ne suis pas croyante et je n’ai pas le souvenir de l’avoir jamais été. Dans la pension privée catholique et béarnaise maltraitante (non, une autre) où j’ai fait une part de mes études secondaires, j’ai ainsi un jour pris à partie le catéchiste en lui faisant valoir le manque de crédibilité de ses histoires. Il m’avait répondu que c’était « un récit donné pour une société donnée ». Je n’avais pas été plus convaincue que ça mais comme il n’y avait pas grand chose à lire je m’enfournais par ailleurs des vies de saint·es en me disant que ce serait cool comme parcours de vie (mes motivations étaient bien plus vaines que mystiques). Aujourd’hui, dans ma famille comme dans mes cercles amicaux, je côtoie de farouches laïcard·es comme des diplômé·es en théologie engagé·es à gauche. Bref, je connais un peu le christianisme sans y adhérer ni le combattre de manière indiscriminée et je déteste autant les intégrismes religieux que l’intégrisme anti-religieux. Je déteste encore plus ce christianisme militant qui se drape dans sa religion sans en respecter aucun principe.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 14 novembre, 2025
Par Aude le vendredi, 14 novembre, 2025, 18h01 - Lectures
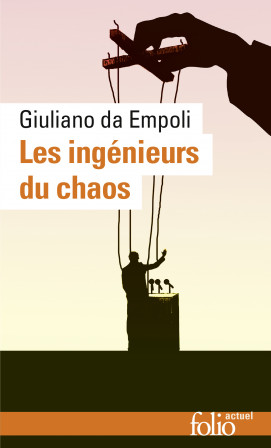 Giuliano da Empoli, Les Ingénieurs du chaos (2019), Folio, 2023, 240 pages, 8,50 €
Giuliano da Empoli, Les Ingénieurs du chaos (2019), Folio, 2023, 240 pages, 8,50 €
J’avoue une curiosité malsaine pour les histoires de conspirationnistes, d’agitateurs fascistes et de manipulations politiques sur Internet. Est-ce une basse vengeance de l’époque où des ravi·es de la crèche me gonflaient dans une revue techno-écolo en s’extasiant devant Facebook qui allait apporter la démocratie dans le monde ? Dès 2009 on avait vu cet outil de mobilisation, à l’époque relativement neutre, scanné par le régime théocratique iranien pour réprimer, profil par profil, une révolte. Dans le principe non plus ça ne marchait pas car savoir n’est pas mobiliser et mobiliser n’est pas gouverner. Bien que les faits m’aient donné amplement raison (« Je vous l’avais bien dit, que Mark Zuckerberg était un capitaliste et pas un fan de démocratie directe »), j’aurais à tout prendre préféré avoir tort, vu l’état actuel du monde.
En attendant, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt le dernier livre de Naomi Klein ou Toxic Data de David Chavalarias et dévoré le podcast The Gatekeepers de Jamie Bartlett. Mais c’est seulement maintenant que je me fade Les Ingénieurs du chaos, en retard d’un livre (mais au prix d’un poche).
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 6 novembre, 2025
Par Aude le jeudi, 6 novembre, 2025, 08h11 - Lectures
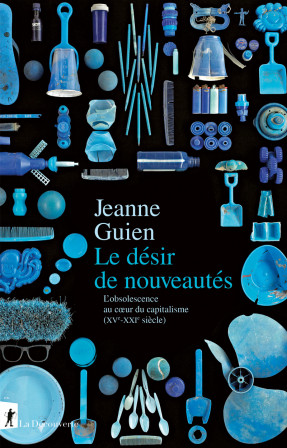 Jeanne Guien, Le Désir de nouveautés. L’Obsolescence au cœur du capitalisme (XVe-XXIe siècle), La Découverte, 2025, 352 pages, 23 €
Jeanne Guien, Le Désir de nouveautés. L’Obsolescence au cœur du capitalisme (XVe-XXIe siècle), La Découverte, 2025, 352 pages, 23 €
La philosophe Jeanne Guien, engagée dans des mouvements écologistes et critiques du consumérisme, prend de nouveau au sérieux, après Le Consumérisme à travers ses objets et Une histoire des produits menstruels (tous deux publiés aux éditions Divergence), l’histoire des objets. Cette fois elle analyse la néophilie, ou culte de la nouveauté, appliquée aux objets et qui justifie leur production à grands coûts écologiques et humains. L’ouvrage est composé de cinq chapitres : le premier sur la circulation et la production de marchandises coloniales, le deuxième sur l’innovation technique, le troisième sur la mode vestimentaire, le quatrième sur l’invention du consumérisme et le dernier enfin sur les produits jetables. Dans chacun d’eux, la philosophe se fait historienne pour tenter de comprendre comment la nouveauté s’est imposée au monde. Je retiens de ces chapitres thématiques plusieurs idées.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 20 octobre, 2025
Par Aude le lundi, 20 octobre, 2025, 09h34 - Lectures
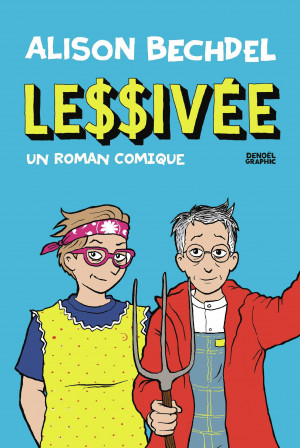 Alison Bechdel, Le$$ivée. Un roman comique, traduit de l’anglais (États-Unis) par Lili Sztajn, Denoël Graphic, 272 pages, 28 €
Alison Bechdel, Le$$ivée. Un roman comique, traduit de l’anglais (États-Unis) par Lili Sztajn, Denoël Graphic, 272 pages, 28 €
C’est dans les années 1990 que j’ai découvert Alison Bechdel et ses lesbiennes à suivre (dykes to watch out for) à la bibliothèque municipale, dans des petits recueils à l’italienne qui reprenaient ses strips pour des magazines états-uniens alternatifs. Depuis, Bechdel a connu le succès avec Fun Home, une autobiographie sur son enfance qui fait la part belle à son père, prof de lettres et entrepreneur de pompes funèbres (le funeral home du titre). Elle a enchaîné avec C’est toi ma maman ? qui explore cette fois la relation avec sa mère puis Le Secret de la force surhumaine qui rend compte de son addiction au sport, de l’enfance jusqu’à sa vie actuelle dans le Vermont rural (l’État très au nord et très à gauche de Bernie Sanders) avec sa compagne artiste Holly. C’est dans ce cadre-là qu’elle place un nouvel opus autobiographique qui a la volonté d’être aussi une réflexion politique en explorant les questions économiques. La comédie musicale tirée de Fun Home est devenue pour le livre une série télé sur son père empailleur d’animaux mais l’essentiel est qu’elle offre à une artiste un peu underground une aisance matérielle inespérée. Autre volonté de mettre un peu de fiction dans sa vie en BD, Bechdel vit tout près d’une petite ville où se sont installées les « lesbiennes à suivre », toujours en coloc ensemble et à peine vieillies, comme téléportées de leur grande ville des années 1980-2000.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 19 octobre, 2025
Par Aude le dimanche, 19 octobre, 2025, 21h09 - Textes
La réforme des retraites est un moment de déni de démocratie à plusieurs titres. Non seulement, comme l’a montré la constitutionnaliste Laureline Fontaine, le 49.3 de la première ministre pour se passer du vote du Parlement a été déclenché sans fondement, comme pour une simple loi de financement, alors qu’il s’agissait d’une réforme importante et non d’une reprise du fonctionnement annuel, ce qui interdisait d’avoir recours à une telle procédure d’adoption. Si la loi n’a pas été retoquée par le Conseil constitutionnel, toujours selon Fontaine, c’est en raison de la faiblesse grave de cette institution, trop proche du pouvoir et qui n’a pas les moyens de fonctionner comme le ferait un conseil de sages juristes (mais ça y est, on a la confirmation que son président a bien un DEUG de droit, un diplôme qui sanctionne deux années d’études).
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 14 octobre, 2025
Par Aude le mardi, 14 octobre, 2025, 07h35 - Textes
Dans les temps reculés autour de l’an 2000, je militais dans le mouvement de jeunesse commun à plusieurs partis politiques et j’avais été envoyée pour répondre aux questions d’une journaliste sur jeunesse et politique. J’eus droit à ma photo dans le magazine et les platitudes que j’avais racontées tenaient sur un paragraphe, en regard avec celles des représentant·es d’autres mouvements. Il ne manquait rien, même si j’avais repéré quelques imprécisions. La journaliste, Hélène Marronnier, avait repris un sujet à la mode dans les rédactions : le renouveau de l’engagement politique des jeunes. Déjà. Déjà les jeunes étaient hyper conscient·es des problèmes du monde autour d’elles et eux et allaient se battre pour les régler, vous allez voir ce que vous allez voir. À l’époque, je trouvais déjà le sujet un peu bateau (avec sa jeunesse représentée exclusivement par des mouv de partis) et mal traité, notamment parce qu’à mon avis des questions intéressantes n’étaient pas posées sur la particularité de l’engagement des jeunes, le besoin d’entre-soi et de lier la politique et la vie de tous les jours. Pour moi, être dans un mouvement de jeunes, c’était l’autorisation de se tester et de dire et de faire beaucoup de trucs pas très malins mais qu’on ne regretterait jamais, de se faire des potes plutôt qu’un réseau (1), à un âge où on a le temps et où on est gourmand·e de relations sociales. Les mouvements écolo adultes étaient bien plus ennuyeux et exclusifs, on y existait par l’expertise ou on se contentait de tenir les murs.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 28 septembre, 2025
Par Aude le dimanche, 28 septembre, 2025, 21h10 - Textes
 Le 14 juin au milieu de la nuit, un homme se faisant passer pour un policier s’est rendu au domicile d’un membre du Sénat du Minnesota, John A. Hoffman, et a tiré sur lui, son épouse et leur fille. Plus tard il a sonné à la porte d’un autre élu qui était en vacances. Il a ensuite visé le domicile de la sénatrice Ann Rest mais une patrouille de police, ayant eu vent de l’attaque sur Hoffman, avait eu l’idée de s’assurer qu’elle était en sécurité et a croisé le faux policier avant qu’il ne s’éloigne. Enfin, un peu plus d’une heure après la première attaque, celui-ci est entré sous les yeux de la police dans le domicile de Melissa Hortman, sénatrice de l’État elle aussi (photo ci-contre), et l’a assassinée ainsi que son mari et leur chien. John A. Hoffman et sa famille ont survécu à leurs blessures mais Melissa Hortman et son mari sont mort·es sur le coup. Les quatre élu·es visé·es avec leur famille sont démocrates. L’assassin, Vance Boelter, est un républicain qui avait sur sa liste 70 autres cibles politiques, élu·es démocrates, associations comme le Planning familial états-unien et toute une manifestation contre la pratique monarchique de Donald Trump, « No Kings », qui s’est malgré tout tenue plus tard ce jour-là (voir ci-dessous photo Lorie Shaull).
Le 14 juin au milieu de la nuit, un homme se faisant passer pour un policier s’est rendu au domicile d’un membre du Sénat du Minnesota, John A. Hoffman, et a tiré sur lui, son épouse et leur fille. Plus tard il a sonné à la porte d’un autre élu qui était en vacances. Il a ensuite visé le domicile de la sénatrice Ann Rest mais une patrouille de police, ayant eu vent de l’attaque sur Hoffman, avait eu l’idée de s’assurer qu’elle était en sécurité et a croisé le faux policier avant qu’il ne s’éloigne. Enfin, un peu plus d’une heure après la première attaque, celui-ci est entré sous les yeux de la police dans le domicile de Melissa Hortman, sénatrice de l’État elle aussi (photo ci-contre), et l’a assassinée ainsi que son mari et leur chien. John A. Hoffman et sa famille ont survécu à leurs blessures mais Melissa Hortman et son mari sont mort·es sur le coup. Les quatre élu·es visé·es avec leur famille sont démocrates. L’assassin, Vance Boelter, est un républicain qui avait sur sa liste 70 autres cibles politiques, élu·es démocrates, associations comme le Planning familial états-unien et toute une manifestation contre la pratique monarchique de Donald Trump, « No Kings », qui s’est malgré tout tenue plus tard ce jour-là (voir ci-dessous photo Lorie Shaull).
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 28 août, 2025
Par Aude le jeudi, 28 août, 2025, 16h20 - Lectures
Des nombreuses parutions des douze derniers mois, certaines ont retenu mon attention mais je n’ai pas trouvé le temps ou le bon angle pour en parler ici. Comme je continue à trouver ces ouvrages pertinents et bien pensés, j’en fais un billet collectif et plus léger, surtout pour vous recommander la découverte. Un mot sur les coulisses de ce billet : j’ai acheté une partie des livres que je recommande ici et j’ai reçu des services de presse pour d’autres, parfois ceux de mes propres éditeurs. Paradoxalement, je ne leur fais pas de traitement de faveur puisque toute l’année c’est les livres d’autres éditeurs que j’ai priorisés pour mes chroniques, moins nombreuses que d’habitude. Dans la lettre mensuelle de ce blog, il m’arrive de faire de très courtes chroniques de ce type ou de signaler d’autres choses que je trouve intéressantes. Pour la recevoir chaque mois, envoyez un mail vide à mensuelle-blog-ecologie-politique-subscribe@lists.riseup.net et suivez la démarche.
Lire la suite...
aucun rétrolien
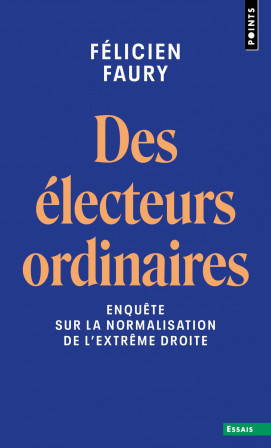 Félicien Faury, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite (2024), Points, 2026, 244 pages, 10,20 €
Félicien Faury, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l’extrême droite (2024), Points, 2026, 244 pages, 10,20 €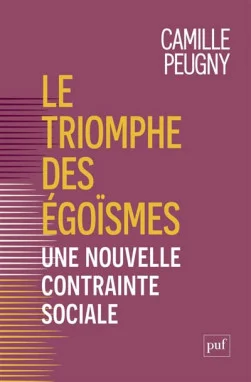 Camille Peugny, Le Triomphe des égoïsmes. Une nouvelle contrainte sociale, PUF, 2026, 240 pages, 18 €
Camille Peugny, Le Triomphe des égoïsmes. Une nouvelle contrainte sociale, PUF, 2026, 240 pages, 18 €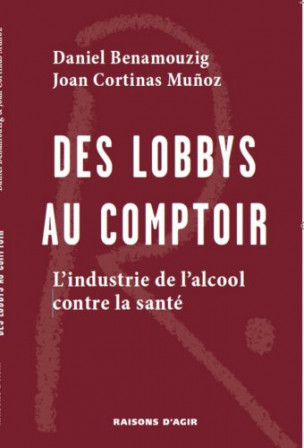 Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au comptoir. L’Industrie de l'alcool contre la santé, Raisons d'agir, 2025, 170 pages, 14 €
Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au comptoir. L’Industrie de l'alcool contre la santé, Raisons d'agir, 2025, 170 pages, 14 €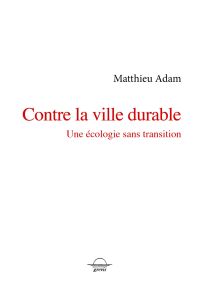 Matthieu Adam, Contre la ville durable. Une écologie sans transition, Grevis, 2025, 140 pages, 13 €
Matthieu Adam, Contre la ville durable. Une écologie sans transition, Grevis, 2025, 140 pages, 13 €
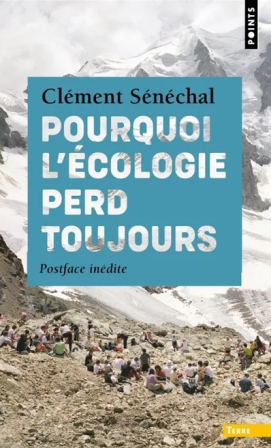 Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours, Points, 2025
Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours, Points, 2025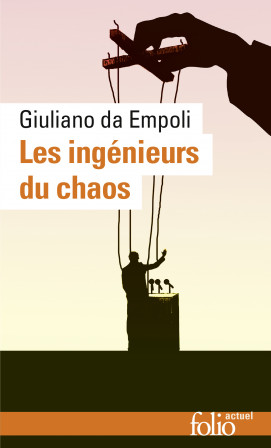 Giuliano da Empoli, Les Ingénieurs du chaos (2019), Folio, 2023, 240 pages, 8,50 €
Giuliano da Empoli, Les Ingénieurs du chaos (2019), Folio, 2023, 240 pages, 8,50 €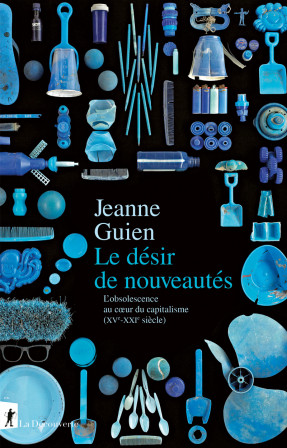 Jeanne Guien, Le Désir de nouveautés. L’Obsolescence au cœur du capitalisme (XVe-XXIe siècle), La Découverte, 2025, 352 pages, 23 €
Jeanne Guien, Le Désir de nouveautés. L’Obsolescence au cœur du capitalisme (XVe-XXIe siècle), La Découverte, 2025, 352 pages, 23 €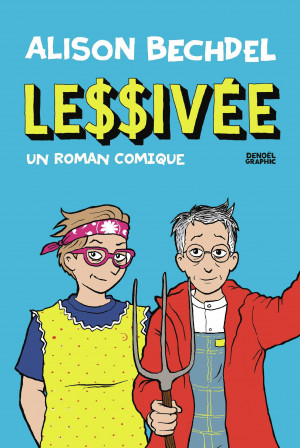 Alison Bechdel, Le$$ivée. Un roman comique, traduit de l’anglais (États-Unis) par Lili Sztajn, Denoël Graphic, 272 pages, 28 €
Alison Bechdel, Le$$ivée. Un roman comique, traduit de l’anglais (États-Unis) par Lili Sztajn, Denoël Graphic, 272 pages, 28 € Le 14 juin au milieu de la nuit, un homme se faisant passer pour un policier s’est rendu au domicile d’un membre du Sénat du Minnesota, John A. Hoffman, et a tiré sur lui, son épouse et leur fille. Plus tard il a sonné à la porte d’un autre élu qui était en vacances. Il a ensuite visé le domicile de la sénatrice Ann Rest mais une patrouille de police, ayant eu vent de l’attaque sur Hoffman, avait eu l’idée de s’assurer qu’elle était en sécurité et a croisé le faux policier avant qu’il ne s’éloigne. Enfin, un peu plus d’une heure après la première attaque, celui-ci est entré sous les yeux de la police dans le domicile de Melissa Hortman, sénatrice de l’État elle aussi (photo ci-contre), et l’a assassinée ainsi que son mari et leur chien. John A. Hoffman et sa famille ont survécu à leurs blessures mais Melissa Hortman et son mari sont mort·es sur le coup. Les quatre élu·es visé·es avec leur famille sont démocrates. L’assassin, Vance Boelter, est un républicain qui avait sur sa liste 70 autres cibles politiques, élu·es démocrates, associations comme le Planning familial états-unien et toute une manifestation contre la pratique monarchique de Donald Trump, « No Kings », qui s’est malgré tout tenue plus tard ce jour-là (voir ci-dessous photo Lorie Shaull).
Le 14 juin au milieu de la nuit, un homme se faisant passer pour un policier s’est rendu au domicile d’un membre du Sénat du Minnesota, John A. Hoffman, et a tiré sur lui, son épouse et leur fille. Plus tard il a sonné à la porte d’un autre élu qui était en vacances. Il a ensuite visé le domicile de la sénatrice Ann Rest mais une patrouille de police, ayant eu vent de l’attaque sur Hoffman, avait eu l’idée de s’assurer qu’elle était en sécurité et a croisé le faux policier avant qu’il ne s’éloigne. Enfin, un peu plus d’une heure après la première attaque, celui-ci est entré sous les yeux de la police dans le domicile de Melissa Hortman, sénatrice de l’État elle aussi (photo ci-contre), et l’a assassinée ainsi que son mari et leur chien. John A. Hoffman et sa famille ont survécu à leurs blessures mais Melissa Hortman et son mari sont mort·es sur le coup. Les quatre élu·es visé·es avec leur famille sont démocrates. L’assassin, Vance Boelter, est un républicain qui avait sur sa liste 70 autres cibles politiques, élu·es démocrates, associations comme le Planning familial états-unien et toute une manifestation contre la pratique monarchique de Donald Trump, « No Kings », qui s’est malgré tout tenue plus tard ce jour-là (voir ci-dessous photo Lorie Shaull).