Géopolitique de l’état d’exception
Par Aude le lundi, 7 octobre, 2024, 08h38 - Lectures - Lien permanent
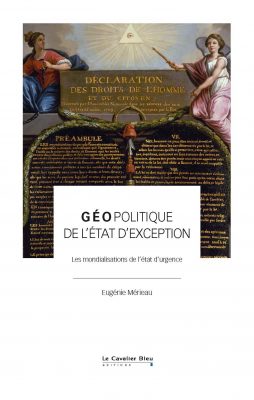 Eugénie Mérieau, Géopolitique de l’état d’exception. Les Mondialisations de l’état d’urgence, Le Cavalier bleu, 2024, 176 pages, 21 €
Eugénie Mérieau, Géopolitique de l’état d’exception. Les Mondialisations de l’état d’urgence, Le Cavalier bleu, 2024, 176 pages, 21 €
Après La Dictature, une antithèse de la démocratie ?, dans lequel elle démystifiait les régimes autoritaires et les mythes autour des dictatures, la juriste et politiste Eugénie Mérieau propose de regarder dans l’arrière cour des régimes libéraux à travers la notion d’état d’exception. On a souvent coutume d’évaluer les caractères démocratiques d’un régime au regard de sa Constitution et de la soumission de l’État aux règles du droit. Or, comme Mérieau le montre tout le long de cet ouvrage synthétique, l’État de droit s’est souvent accompagné d’un double moins présentable, l’état d’exception.
L’état d’exception est un héritage des empires coloniaux, dans lesquels les mêmes lois ne prévalent pas pour le centre et la périphérie. Aussi Mérieau revient-elle aux premiers temps de la colonisation avec les conclusions du juriste Francisco de Vitoria, souvent crédité comme l’inventeur du droit international au XVe siècle et qui après avoir argumenté contre le droit des Européens de s’approprier leurs « découvertes » du Nouveau Monde, légitima les guerres coloniales au motif que si les conquérants étaient privés de la liberté d’aller et de venir, à plus fort titre attaqués sur des terres qui n’étaient pas les leurs, ils avaient le droit de se défendre. « Si les Indiens sont soumis au droit international, écrit Mérieau, alors ils ont un devoir d’hospitalité, de commerce avec les autres nations, et toute violation ou résistance justifie la guerre de "légitime défense" des Espagnols sur les indigènes, guerre juste. » Et cela quand bien même ils ne seraient pas associés à la définition du droit qui s’applique à eux ni ne reconnaîtraient le devoir de commerce avec les autres nations. Tout est déjà posé, la définition du droit pour le reste du monde par les élites européennes et l’obligation d’ouverture commerciale.
John Locke et Charles de Montesquieu, fondateurs de la pensée libérale, ont navigué de la même manière entre grands principes universels et service des intérêts de leur nation… quand ce n’était pas les leurs propres. Locke fut actionnaire de compagnies coloniales pratiquant le commerce d’esclaves et Montesquieu, dont Mérieau rappelle qu’on n’a jamais prouvé ses investissements financiers coloniaux, un grand propriétaire terrien qui lutta pour son droit de planter du vignoble pour le commerce international alors que la région manquait de blé et connaissait la disette. Locke, considérant que l’Amérique est terra nullius et les sociétés autochtones un état de nature (bien qu’il ait entretenu une véritable conversation avec deux chefs autochtones), légitime leur appropriation, jusqu’à l’esclavage. « Tous ces développements sur les théories de l’appropriation, du despotisme et de l’esclavage contrastent évidemment avec les développements concernant la séparation des pouvoirs, le rule of law, et la liberté comme bien suprême et droit naturel préexistant à l’État. » Montesquieu, pour sa part, a pu se prononcer contre l’esclavage mais prétexte sa théorie des climats pour justifier une institution sans laquelle personne sous les tropiques ne prendrait la peine de travailler. Pour lui « l’impérialisme est justifié pour deux motifs, le premier, celui d’établir le commerce, et le second, celui de sauver un peuple de coutumes barbares ». Mérieau conclut : « La modernité, finalement, ne serait-elle pas d’articuler empire autoritaire aux marges et liberté au centre ? »
Au XVIIIe siècle, cette partition géographique permet à des esclaves d’être libéré·es par le seul fait de leur présence sur le sol métropolitain, avant qu’une « Déclaration pour la police des Noirs » en France en 1777 ne s’applique aux personnes en raison de la couleur de leur peau. « Ainsi, les libéralismes de Locke et de Montesquieu, inclusifs et universels en théorie se révèlent exclusifs et contingents en pratique, tels que mis en œuvre par les tribunaux français et britanniques du XVIIIe siècle. » Mérieau clôt cette histoire classique (mais toujours très actuelle et émaillée d’encadrés sur le contexte français) avec John Stuart Mill, penseur libéral du XIXe siècle très impliqué dans l’impérialisme britannique, et son dualisme plus évidemment raciste, « adossée à une vision évolutionniste de la société plaçant les peuples sur une "échelle de civilisation" : sauvages, barbares, civilisés » soit respectivement peuples sans État, peuples avec État jugé inférieur par les Européens et peuples avec État européens (et encore Mill juge-t-il la société irlandaise indigne de souveraineté). Alexis de Tocqueville, autre penseur libéral, accompagne la colonisation de l’Algérie (acte inique par lequel la France effaça sa dette commerciale envers ce pays (1)). Opposé en principe à la loi martiale, il la juge adaptée à l’Algérie, parallèlement à un État de droit qui rend le pays attractif aux colons blancs. Deux droits différents s’appliquent dans le même espace. « Tocqueville est peut-être le premier libéral à théoriser clairement un système dual dictature/démocratie au sein d’un même État appliqué à deux groupes différents : les sujets (arabes) et les citoyens (français). »
Au début du XXe siècle, la colonisation « est terminée et unanimement condamnée ». Les mouvements pour l’indépendance des colonies font l’objet d’une répression sévère qui n’est plus autorisée par le droit de la guerre triomphant. Qu’à cela ne tienne, la répression s’adosse désormais à un état d’urgence civil et devient simple opération de police. En Syrie, sur laquelle la France a mandat, le gouvernement choisit de bombarder Damas sans en faire un acte militaire (le bombardement de civils serait un crime de guerre) mais un acte de maintien de l’ordre (et qu’importe que les moyens disproportionnés, qui sont ceux de la guerre, suggèrent que la classification est mensongère). Ainsi, à l’heure où les droits humains sont de mieux en mieux définis et défendus dans le centre, en périphérie ils sont niés pour des prétextes spécieux. Le travail forcé, interdit en métropole sous l’égide de l’OIT à peine créée, est encore applicable dans les colonies, à l’appréciation de la puissance colonisatrice (qui y a recours). Et quand cette autorisation fait l’objet de critiques dans les années 1930, elle devient « transitoire ».
En 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme ouvre une nouvelle ère (promis). Mais les exactions des Alliés (des bombardements sur des cibles civiles dont certains n’avaient aucun intérêt militaire ou stratégique immédiat) ne font l’objet d’aucune remise en cause et l’état d’urgence est imposé par les puissances coloniales au cours de guerres de libération. Mérieau étudie les nombreux textes fondateurs du droit international mis en œuvre par les régimes libéraux de l’après-guerre au regard de leurs agissements coloniaux et pointe du doigt ce qui fait tenir le mensonge, parfois une clause interne (les parties signataires peuvent déroger à la convention « dans la stricte mesure où la situation l’exige »), souvent un statut simplement déclaratif (c’est le cas de la DUDH et de tant d’autres droits, les derniers en date étant ceux des paysan·nes et des habitant·es des zones rurales qui permettent seulement aux ONG d’interpeler avec dignité les États qui ne les respectent pas).
Pour clore ce chapitre sur l’après-guerre, Mérieau revient sur la fondation en 1958 de la Ve République et sur les dispositions monarchiques qu’elle contient, un article 36 qui permet de proclamer l’état d’urgence et un article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République… dont celui de proroger l’état d’urgence sans validation du Parlement. Ce texte à propos duquel Emmanuel Macron déclarait en 2018 sans rire qu’il « referm(ait) la quête du bon gouvernement » nous réserve une surprise après l’autre, comme une boîte de chocolats oubliée dans un placard depuis 1977.
Le peu de goût des penseurs néolibéraux pour la démocratie a déjà été bien documenté. Friedrich Hayek et son héritier Milton Friedman se compromirent avec des dictatures, notamment le régime de Pinochet au Chili. Hayek se flattait ainsi d’être « totalement contre les dictatures. Mais une dictature peut être un système nécessaire pendant une période de transition. Il est parfois nécessaire pour un pays d’avoir, pendant un certain temps, une forme de pouvoir dictatorial. (…) il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale. Et il est également possible qu’une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme. » L’économiste néolibéral n’était donc pas un ennemi si résolu de la dictature, le plus important étant de préserver le marché et les libertés économiques, des institutions qui ont pourtant la capacité de diminuer les libertés fondamentales du plus grand nombre. Mérieau documente le parcours des deux économistes et leur défense de systèmes « "duaux" conciliant d’une part liberté en matière économique et d’autre part dictature en matière politique ». La préservation d’un type de liberté peut s’accompagner (et quand elle est remise en cause politiquement, elle le doit aux yeux des deux penseurs néolibéraux) du non-respect de l’État de droit. La centralité des intérêts de l’État justifie de fait (et c’est peut-être le cas depuis les débuts d’une colonisation mercantile (2)) celle des intérêts du capital. La Constitution chilienne a non seulement des caractères monarchiques mais « elle contient en fait deux constitutions : une constitution libérale "permanente" ou de principe, et une constitution dictatoriale d’urgence » qui peut prendre le pas sur la première à l’appréciation du seul président. À l’issue du règne de Pinochet, rappelle Mérieau, 40 000 personnes ont perdu leur liberté ou leur vie pour assurer la liberté du capital.
Après 1989, la démocratie s’impose peu à peu dans le monde entier dans les récits libéraux. Et quand elle ne s’impose pas toute seule, les « interventions humanitaires » des États-Unis sous l’égide des Nations unies leur donnent un coup de pouce, quitte à ne pas respecter l’intégrité de nations souveraines, et le font au prix de mensonges (Mérieau rappelle l’épisode mis en scène des bébés koweïtiens en danger lors de la première guerre du Golfe et celui des armes de destruction massives qui prétextèrent une deuxième invasion de l’Irak). Là encore, deux penseurs libéraux justifient l’intervention de leur pays. « Michael Walzer et John Rawls (…) s’approprient et développent la notion d’"urgence suprême", autorisant une suspension temporaire du droit de la guerre, dans des cas extrêmes, voire toujours lorsqu’il s’agit d’une guerre avec des "États hors-la-loi" ou "faillis", hors du "contrat social international". » Les deux justifient les crimes de guerre des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, même si « la décision de cibler les civils s’appelle en droit de la guerre du terrorisme ». Walzer justifie par l’urgence d’emporter une victoire militaire la mort d’un demi-million de civils délibérément ciblés par les Alliés. Rawls condamne la guerre hors cas de légitime défense mais des cas d’« urgence suprême » justifieraient également une exemption, non seulement du droit à la guerre (le jus ad bellum qui justifie des déclarations de guerre) mais également du droit de la guerre (le jus in bello qui interdit en théorie certains actes militaires qualifiés de crimes de guerre, comme la torture de combattants ou le ciblage de populations civiles). « Dès lors, il est justifié, pour Rawls, reprenant Kant, que les sociétés démocratiques s’engagent dans des guerres préventives et même attaquent les populations civiles s’il s’agit de neutraliser des États hors du droit ou en passe de le devenir. »
Cela fait à force beaucoup d’exceptions. « Rawls fait la différence entre les "peuples libéraux, bien ordonnés, décents" et les autres, les peuples "outlaw", "pas bien ordonnés, pas libéraux, indécents". Seuls les nations et peuples libéraux, membres de la "société des peuples", peuvent faire des guerres justes et uniquement avec les peuples non libéraux. Les guerres des peuples non libéraux sont quant à elles forcément injustes. » En théorie, c’est très simple. Mais en vrai il est plus compliqué de définir les régimes qui sont des dictatures et ceux qui sont des démocraties, Mérieau l’a impeccablement montré dans son ouvrage précédent et les derniers événements l’ont également illustré. Le refus de seulement laisser la chance à la coalition arrivée en tête de monter une majorité résolument opposée aux idées du RN à l’Assemblée, le mandat accordé au représentant d’un parti ayant réuni deux millions de voix au premier tour (mazette !) et fait élire 39 député·es (sur 577) pour former un gouvernement dont chaque loi devra passer sous les fourches caudines du RN, allié de facto, tout cela serait qualifié unanimement d’autoritarisme illibéral par la communauté internationale si c’était le fait d’un Narendra Modi ou d’un Vladimir Poutine.
Mérieau conclut son ouvrage sur trois moments qui virent la mise en œuvre de dispositions juridiques contraires à l’État de droit au prétexte d’une réponse adaptée à l’urgence. Après les attentats du 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité fait adopter à tous les États des dispositions anti-terroristes, intégrer dans le droit national le crime spécifique de terrorisme et appliquer des dispositions comme la surveillance des populations, des flux d’argent et la fermeture des frontières aux réfugiés et demandeurs d’asile – une aubaine pour les États qui ont pu faire qualifier leurs opposants de terroristes : « Ouïghours, Tchéchènes, Palestiniens, etc. » (la qualification par Darmanin des activistes écolo d’« éco-terroristes » n’est pas qu’un effet de manche médiatique, il justifie de les priver d’eau et de nourriture comme de les mettre en danger de chute et de mort).
La crise de 2008 a dans un autre registre permis « d’augmenter considérablement les pouvoirs de la Banque centrale ainsi que, par extension, de l’Union européenne, sur les États-membres » et de « dicter aux États "sauvés" leur politique fiscale, budgétaire et plus largement économique ». « Les pouvoirs d’urgence de la troïka (3) ont eu pour effet, dans certains cas, une violation de facto des droits économiques et sociaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Les politiques de santé publique ont elles aussi fait l’objet de telles prises de pouvoir par des organisations internationales. « L’Organisation mondiale de la santé adopte (...) en 2005, son Règlement sanitaire international, traité international ayant pour mission de "prévenir, protéger, contrôler et fournir une réponse de santé publique à la diffusion internationale des maladies". Il s’agit d’un cadre donnant à l’OMS des pouvoirs constitutionnels d’urgence. » L’état d’urgence sanitaire est bien le pendant de l’état d’urgence policier et non une vague alarme, il a principalement consisté en moyens de coercition et en limitation des libertés civiles. Sans mener de politiques de santé publique à la hauteur. Ce n’est pas le propos de Mérieau mais je souhaite rappeler ici le rôle néfaste de l’OMS qui a catégoriquement et contre toute évidence nié la principale caractéristique de la transmission du Covid-19 alors que la recherche était encore en cours et qu’elle a prouvé quelques semaines plus tard que le virus était bien aéroporté et non transmis par les gouttelettes (petits postillons) et les fomites (surfaces). Quatre ans plus tard, cette désinformation fait encore foi, y compris chez une majorité de soignant·es, car l’OMS n’a pas souhaité revenir sur ses premières affirmations, probablement car les mesures à prendre sont trop coûteuses pour nos vies dispensables. Fermer les frontières ou empêcher les déplacements coûte moins cher que de se munir de meilleurs dispositifs de purification de l’air intérieur. L’autrice était alors à Singapour et elle rappelle les dispositions prises par la cité-État, notamment les applications de traçage des personnes. Celles-ci ont à ma connaissance été utilisées pour résoudre des affaires policières sans que la population s’émeuve trop du glissement. « La mise en place de ces états d’urgence s’est produite grâce à une "stratégie du choc" globale, à la faveur de crises successives. »
Des crises sanitaires, économiques, politiques, probablement un jour écologique… tout est bon pour imposer des dispositions contraires à l’État de droit et aux quelques caractères démocratiques de nos sociétés. Comment a-t-on pu passer des déclarations iréniques des années 1990 sur la démocratie et le devoir d’intervenir pour sauver des populations civiles aux prisons de Guantanamo et d’Abou Ghraib, où des combattants furent détenus illégalement et torturés dans les années 2000 ? Mérieau a su montrer qu’il ne s’agissait pas d’un changement de paradigme (on abandonne le libéralisme pour une attitude plus réaliste face aux désordres du monde) mais de renforcer une manière de gouverner propre au libéralisme, depuis ses origines intellectuelles les plus anciennes. « Étudier l’état d’urgence comme élément de la pensée libérale, c’est aller à rebours de l’idée selon laquelle il s’agit là d’un outil d’une autre tradition de pensée : celle de la pensée réaliste plutôt que libérale. » « Par ses contradictions internes, la pensée libérale porte en germe la pensée réaliste. » Voilà qui fait craindre le pire quand un président fan d’une Ve République dont il use et abuse agite le spectre de la guerre civile qui justifierait le déclenchement des pleins pouvoirs prévu par l’article 16. Je suggère, pour poursuivre la découverte de cette pensée qui ne craint pas de mettre à mal quelques mythes, d’écouter l’excellente interview d’Eugénie Mérieau dans lundisoir. Et si possible de se plonger dans la lecture de ses deux derniers ouvrages.
(1) Ce mois-ci sort un ouvrage important sur la colonisation de l’Algérie, La Première Guerre d'Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 par Alain Ruscio, La Découverte, 2024.
(2) Deux bras armés des États en Asie lors des premiers siècles de la colonisation, la East India Company britannique et la Verenigde Oostindische Compagnie néerlandaise, étaient des compagnies commerciales privées jouissant de prérogatives policières et militaires et de monopoles d’État.
(3) Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international.