jeudi, 31 octobre, 2024
Par Aude le jeudi, 31 octobre, 2024, 10h38 - Lectures
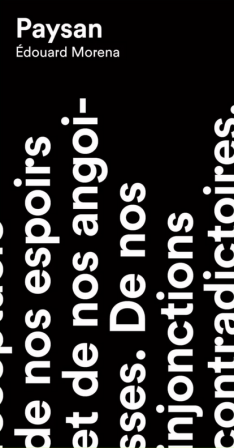 Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Paysan. La collection « Le mot est faible » propose de « s’emparer d’un mot dévoyé par la langue du pouvoir » et l’ouvrage d’Édouard Morena offre une belle illustration de cette démarche. Après une thèse consacrée à la Confédération paysanne, le politiste s’est consacré à l’étude des acteurs de la lutte contre le changement climatique, et notamment des philanthrocapitalistes (Fin du monde et petits fours, La Découverte, 2023). Il revient pour ce livre à la question paysanne suite au mouvement agricole de l’hiver 2024, qui vit tout un pays célébrer ses « paysans ». Dans l’interprétation de la gauche paysanne, la reprise par le Premier ministre Gabriel Attal du slogan « Pas de pays sans paysan » était une simple récupération, alors que par ailleurs le gouvernement s’engageait dans le soutien à une agriculture de plus en plus capitalisée et concentrée économiquement. Morena propose de refaire l’histoire du mot pour comprendre les affinités de la figure du paysan avec la droite comme avec la gauche, avec les milieux conservateurs comme avec les modernisateurs et les progressistes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 22 septembre, 2024
Par Aude le dimanche, 22 septembre, 2024, 10h28 - Annonces
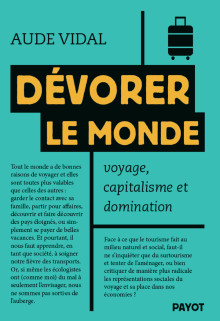 Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €
Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €
Ce mois-ci paraît Dévorer le monde, mon quatrième ouvrage personnel. J’en publie ici les premières lignes. Merci à Audrey et Aude, mes premières lectrices, à Laura à qui je dois la précision lexicale du titre, à toutes les personnes qui m’ont encouragée à l’écrire, ainsi qu’à Christophe, mon éditeur, et à l’équipe des éditions Payot.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 26 février, 2024
Par Aude le lundi, 26 février, 2024, 09h06 - Textes
J’ai déjà démonté ici le cliché selon lequel « on vote avec son portefeuille » et on n’a qu’à traverser la rue pour soutenir son type d’agriculture préféré en achetant les produits qui en sont issus. Julien Denormandie, le précédent ministre de l’agriculture, avait ainsi justifié l’abandon des aides publiques au maintien en agriculture bio : c’était un segment du marché, l’État n’avait aucune raison de soutenir les préférences de consommation de tel ou telle. Ce genre de considération est une sorte de bingo particulièrement réussi de l’idéologie qui triomphe aujourd’hui, elle coche toutes les cases de ce que pensent les représentant·es les plus idiot·es de la petite bourgeoisie qui vote au centre ; elle a pour but de flatter dans le sens du poil leur méconnaissance du monde dans lequel ils et elles trimbalent leurs malheureuses existences. Je ne fais pas l’honneur à Emmanuel Macron de manger la même pâtée que celle qu’il donne à ses chiens. Ses sorties récentes sur le sujet sont le propos délibérément cynique d’un leader populiste. Je reprends donc, parce qu’il me semble important à plusieurs titres, le sujet à la faveur de l’actualité.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 15 février, 2024
Par Aude le jeudi, 15 février, 2024, 10h10 - Textes
La récente mobilisation agricole a emmêlé tous les ingrédients qui caractérisent la France depuis son accélération illibérale : une pauvreté que le travail peine à résorber malgré les promesses renouvelées depuis 2007 de lui redonner sa « valeur » (morale, voire moralisatrice, mais jamais économique) ; la colère à laquelle donnent lieu ces promesses non tenues et le sentiment d’avoir été le dindon de la farce ; l’arbitrage systématique des gouvernements en faveur des classes dominantes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 10 septembre, 2023
Par Aude le dimanche, 10 septembre, 2023, 10h16 - Textes
 Tout le monde aime les arbres. Même Macron. Et pour cause, en dehors de leur valeur intrinsèque, leurs bénéfices pour les êtres humains sont nombreux. En ville les arbres améliorent la qualité de l’air en capturant le CO2 et relâchant de l'oxygène. Ils apportent une ombre bien plus fraîche (1) que celle des « ombrelles » en béton qui les ont parfois remplacés (2). L’absence d’arbres et des espaces trop minéraux provoquent au contraire des îlots de chaleur insupportables lors des périodes caniculaires toujours plus nombreuses. Les arbres à feuilles caduques ont même le bon goût de se dévêtir l’hiver, quand les maisons ont besoin des apports du soleil pour se réchauffer, et c’est l’un des principes de l’architecture bioclimatique. Dans les prés et même les champs, la présence d’arbres protège de la sécheresse, apporte de l’ombre et du fourrage pour les animaux (les ruminants mangent aussi des feuilles), du bois dans les économies paysannes pour le chauffage ou la construction. Les recherches en agroécologie nous ont permis de mesurer les bénéfices de l’arbre jusque dans les champs. Certes ils compliquent le travail mécanique et réservent une partie de la surface, qui ne peut être cultivée. Mais globalement, il est établi que la présence d’arbres est un bénéfice y compris en matière de production végétale et là encore les canicules à venir ne feront que les accroître en comparaison avec les terres sans arbres, plus sujettes à la sécheresse et dont l’attrait paysager est par ailleurs bien faible. Les forêts, en revanche, apportent fraîcheur et variété des espèces vivantes (3). Les paysages arborés fournissent un plaisir qui va jusqu’à l’émerveillement mais qui disparaît devant une monoculture à perte de vue. Partout la présence d’arbres contribue à l’entretien de populations d’insectes pollinisateurs ou non, au maintien de la vie. Et au niveau global, les arbres ont les mêmes avantages de captation du CO2 et leur rôle dans la régulation des gaz à effet de serre est bien connu. Dans les forêts tropicales, la plantation d’arbres nourriciers au milieu des arbres qui ont poussé spontanément ainsi que la chasse d’animaux forestiers ont permis à de nombreux peuples, comme à Bornéo, de vivre dans cet écosystème. La déforestation sur tous les continents de larges pans de forêt met en jeu leur survie… et à terme, la nôtre.
Tout le monde aime les arbres. Même Macron. Et pour cause, en dehors de leur valeur intrinsèque, leurs bénéfices pour les êtres humains sont nombreux. En ville les arbres améliorent la qualité de l’air en capturant le CO2 et relâchant de l'oxygène. Ils apportent une ombre bien plus fraîche (1) que celle des « ombrelles » en béton qui les ont parfois remplacés (2). L’absence d’arbres et des espaces trop minéraux provoquent au contraire des îlots de chaleur insupportables lors des périodes caniculaires toujours plus nombreuses. Les arbres à feuilles caduques ont même le bon goût de se dévêtir l’hiver, quand les maisons ont besoin des apports du soleil pour se réchauffer, et c’est l’un des principes de l’architecture bioclimatique. Dans les prés et même les champs, la présence d’arbres protège de la sécheresse, apporte de l’ombre et du fourrage pour les animaux (les ruminants mangent aussi des feuilles), du bois dans les économies paysannes pour le chauffage ou la construction. Les recherches en agroécologie nous ont permis de mesurer les bénéfices de l’arbre jusque dans les champs. Certes ils compliquent le travail mécanique et réservent une partie de la surface, qui ne peut être cultivée. Mais globalement, il est établi que la présence d’arbres est un bénéfice y compris en matière de production végétale et là encore les canicules à venir ne feront que les accroître en comparaison avec les terres sans arbres, plus sujettes à la sécheresse et dont l’attrait paysager est par ailleurs bien faible. Les forêts, en revanche, apportent fraîcheur et variété des espèces vivantes (3). Les paysages arborés fournissent un plaisir qui va jusqu’à l’émerveillement mais qui disparaît devant une monoculture à perte de vue. Partout la présence d’arbres contribue à l’entretien de populations d’insectes pollinisateurs ou non, au maintien de la vie. Et au niveau global, les arbres ont les mêmes avantages de captation du CO2 et leur rôle dans la régulation des gaz à effet de serre est bien connu. Dans les forêts tropicales, la plantation d’arbres nourriciers au milieu des arbres qui ont poussé spontanément ainsi que la chasse d’animaux forestiers ont permis à de nombreux peuples, comme à Bornéo, de vivre dans cet écosystème. La déforestation sur tous les continents de larges pans de forêt met en jeu leur survie… et à terme, la nôtre.

Photos : En septembre 2022 en Loire-Atlantique, l'herbe n'est restée verte que sous un grand arbre. Pendant une très chaude journée d’été dans le Lot-et-Garonne, des animaux d’élevage se regroupent à l’ombre des arbres. Ombre portée en été sur la façade d’un mas provençal par un micocoulier.

Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 9 juillet, 2023
Par Aude le dimanche, 9 juillet, 2023, 21h40 - Lectures
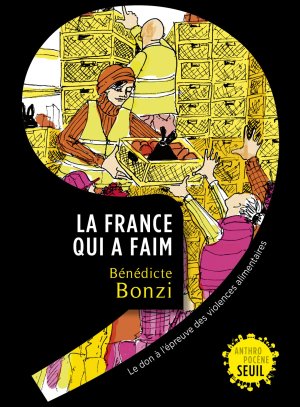 Bénédicte Bonzi, La France qui a faim. Le Don à l'épreuve des violences alimentaires, Seuil, 2023, 448 pages, 22 €
Bénédicte Bonzi, La France qui a faim. Le Don à l'épreuve des violences alimentaires, Seuil, 2023, 448 pages, 22 €
En 2020, la précarité alimentaire explosait, touchant de nouvelles couches de population. La thèse de Bénédicte Bonzi a été soutenue avant, alors que l’aide alimentaire s’était déjà durablement installée dans le paysage français. L’anthropologue a mené un travail de terrain aux Restaurants du cœur, participant à des distributions diurnes ainsi qu’à des maraudes de nuit, quand l’association va auprès de personnes en grande difficulté pour leur offrir des repas chauds. Les distributions concernent plutôt des marchandises à préparer chez soi, elles nécessitent une démarche volontaire et souvent considérée comme humiliante. Bonzi décrit l’ambivalence de cette situation, le témoignage d’humanité dans le don et l’échange qu’il impulse (voir les travaux de Mauss, Godelier et Godbout) mais aussi tout ce qui rend le don amer.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 13 juin, 2023
Par Aude le mardi, 13 juin, 2023, 08h03 - Textes
L'extrême droite française fait ses délices de la notion de déclin, celui-ci étant toujours mis sur le compte des minorités, en particulier ethniques. Faisons-nous, nous qui sommes attaché·es à des valeurs égalitaires, émancipatrices et à la réconciliation avec notre milieu naturel, le même constat ? Oui et non. Et pour nous les causes sont absolument différentes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 26 septembre, 2022
Par Aude le lundi, 26 septembre, 2022, 08h26 - Textes
C’est un air connu, que les marionnettes du jeu électorat se remettent à siffler quand elles s’inquiètent qu’on les ait oubliées. Fabiend’chez nous Roussel et sainte Sandrine Rousseau, deux héros de la défaite de la gauche en Hauts-de-France qui se sont imposé·es dans l’arène nationale, remettent le couvert sur la question de la consommation de viande. Rousseau, qui n’était pas végétarienne la dernière fois que j’ai mangé avec elle, renforce son image d’écoféministe en dénonçant une consommation masculine de viande qui détruit la planète. Sur le fond, le propos est assez juste : la manière dont sont associées la consommation de viande et la masculinité, la chasse, la prédation, la force physique et même la couleur rouge (1), dite aussi virilo-carnisme ou carno-phallogocentrisme pour faire plus simple, est une représentation sociale mise en lumière depuis plusieurs décennies et qui explique encore aujourd’hui la consommation différenciée de viande entre femmes et hommes (2). La journaliste féministe Nora Bouazzouni a d’ailleurs produit récemment deux ouvrages éclairants et bien argumentés sur le sujet, Faiminisme et Steaksisme (Nouriturfu, 2017 et 2021). Roussel, qui drague un électorat en tout point opposé, en a profité pour faire son apologie des vraies valeurs françaises, vin, viande et fromage.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 24 août, 2022
Par Aude le mercredi, 24 août, 2022, 08h48 - Lectures
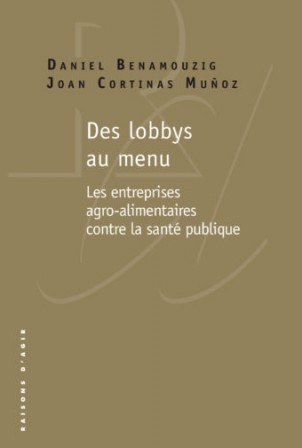 Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’agir, 2022, 176 pages, 9 €
Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’agir, 2022, 176 pages, 9 €
C’est un court ouvrage mais qui rend compte d’une recherche très ambitieuse sur l’influence des entreprises agroalimentaires sur le débat et les politiques publiques en France. Cette influence se déploie dans trois dimensions avec trois outils privilégiés. Les think tanks investissent le champ scientifique, les organisations de représentations d’intérêt les instances étatiques, les fondations d’entreprise la société civile. Leurs efforts se sont particulièrement concentrés ces dernières années sur trois sujets : la mise en œuvre du Nutriscore, les états généraux de l’alimentation et dans une moindre mesure la discussion de l’interdiction de publicités télévisées pour les aliments transformés à l’attention des enfants. Ces trois moments ont été l’occasion d’influences plus directes qui mobilisent des liens créés et entretenus en continu par l’industrie en ordre plus ou moins dispersé car au-delà des entreprises, les filières (profession du lait ou du sucre) et l’ensemble de la profession (Association nationale des industries alimentaires, la discrète Ania) mènent des actions en ce sens.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 15 mars, 2022
Par Aude le mardi, 15 mars, 2022, 20h22 - Textes
Et si, pour protéger les espèces vivantes de cette planète, nous décidions de préserver la moitié des terres de toute agriculture ? C’est la proposition qui est faite par les tenants du sparing, de l’anglais pour épargner. Cette idée part du principe que notre agriculture est destructrice des milieux et que la meilleure façon de limiter son impact est de limiter les surfaces sur lesquelles elle se déploie. Dans ce cadre de pensée-là, la productivité plus faible de l’agroécologie (1), plus gourmande en espaces, en fait un choix… moins écologique. Le biologiste Edward Osborne Wilson a présenté en 2016 cette idée dans un ouvrage, Half-Earth, jamais traduit en français. Benjamin Phalan, l’un des chercheurs qui la soutient, montre que les populations animales s’en sortent mieux dans les espaces sauvages que cultivés, même de manière écologique, et selon lui « la plupart des espèces auraient des populations plus fournies si la nourriture était produite sur les surfaces les plus réduites possible, épargnant les plus grandes surfaces de végétation sauvage possible » (les citations sont tirées d’un article lumineux de Fred Pearce).
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 19 janvier, 2022
Par Aude le mercredi, 19 janvier, 2022, 09h02 - Textes
La viande est en passe de devenir le énième emblème identitaire, marqueur de francité ou de progrès social. La droite rance réagit au quart de tour quand il est question de végétarisme. L’annonce de menus végétariens sans possibilité de choix dans les écoles lyonnaises avait déclenché une véritable panique morale, quand bien même la mesure avait été mise en place par la mairie de droite avant la victoire d’EELV, pour fluidifier la circulation dans les cantines par temps de Covid. À les entendre, c’est Mozart qu’on assassine, les enfants pauvres qu’on prive de subsistance, les éleveurs qu’on condamne à un suicide certain.
Cette droite est désormais suivie par le candidat communiste pour qui la tradition française et la qualité de la nourriture se confondent en une devise ternaire : « Viande, fromage, vin (avec modération). » Exit les patates du gratin dauphinois, les haricots du cassoulet, les pommes de la tarte Tatin, le populo veut de la barbaque et du frometon, la gauche va leur en donner !
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 17 décembre, 2021
Par Aude le vendredi, 17 décembre, 2021, 13h50 - Lectures
La bande dessinée documentaire a le vent en poupe depuis quelques années, et l’agriculture fait partie de ses centres d’intérêt. Trois ouvrages ont abordé récemment les questions agricoles, de diverse manière.
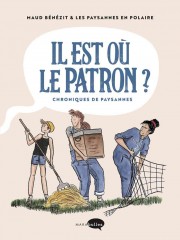 Il est où le patron ?, Maud Bénézit et les Paysannes en polaire, Marabout, 2021, 176 pages, 19,50 €
Il est où le patron ?, Maud Bénézit et les Paysannes en polaire, Marabout, 2021, 176 pages, 19,50 €
Suite à des rencontres entre femmes du milieu agricole, les « Paysannes en polaire » ont mis en récit leurs histoires singulières grâce à la dessinatrice (et agronome de formation) Maud Bénézit. Éleveuses de chèvres et de brebis, apicultrices et maraîchères dans le Sud-Est, elles s’inventent trois alter ego de fiction confrontées au sexisme en agriculture, une profession à 75 % masculine et où les femmes sont souvent des épouses, avec des statuts inégaux (conjointe collaboratrice, aidante familiale, cheffe d’exploitation après le départ à la retraite du mari). Du parcours d’installation au travail lui-même, elles sont souvent renvoyées à des rôles qui complètent le travail des hommes, jugé central. À elles la transformation des produits, l’accueil, la vente, la compta et le travail ménager et familial qui libèrent les hommes des « vraies » activités, la production. D’où la question, quand un collègue arrive sur une ferme : il est où le patron, l’homme, celui-là dont le travail compte « vraiment » ? On retrouve dans ce livre le propos d’autres groupes de femmes, qui éclosent depuis quelques années, notamment dans le monde agricole alternatif. Ces groupes interrogent les questions d’ergonomie en inventant des outils (comme le porte-piquet à roulettes), là où des générations d’agriculteurs ont trouvé plus simple de se casser le dos et de souffrir en silence. Il y est aussi question de la place des femmes dans les instances agricoles (y compris les syndicats en rupture avec le modèle dominant) mais aussi, plus globalement, de violences conjugales et de dynamiques de couple dans un contexte hétérosexiste – même si tous les personnages de paysannes ne sont pas hétéros. Une belle introduction à ces thèmes qui surgissent aujourd’hui en agriculture et qui font l’objet de travaux dans les structures paysannes et rurales.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 6 décembre, 2021
Par Aude le lundi, 6 décembre, 2021, 20h13 - Lectures
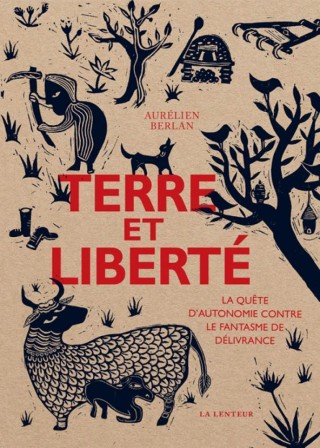 Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Le constat par lequel commence la démonstration d’Aurélien Berlan, c’est celui d’une « liberté dans le coma » : pourquoi la révélation que les États surveillent les communications de leurs citoyen·nes ne nous a-t-elle pas plus ému·es que ça ? Parce que nous le savions déjà ou parce que cette liberté-là, celle d’avoir une vie vraiment privée, ne nous importe pas tant ? Les classiques du libéralisme mettaient pourtant au-dessus de tout les libertés individuelles : d’opinion, d’expression, de mouvement, d’association, de faire des choix de vie qui nous appartiennent et accessoirement ne pas être surveillé·e. Cette liberté-là s’est construite contre des droits politiques à exercer collectivement, comme la souveraineté politique. L’auteur reprend dans les détails la pensée de Benjamin Constant (le théoricien de la liberté de ne se mêler que de ses propres affaires et d’abandonner à d’autres le gouvernement de la cité) pour affirmer qu’au fond, cette liberté des libéraux est la délivrance des exigences du quotidien : être au chaud sans couper du bois (ou au frais sans avoir planté d’arbre), repu·e sans avoir cultivé ni préparé sa nourriture, pouvoir se détacher de son lieu de vie, etc. Délivrance qui inclut également de ne plus avoir se soucier de politique, ne plus s’engager publiquement.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 7 novembre, 2021
Par Aude le dimanche, 7 novembre, 2021, 18h47 - Textes
Voilà une expression que j’entends beaucoup quand il est question d’agriculture et d’alimentation : « On vote avec son portefeuille. » Manière de dire que même si des choix politiques concernant l’agriculture nous échappent, on a toujours un second tour au moment d’aller faire ses courses, pour réparer les dégâts d’une alimentation qui constitue environ un quart de notre empreinte carbone et d’innombrables atteintes au milieu. Sans compter les transports de marchandises alimentaires, leur stockage et leur transformation, l’agriculture est fortement émettrice de gaz à effet de serre, quand bien même les recherches agronomiques et les pratiques paysannes sauraient refermer les cycles du carbone en produisant autrement. Elle n’émet pas seulement le fameux méthane des ruminants mais aussi les gaz produits par les engrais azotés, de la fabrication à base d’hydrocarbures à l’épandage dans les champs (1), entre autres (au niveau mondial, il faut également prendre en compte la déforestation ou changement d’affectation des sols). Elle est en outre consommatrice nette d’énergie alors qu’elle est plutôt supposée en produire, magie de la photosynthèse : aux USA il faut déjà 7 calories d’énergies fossiles pour produire une (1) calorie d’aliment. Et ne mentionnons pas les atteintes à la santé humaine et à la faune sauvage. Mais tout va bien, vous pouvez éviter tout ça avec votre petit caddie !
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 23 août, 2021
Par Aude le lundi, 23 août, 2021, 20h22 - Lectures
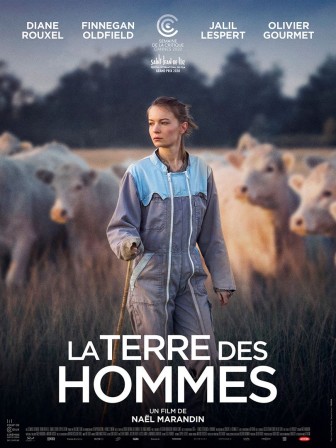 Naël Marandin, La Terre des hommes (2020), avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet
Naël Marandin, La Terre des hommes (2020), avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet
Sortie le 25 août 2021
Il est question de viol dans cette chronique.
Constance est fille d’éleveur dans le Charolais et voudrait reprendre, avec son fiancé, la ferme de son père. Mais quand son père fait faillite et n’est plus en mesure de transmettre l’exploitation, le projet d’installation de la jeune femme est mis en difficulté. Les Safer, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont des structures co-gérées par la profession et l’État pour réguler le foncier agricole. C’est devant une commission de la Safer locale que Constance devra montrer la solidité de son dossier et sa capacité à reprendre la ferme familiale – sur laquelle lorgne le voisin agriculteur, qui vient déjà visiter les lieux comme s’ils lui appartenaient. Jeune femme (heureusement en couple avec un homme (1)), désireuse de pratiquer un élevage plus respectueux des bêtes et de l’environnement, mais aussi plus rémunérateur, elle a un projet « atypique ». Aussi, quand un membre de la commission, un quadragénaire influent dans le milieu agricole et connaissance de longue date, lui propose de l’aide, elle l’accepte.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 15 août, 2021
Par Aude le dimanche, 15 août, 2021, 20h27 - Lectures
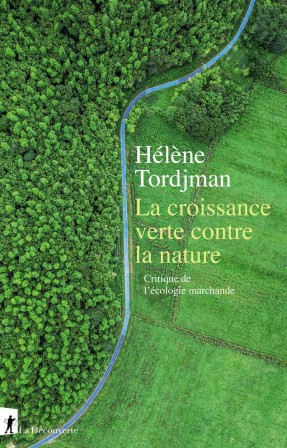 Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
La Croissance verte contre la nature est certainement le plus grand livre d’écologie de l’année. L’économiste Hélène Tordjman s’y attaque aux évolutions de la technologique et du capitalisme et à leur nouvelle prise en compte des questions environnementales. Entamé il y a moins de vingt ans, ce virage « vert » n’entend pas sortir de l’ornière productiviste mais ses innovations sont désormais accompagnées de justifications écologiques. Tordjman documente donc plusieurs dossiers pour tenter d’en comprendre les racines idéologiques et les logiques économiques.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 9 mars, 2021
Par Aude le mardi, 9 mars, 2021, 16h02 - Lectures
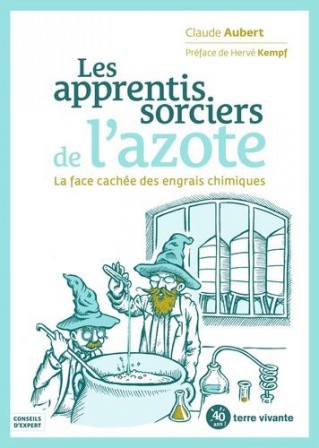 Claude Aubert, Les Apprentis sorciers de l’azote. La Face cachée des engrais chimiques, Terre vivante, 2021, 144 pages, 15 €
Claude Aubert, Les Apprentis sorciers de l’azote. La Face cachée des engrais chimiques, Terre vivante, 2021, 144 pages, 15 €
Chaque année au printemps, c’est la saison des épandages agricoles. Une pollution mal connue qui pourtant est responsable de la présence dans l’air, entre autres, de particules fines PM 2,5 (de moins de 2,5 micromètres). Ces particules fines provoquent chaque année des morts prématurées mais elles sont aussi mises en cause pour l’aggravation de maladies respiratoires transmissibles, dont le Covid. Le confinement du printemps 2020, qui a vu une baisse jamais observée auparavant des transports, a été l’occasion de constater l’impact spécifique de notre agriculture, dû notamment aux engrais azotés. Et alors que les autres pollutions de l’air baissent depuis quelques décennies, celles-ci restent stables. C’est à ce problème et à d’autres que l’agronome Claude Aubert, pionnier de l’agriculture bio, consacre un ouvrage simple, clair et joliment illustré.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 23 janvier, 2021
Par Aude le samedi, 23 janvier, 2021, 13h47 - Lectures
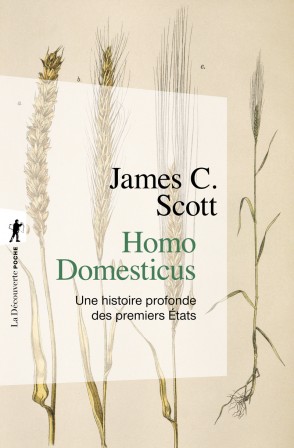 James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 €
James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 €
C’est un récit classique, celui d’une humanité qui se dirige de manière continue vers son accomplissement. Jadis sans État ni agriculture, nos ancêtres découvrirent enfin comment planter des céréales puis comment s’organiser dans des formes politiques de plus en plus complexes. James C. Scott va à rebrousse-poil (against the grain en anglais, c’est aussi le titre original du livre) de cette histoire en présentant un tableau beaucoup plus critique des premiers États et de l’hésitation entre sociétés avec ou sans État. Car il ne s’agit déjà pas d’une histoire linéaire. Les individus qui vivent sous un État peuvent s’en libérer et les États eux-mêmes s’effondrer – sans que les individus qui y vivaient ne s’en trouvent plus mal.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 16 août, 2020
Par Aude le dimanche, 16 août, 2020, 17h21 - Malaisie et Indonésie
 Au bout d’une heure de piste entre les plantations de palmiers à huile, nous voilà enfin sur une route goudronnée, au milieu de la forêt. Les panneaux avertissent de possibles passages d’éléphants et leurs excréments encore frais au milieu de la chaussée confirment cette présence. L’entrée du parc naturel national d’Endau-Rompin, le deuxième plus grand de Malaisie occidentale derrière l’emblématique Taman Negara, est au bout de la route, à côté d’un village autochtone jakun, population autochtone du sud de la péninsule Malaise. Les maisons sont modestes, les environs plantés d’arbres et les habitant·es sillonnent le village sur leurs scooters. Nous sommes à Kampung Peta, le village le plus en amont de la rivière Endau qui se jette dans la mer de Chine méridionale, au sud de la péninsule.
Au bout d’une heure de piste entre les plantations de palmiers à huile, nous voilà enfin sur une route goudronnée, au milieu de la forêt. Les panneaux avertissent de possibles passages d’éléphants et leurs excréments encore frais au milieu de la chaussée confirment cette présence. L’entrée du parc naturel national d’Endau-Rompin, le deuxième plus grand de Malaisie occidentale derrière l’emblématique Taman Negara, est au bout de la route, à côté d’un village autochtone jakun, population autochtone du sud de la péninsule Malaise. Les maisons sont modestes, les environs plantés d’arbres et les habitant·es sillonnent le village sur leurs scooters. Nous sommes à Kampung Peta, le village le plus en amont de la rivière Endau qui se jette dans la mer de Chine méridionale, au sud de la péninsule.
La suite sur le site de Visions carto.
aucun rétrolien
mardi, 19 novembre, 2019
Par Aude le mardi, 19 novembre, 2019, 11h56 - Lectures
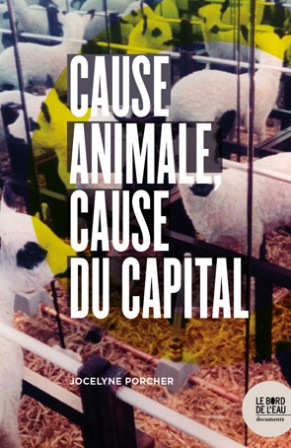 Cause animale, cause du capital, Jocelyne Porcher, Le
Bord de l'eau, Lormont, 120 pages, 12 €
Cause animale, cause du capital, Jocelyne Porcher, Le
Bord de l'eau, Lormont, 120 pages, 12 €
Make the world a better place… Rendre le monde meilleur, c'est
l'objectif bien connu des start-ups qui préparent des initiatives disruptives
permettant au capitalisme d'effectuer les transitions nécessaires à sa survie –
malgré les trous qu'il creuse et les impasses qu'il emprunte. Jocelyne Porcher
n'y va donc pas par quatre chemins et peint pour introduire son ouvrage le
paysage économique et financier de la « viande » in vitro ou
« viande » de culture cellulaire, cette innovation qui devrait
permettre à terme de cesser de manger des animaux. Ce qu'on appelle
« agriculture cellulaire » semblait fou il y a encore quelques années
mais le kilo de « viande » cultivée en labo à partir de cellules
animales devrait dans les mois qui viennent être assez bas pour que le steak in
vitro apparaisse dans les restaus branchés (1). Suite à ce premier chapitre, la
sociologue, spécialiste de la relation humain-animal, déplie son propos :
d'où vient que c'est aujourd'hui que surgit cette préoccupation massive pour le
bien-être des animaux ? C'est parce que les alternatives aux productions
animales industrielles (responsables de la pollution des eaux et de l'air, de
l'emprise sur les terres via l'aliment du bétail, de problèmes sanitaires et
qui accessoirement ont des rendements économiques en baisse), ces alternatives
sont prêtes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
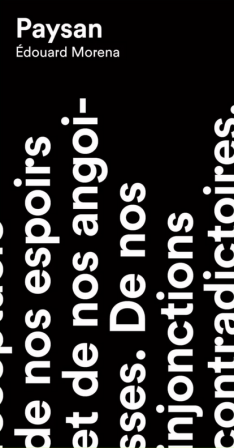 Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €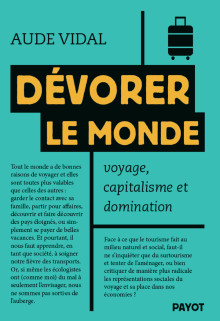 Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 €
Aude Vidal, Dévorer le monde. Voyage, capitalisme et domination, Payot, 2024, 192 pages, 18 € Tout le monde aime les arbres. Même Macron. Et pour cause, en dehors de leur valeur intrinsèque, leurs bénéfices pour les êtres humains sont nombreux. En ville les arbres améliorent la qualité de l’air en capturant le CO2 et relâchant de l'oxygène. Ils apportent une ombre bien plus fraîche (1) que celle des « ombrelles » en béton qui les ont parfois remplacés (2). L’absence d’arbres et des espaces trop minéraux provoquent au contraire des îlots de chaleur insupportables lors des périodes caniculaires toujours plus nombreuses. Les arbres à feuilles caduques ont même le bon goût de se dévêtir l’hiver, quand les maisons ont besoin des apports du soleil pour se réchauffer, et c’est l’un des principes de l’
Tout le monde aime les arbres. Même Macron. Et pour cause, en dehors de leur valeur intrinsèque, leurs bénéfices pour les êtres humains sont nombreux. En ville les arbres améliorent la qualité de l’air en capturant le CO2 et relâchant de l'oxygène. Ils apportent une ombre bien plus fraîche (1) que celle des « ombrelles » en béton qui les ont parfois remplacés (2). L’absence d’arbres et des espaces trop minéraux provoquent au contraire des îlots de chaleur insupportables lors des périodes caniculaires toujours plus nombreuses. Les arbres à feuilles caduques ont même le bon goût de se dévêtir l’hiver, quand les maisons ont besoin des apports du soleil pour se réchauffer, et c’est l’un des principes de l’

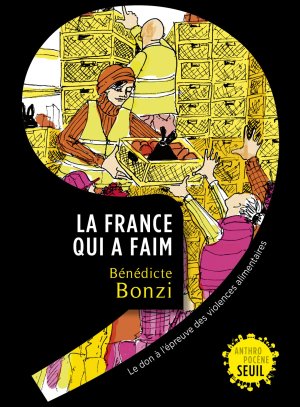 Bénédicte Bonzi, La France qui a faim. Le Don à l'épreuve des violences alimentaires, Seuil, 2023, 448 pages, 22 €
Bénédicte Bonzi, La France qui a faim. Le Don à l'épreuve des violences alimentaires, Seuil, 2023, 448 pages, 22 €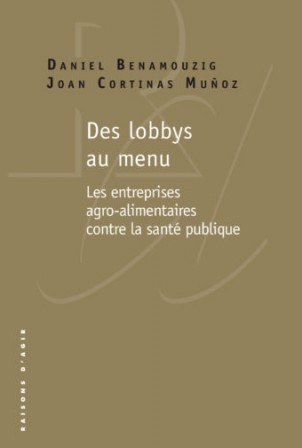 Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’agir, 2022, 176 pages, 9 €
Daniel Benamouzig et Joan Cortinas Muñoz, Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’agir, 2022, 176 pages, 9 €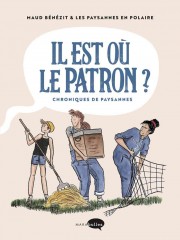 Il est où le patron ?, Maud Bénézit et les Paysannes en polaire, Marabout, 2021, 176 pages, 19,50 €
Il est où le patron ?, Maud Bénézit et les Paysannes en polaire, Marabout, 2021, 176 pages, 19,50 €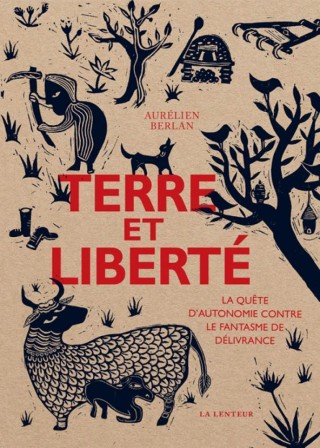 Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €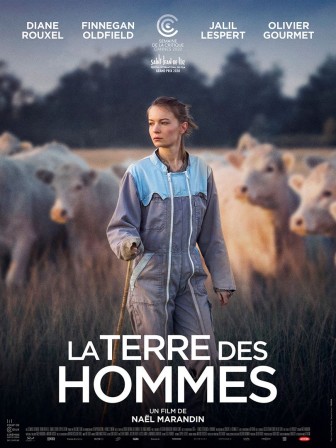 Naël Marandin, La Terre des hommes (2020), avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet
Naël Marandin, La Terre des hommes (2020), avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert et Olivier Gourmet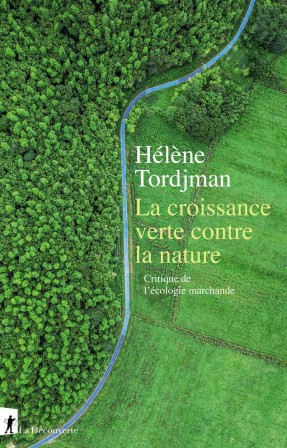 Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €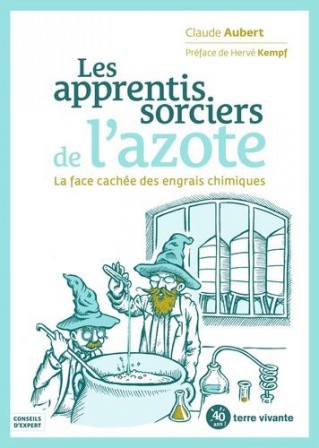 Claude Aubert, Les Apprentis sorciers de l’azote. La Face cachée des engrais chimiques, Terre vivante, 2021, 144 pages, 15 €
Claude Aubert, Les Apprentis sorciers de l’azote. La Face cachée des engrais chimiques, Terre vivante, 2021, 144 pages, 15 €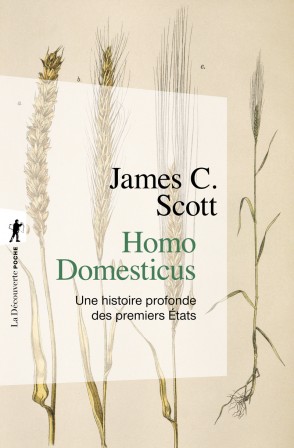 James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 €
James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 € Au bout d’une heure de piste entre les plantations de palmiers à huile, nous voilà enfin sur une route goudronnée, au milieu de la forêt. Les panneaux avertissent de possibles passages d’éléphants et leurs excréments encore frais au milieu de la chaussée confirment cette présence. L’entrée du parc naturel national d’Endau-Rompin, le deuxième plus grand de Malaisie occidentale derrière l’emblématique Taman Negara, est au bout de la route, à côté d’un village autochtone jakun, population autochtone du sud de la péninsule Malaise. Les maisons sont modestes, les environs plantés d’arbres et les habitant·es sillonnent le village sur leurs scooters. Nous sommes à Kampung Peta, le village le plus en amont de la rivière Endau qui se jette dans la mer de Chine méridionale, au sud de la péninsule.
Au bout d’une heure de piste entre les plantations de palmiers à huile, nous voilà enfin sur une route goudronnée, au milieu de la forêt. Les panneaux avertissent de possibles passages d’éléphants et leurs excréments encore frais au milieu de la chaussée confirment cette présence. L’entrée du parc naturel national d’Endau-Rompin, le deuxième plus grand de Malaisie occidentale derrière l’emblématique Taman Negara, est au bout de la route, à côté d’un village autochtone jakun, population autochtone du sud de la péninsule Malaise. Les maisons sont modestes, les environs plantés d’arbres et les habitant·es sillonnent le village sur leurs scooters. Nous sommes à Kampung Peta, le village le plus en amont de la rivière Endau qui se jette dans la mer de Chine méridionale, au sud de la péninsule.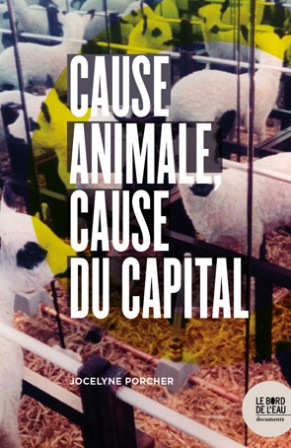 Cause animale, cause du capital, Jocelyne Porcher, Le
Bord de l'eau, Lormont, 120 pages, 12 €
Cause animale, cause du capital, Jocelyne Porcher, Le
Bord de l'eau, Lormont, 120 pages, 12 €