La Croissance verte contre la nature
Par Aude le dimanche, 15 août, 2021, 20h27 - Lectures - Lien permanent
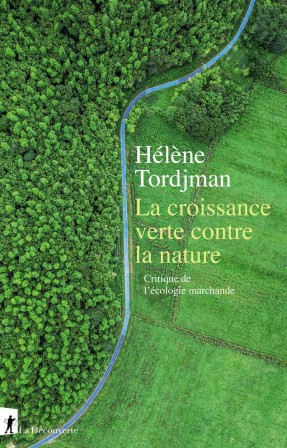 Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
La Croissance verte contre la nature est certainement le plus grand livre d’écologie de l’année. L’économiste Hélène Tordjman s’y attaque aux évolutions de la technologique et du capitalisme et à leur nouvelle prise en compte des questions environnementales. Entamé il y a moins de vingt ans, ce virage « vert » n’entend pas sortir de l’ornière productiviste mais ses innovations sont désormais accompagnées de justifications écologiques. Tordjman documente donc plusieurs dossiers pour tenter d’en comprendre les racines idéologiques et les logiques économiques.
Au tournant du 21e siècle, la convergence NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, sciences de l’information et de la cognition) ouvre le champ à des ambitions démesurées en matière d’innovation technologique, comme la concurrence avec la nature que nous serions en capacité d’améliorer – comme nous améliorerons l’humanité. C’est justement à cette époque que, quelques décennies après les alertes lancées par les premiers écologistes se situant dans le champ politique (1), la question environnementale (surtout l’effet de serre) est enfin prise en considération par les élites politiques et économiques. Pourquoi ne pas se servir de ce nouveau champ de la connaissance et source de profits à venir pour y répondre ? Tordjman cite malicieusement un rapport de la National Science Foundation et du Department of Commerce états-uniens qui rend compte de ces espoirs fabuleux mais fait montre d’une grande méconnaissance de l’histoire de l’humanité. Les auteurs, brossant un tableau des progrès de l’esprit humain, décrivent le Moyen Âge comme une période de « chaos sanglant » et d’« ignorance généralisée » alors qu’il fut une période de grande émulation intellectuelle et scientifique dans les mondes arabes et indiens (bonjour l’ethnocentrisme) et que l’obscurantisme de l’Occident médiéval est un cliché très grossier, depuis longtemps mis en défaut par les historien·nes. C’est un détail mais qu’il me semble important de commenter pour illustrer cette autre convergence qui est l’objet de l’ouvrage, entre la science la plus avancée et la bêtise la plus crasseuse.
L’économiste ouvre donc plusieurs dossiers : les agrocarburants, les semences, la mesure des services écosystémiques et leur mise en marché grâce à une finance « verte ». Les agrocarburants, présents aujourd’hui à 20 % dans les réservoirs européens et qui devaient réduire d’autant la consommation de pétrole et l’émission de gaz à effet de serre, ont vite été remis en cause pour leur concurrence avec l’alimentation humaine. Des générations d’agrocarburants se sont succédé pour répondre, semble-t-il, à cette exigence minimale mais sans y parvenir. Car, qu’il s’agisse de cultures consommables dans l'alimentation, de produits issus du bois ou de sous-produits agricoles, les agrocarburants se heurtent toujours aux mêmes limites. On les doit à des monocultures industrielles qui dégradent les milieux et consomment des engrais de synthèse contribuant eux-mêmes fortement au changement climatiques. Ils sont également souvent cultivés sur d’anciennes forêts et ce changement d’affectation des sols lui-même est fortement émetteur. Et même les déchets ou sous-produits des dernières générations représentent une énergie en concurrence avec des usages agricoles (2). Enfin, et Tordjman cite à ce sujet l’historien François Jarrige, les innovations en matière d’énergie ne se substituent pas aux sources précédemment utilisées et viennent plutôt les compléter dans un panel énergétique en croissance globale (voir la place du charbon, qui depuis 1900 s’est contentée de stagner, dans ce schéma).
Même si les agrocarburants ne répondent pas à la demande qui leur est faite, d’une énergie plus propre pouvant se substituer au pétrole sans dégrader le milieu ni entrer en concurrence avec d’autres usages de l’agriculture, la recherche s’enfonce toujours plus loin dans l’impasse. En jeu, des intérêts économiques et des représentations qui refusent d’admettre qu’une baisse des émissions doive passer par une baisse des consommations d’énergie. Un imaginaire technophile se déploie aux dépens de la reconnaissance de limites naturelles. Hélène Tordjman prend dans sa démonstration un parti ellulien. Alors qu’André Gorz, penseur plus à la mode, entendait répondre à l’enjeu écologique en conjuguant les bénéfices de la technique et de la diminution de la consommation (efficacité et sobriété), elle lui préfère Jacques Ellul, penseur plus critique de la technique, ou Ivan Illich, le théoricien de la contre-productivité. « Chaque nouvelle technique, écrit-elle, pose de nouveaux problèmes qui appellent de nouvelles "solutions", ces dernières engendrant de nouveau des effets non anticipés qui appellent de nouvelles réponses… Ainsi la dynamique de l’innovation technique est-elle autoréférentielle, suit sa logique propre sans ancrage extérieur et répond essentiellement à des questions que la technique se pose à elle-même » (ainsi qu’aux exigences du capital).
Les semences font l’objet du chapitre suivant. Il y est question des dernières générations d’OGM, dont les multinationales qui les développent (3) mettent en avant le caractère naturel car aucun gène étranger n’y est introduit. Il s’agirait à les entendre de processus peu éloignés de la sélection, une pratique inséparable de l’agriculture. Pour ces OGM est donc demandé le droit de ne pas être tenus à des autorisations de mise sur le marché qui, il y a deux décennies en Europe, avaient entravé la circulation des générations précédentes. Mais par ailleurs le brevetage du vivant est entendu de manière de plus en plus souple. L’accord selon lequel ne pouvait être breveté dans le vivant que ce qui était inventé et non ce qui était découvert a déjà cédé et des découvertes font bel et bien l’objet de brevetage. Les plantes, quand bien même elles auraient été depuis longtemps découvertes par des communautés paysannes ou rurales, font l’objet de privatisations par les firmes qui peuvent se payer le travail de brevetage et dépossèdent ainsi l’humanité d’un patrimoine partagé. Tordjman livre, comme sur tous les autres sujets abordés dans le livre, un travail de documentation des stratégies des acteurs, de leurs discours, ainsi que des conséquences désastreuses d’un point de vue écologique et social.
Ces stratégies voient converger États, institutions internationales, multinationales mais aussi ONG (oui oui, elles aussi, et c'est sans compter d'autres écologistes également séduit·es par cette approche). Tordjman les dévoile sans se contenter de livrer des noms, comme font trop souvent les discours militants, elle s’attache bien aux faits, aux discours, aux logiques et aux représentations qui ont cours dans tous ces projets aussi complexes qu’est réductrice leur vision du monde naturel. Concernant les services écosystémiques, l’économiste donne l’exemple d’une savante étude proposant d’évaluer le travail des abeilles et autres pollinisateurs, soit les sommes de services que celles-ci nous rendent. La démarche choisie a été de compter le travail humain qui serait nécessaire pour polliniser artificiellement toutes les cultures présentes sur Terre… mais pas les plantes sauvages, exclues du calcul alors qu’elles nous permettent elles aussi d’avoir des conditions de vie acceptables – puisqu’il n’est question que de leur utilité. Tordjman remet ainsi en cause l’évaluation, le paiement (et la financiarisation (4)) des services écosystémiques à plusieurs titres : leur réductionnisme imbécile, comme on l’a vu ici ; la faiblesse de ces calculs qui visent l’exhaustivité et la précision sur des bases d’extrapolation et d’analogie rapide (qu’on donne le même objet à évaluer à deux équipes et elles produisent des calculs précis au dollar près mais sans commune mesure l’une avec l’autre) ; mais aussi l’idéologie très hostile à la nature qui refuse de lui accorder une valeur en soi, qui refuse la nécessité de la préserver pour ce qu’elle est et non ce que nous y trouvons. Et, au-delà de cet élément que l’on retrouve aujourd’hui chez beaucoup de penseurs et penseuses de l’écologie, Tordjman situe tout cela dans le cadre de rapports de classe, entre classes dominantes et humanité dépossédée, prolétarisée, dont le plus grand bonheur serait de consommer les produits de cette industrie.
Après tous ces constats, ce livre important se clôt sur quarante pages de manifeste pour une nouvelle agriculture. Au fil des pages on avait pu constater l’intérêt de l’autrice pour cette question fondamentale que représentent l’agriculture et l’alimentation, avec les agrocarburants et les OGM, la soumission du vivant aux logiques d’enclosure par les plus gros acteurs capitalistiques. La conclusion lui permet de répondre à la fameuse question (« mais qu’est-ce qu’on peut faire ? et par quoi commencer ? ») pour refermer un ouvrage par ailleurs accablant. Ici l’enquête poussée et rigoureuse sur les arcanes du pouvoir laisse la place à des pages d’un autre ton. Elle s’attache, dans la lignée d’Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, et de ses successeurs, à faire comprendre les bénéfices de l’agroécologie paysanne, souvent caricaturée comme une agriculture passéiste et inefficace. Tordjman aborde la question du foncier, fait connaître les propositions d’acteurs de la profession, comme ceux des semences paysannes, de la Sécurité sociale de l’alimentation, l’Atelier paysan dont elle reprend quelques-unes des analyses (elle mentionne leur ouvrage, Reprendre la terre aux machines, qui était encore à paraître). Ses propositions en matière de gouvernance sont moins satisfaisantes (elle reconduit la représentation, qui est au cœur du problème, mais avec révocabilité des élu·es) et elle propose pour l’agroécologie des paiements pour services environnementaux, tout en reconnaissant cette incohérence qui ne serait que temporaire (4). C’est la conclusion plus légère d’une enquête magistrale et qui analyse avec précision les causes et les effets de cette écologie de marché. Le greenwashing, ou traduction des questions écologiques dans des termes satisfaisant les classes dominantes et leur idéologie, fait l’objet ici d’une accusation particulièrement bien étayée.
(1) À faire des généalogies des théoricien·nes de l’écologie politique, on peut remonter plus haut que les années 1960 et 1970.
(2) Les méthaniseurs, de plus en plus présents sur les fermes françaises, sont d’autre part soupçonnés de ne pas consommer que des déchets mais également des produits agricoles qui pourraient entrer dans notre chaîne alimentaire, serait-ce sous la forme d’aliment du bétail. Un projet de très grand méthaniseur est l’occasion pour Amélie Poinssot de faire le point.
(3) Elles sont bien plus concentrées économiquement que dans les années 1990. Il n’y a plus désormais que deux grandes, l’une ayant déjà tenté d’acheter l’autre…
(4) Tordjman raconte par exemple que les critères des produits financiers « verts » ne tiennent pas leur qualité environnementale mais à la publicité faite à leur action, favorable ou toxique, envers le milieu…
(5) L’Atelier paysan dans Reprendre la terre aux machines (dont ma chronique est à paraître) s’appuie plutôt sur le refus du libre-échange et le conventionnement de la production dans la Sécurité sociale de l’alimentation pour encourager une agriculture mieux-disante environnementalement et socialement.