lundi, 3 mars, 2025
Par Aude le lundi, 3 mars, 2025, 20h35 - Textes
Il y a bientôt cinq ans, le 17 mars, nous étions confiné·es, coincé·es dans nos maisons pour les plus chanceux et chanceuses qui ont des maisons et n’ont pas été tenu·es de sortir faire marcher l’économie en s’entassant dans des métros aussi rares que bondés. Certain·es ont apprécié de rester en famille ou de faire leur jardin, d’autres se sont fait chier ou ont vécu huit semaines infernales, notamment celles et ceux étaient logé·es dans des appartement trop petits ou sans extérieur, étaient en prison ou en CRA. Une petite musique commence à s’imposer à propos de la période : franchement, on a été cons de se laisser confiner. Et de refaire le match en oubliant des petits détails. Le système hospitalier « risquait » la saturation ? Non, il était bien saturé, des tris ont été effectués entre patient·es et des personnes sont mortes chez elles sans soins. Le Monde diplomatique sort une carte des pires pays où passer mars-mai 2020 ? Aucun lien de cause à effet n’est esquissé entre la surmortalité importante et la dureté du confinement, il semble que ce soient simplement deux trucs pénibles alors que le deuxième a dans certains pays été une conséquence du premier. Le confinement ressemble à les entendre à un exercice parfaitement arbitraire de manipulation des foules.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 31 octobre, 2024
Par Aude le jeudi, 31 octobre, 2024, 10h38 - Lectures
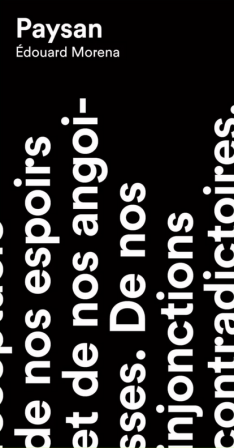 Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Paysan. La collection « Le mot est faible » propose de « s’emparer d’un mot dévoyé par la langue du pouvoir » et l’ouvrage d’Édouard Morena offre une belle illustration de cette démarche. Après une thèse consacrée à la Confédération paysanne, le politiste s’est consacré à l’étude des acteurs de la lutte contre le changement climatique, et notamment des philanthrocapitalistes (Fin du monde et petits fours, La Découverte, 2023). Il revient pour ce livre à la question paysanne suite au mouvement agricole de l’hiver 2024, qui vit tout un pays célébrer ses « paysans ». Dans l’interprétation de la gauche paysanne, la reprise par le Premier ministre Gabriel Attal du slogan « Pas de pays sans paysan » était une simple récupération, alors que par ailleurs le gouvernement s’engageait dans le soutien à une agriculture de plus en plus capitalisée et concentrée économiquement. Morena propose de refaire l’histoire du mot pour comprendre les affinités de la figure du paysan avec la droite comme avec la gauche, avec les milieux conservateurs comme avec les modernisateurs et les progressistes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 27 octobre, 2024
Par Aude le dimanche, 27 octobre, 2024, 16h44 - Textes
Je ne compte plus les organisations et les événements qui mettent en avant des valeurs antivalidistes tout en passant sous silence l’existence d’une maladie infectieuse potentiellement handicapante et immédiatement dangereuse pour certaines catégories de personnes. Un syndicat qui affirme l’antivalidisme comme une de ses priorités des prochaines années alors que depuis 2022 le port du masque n’est recommandé ni dans ses locaux ni dans les formations qu’il organise. Des festivals féministes qui se mettent en quatre pour assurer l’accessibilité aux personnes en fauteuil ou qui marchent difficilement, aux personnes sourdes qui se voient proposer sous-titres spécifiques ou traduction simultanée en LSF mais aucune information n’est fournie en amont de l’événement sur ce qui sera fait pour s’assurer que le moins de monde possible rentre chez soi avec le Covid.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 6 septembre, 2024
Par Aude le vendredi, 6 septembre, 2024, 08h36 - Lectures
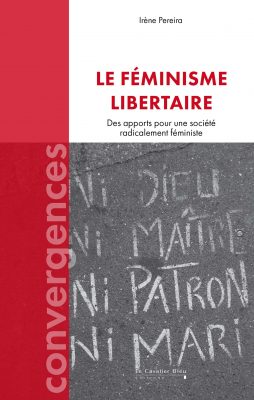 Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €
Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €
Irène Pereira, autrice de travaux sur l’anarchisme et sur les pédagogies critiques, propose un livre bienvenu sur le féminisme libertaire. Si l’anarchisme et le féminisme sont des mouvements anciens, qu’on peut dater de la deuxième moitié du XIXe siècle, il n’en est pas de même de l’anarcha-féminisme ou féminisme libertaire, qui s’est constitué dans les années 1970. L’anarchisme a pu être féministe (ou pas, le misogyne Proudhon n’a pas été un cas isolé) avant cela, ce que Pereira rappelle à propos de plusieurs autrices et auteurs pour qui le féminisme en tant que tel était un engagement bourgeois mais qui se sont engagé·es en anarchistes pour l’égalité femmes-hommes. Au fil de cette histoire par petites touches de l’anarchisme, et d’un rapide tour d’horizon contemporain, apparaissent quelques questions qui furent objets de discussion d’une période à l’autre : les libertés amoureuses, sexuelles et reproductives, la prostitution.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 3 juin, 2024
Par Aude le lundi, 3 juin, 2024, 20h56 - Textes
Il y a quelques mois a été publié un pamphlet anonyme dénonçant le « naufrage réactionnaire du mouvement anti-industriel ». Mouvance à laquelle j’estime appartenir (entre autres affiliations) et pamphlet dans lequel un de mes écrits fait référence… Je ne sais pas si c’est une position spécialement confortable ou au contraire inconfortable mais le fait est que je n’ai pas ressenti l’intérêt de m’exprimer à ce sujet. Les camarades du collectif anti-autoritaire et technocritique Ruptures l’ont fait et même si, probablement, nous ne sommes pas parfaitement aligné·es sur tout leur réponse me semble devoir clore le débat en rappelant d’une part que leur militantisme consiste non pas en une recherche de la pureté mais en la construction d’alliances pour lutter à la fois contre le « déferlement technologique » et le « raidissement autoritaire du pouvoir » (deux objets souvent réunis, qu’on pense aux technologies de surveillance) et d’autre part que ni la lutte sociale, contre les inégalités et les oppressions, ni la lutte technocritique pure n’ont pour elles et eux de sens si elles ne sont pas fermement liées l’une à l’autre.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 22 avril, 2024
Par Aude le lundi, 22 avril, 2024, 08h48 - Textes
Même si lafemme est l’avenir de l’homme, c’est moins sur nous que sur les hommes que sont projetées nombre d’attentes concernant le recul espéré du sexisme. Comme si nous ne faisions que notre boulot ingrat de féministes, tandis qu’eux sont des forces telluriques. Hommes proféministes, à la masculinité non hégémonique, non binaires (1), ce sont eux qui vont sauver le monde. Engagements contre le sexisme, participation à la création de savoirs sur le genre et les sexualités, renouvellement des représentations sur ce qu’est un homme et légitimation de formes de masculinités diverses et plus respectueuses des femmes, voilà tout ce que nous leur devons.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 8 mars, 2024
Par Aude le vendredi, 8 mars, 2024, 13h49 - Textes
Il me semble important de critiquer les camarades, non par plaisir égocentrique et pour se mettre en valeur à leurs dépens mais parce que toutes les stratégies peuvent être interrogées et que personne n’est à l’abri d’une dérive. Les critiques du camp opposé, par leur violence, leur injustice ou leurs présupposés biaisés, tendent plutôt, et c’est compréhensible, à conforter celle ou celui qui les essuie qu’à susciter un peu de remise en cause. Au contraire, une critique « amie » doit faire surgir des questionnements, rappeler des exigences partagées… et accessoirement être cordiale et éviter la personnalisation.
Ce billet n’est pas une critique amie.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 19 novembre, 2023
Par Aude le dimanche, 19 novembre, 2023, 10h56 - Lectures
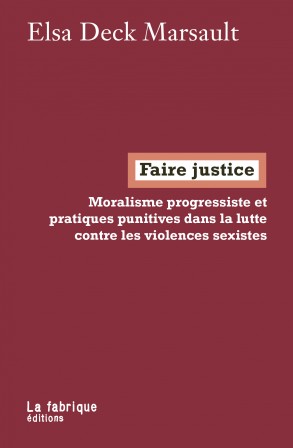 Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La Fabrique, 2023, 168 pages, 13 €
Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La Fabrique, 2023, 168 pages, 13 €
Les milieux les plus radicaux que je fréquente ou que j’ai fréquentés ont du mal à proposer une critique très acérée de la justice telle qu’elle est couramment pratiquée. Une fois l’État accusé de maintenir une « justice de classe », les arguments se font rares. C’est certes un gros morceau, que de comprendre, documenter et expliquer comment la justice est rendue en faveur des classes dominantes, de la répression des classes exploitées (émeutiers, Gilets jaunes) jusqu’aux affaires familiales (« tribunal des couples » qui paupérise les femmes ou difficile prise en compte des violences sexuelles contre les femmes et les enfants), et sert surtout à préserver un ordre fondamentalement injuste (1). Mais il reste encore à penser la place des victimes, utilisées à l’occasion mais toujours dans l’intérêt de l’État (réparer les torts qui leur sont faits est la dernière préoccupation des juges alors que ce devrait être la première) ou la vision de l’être humain qui sous-tend le système judiciaire (au mieux à réformer, au pire à exclure du corps social tel une mauvaise tumeur), toutes les idées souvent pourries mais parfois intéressantes (2) qui font la justice d’État.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 4 novembre, 2023
Par Aude le samedi, 4 novembre, 2023, 09h10 - Textes
Je suis bénévole dans un festival de cinéma qui tient à une non-mixité aujourd’hui devenue moins courante. Alors que bon nombre d’espaces non-mixtes sont « sans mecs cis(genre) », soit adoptent une non-mixité queer, nous tenons à être un lieu pour « les femmes et les lesbiennes » (1). Depuis vingt ans que je connais le festival, toutes les femmes y sont les bienvenues, cisgenre ou transgenre. J’apprécie le fait que chaque groupe puisse bâtir un espace qui correspond à ses aspirations et que diverses définitions de la non-mixité cohabitent, qu’on ne standardise pas les pratiques militantes. Ce festival réunit des festivalières très diverses, de tous âges, venues de tout le pays, avec des positionnements politiques différents qui se frottent parfois. L’an dernier un tag sur le mur externe du lieu disait : « Festival transphobe ». Cette année ce sont des « lesbiennes pas queer » tout aussi courageuses et anonymes qui ont pris la parole de cette manière très déplaisante pour faire connaître leurs reproches. Ça veut peut-être dire que le festival n’est pas monolithique et ces attaques sont une reconnaissance de la diversité qui y a cours.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 1 octobre, 2023
Par Aude le dimanche, 1 octobre, 2023, 21h24 - Lectures
 Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €
Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €
Autour de vous, beaucoup ont peut-être choisi de déserter leur emploi dans le tertiaire pour en exercer un autre « qui a du sens » dans l’artisanat ou l’agriculture et sortir du salariat. Peut-être même faites-vous partie de ces déserteurs et déserteuses qui depuis quelques années font parler d’elles et d’eux, avec des pics d'attention inattendus.
Anne Humbert, ingénieure non déserteuse, a choisi de consacrer un livre au phénomène (encore un) mais celui-ci prend le parti de le critiquer, à partir d’échanges avec des ami·es ayant déserté et de lectures qui vont de la grande presse à des auteurs comme le sociologue Richard Sennet, critique de la standardisation du travail. Outre quelques articles, comme celui-ci dans Lundi matin, cette option reste à ma connaissance assez peu conventionnelle dans les milieux alternatifs plus ou moins radicaux subjugués par la notion de désertion (Reporterre a, selon Humbert, consacré vingt-et-un articles au discours des étudiant·es qui bifurquent d’AgroParisTech). Ces trajectoires ont suscité plus d’intérêt que le « refus de parvenir » auquel était consacré il y a quelques années un excellent bouquin, toujours disponible.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 8 septembre, 2023
Par Aude le vendredi, 8 septembre, 2023, 07h40 - Textes
On ne peut pas séparer l’homme de l’artiste, dit-on. Au-delà de la simple volonté de punir des méfaits qui ne l’ont pas été et de porter atteinte au succès d’un artiste par ailleurs méchant homme, il y a l’idée que l’œuvre tout entière respire le vice reproché à son auteur. Est-ce si vrai ? Si c’était le cas, toute la série de J.K. Rowling, tout le monde de fiction qu’elle a créé autour d’une école de sorcellerie, transpirerait la haine des femmes trans qu’on attribue à l’autrice, celle dont on ne prononce plus le nom. Or il m’a été plus d’une fois donné de constater que pour les fans de Harry Potter qui sont trans ou soutiennent les personnes trans dans leur lutte contre un carré de féministes, en nul cas cet univers fictionnel ne devait être banni de leurs étagères. Il continue à être lu, à offrir des références, à être exploité commercialement – et de quelle manière ! L’œuvre continue à être révérée mais sur l’artiste tombent des foudres qui vont jusqu’à invisibiliser sa maternité de l’œuvre, voire, mais c’est pour rire, à l’attribuer à un homme. Vous savez, Harry Potter à l'école des sorciers, le livre de Daniel Radcliffe. Certes tout le monde sait que le type en question avait 8 ans quand le bouquin est paru mais est-ce si drôle de matilder une autrice pour la simple raison qu’on est opposée à son propos ? Tellement de femmes ont été spoliées de leur œuvre, en leur temps ou pour la postérité, que le phénomène a été identité sous le nom d’effet Matilda.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 15 août, 2023
Par Aude le mardi, 15 août, 2023, 17h26 - Textes
Cette année je suis membre dans des collectifs militants de deux commissions qui ont chacune pour objectif de défricher des prises de position sur des questions délicates. J’ai été encouragée à y participer au motif qu’il faut y assurer un peu de diversité politique et que peu de personnes ont envie de s’y coller quand elles savent ne pas défendre la position qu’il est de bon ton d’avoir. J’ai prouvé ma capacité à défendre des positions minorisées, à ne pas répéter la doxa et à mettre le doigt sur les questions qui fâchent. Ça ne m’a pas empêchée d’y aller la boule au ventre en raison des violences symboliques qui se jouaient dans ces réunions.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 15 mai, 2023
Par Aude le lundi, 15 mai, 2023, 08h08 - Lectures
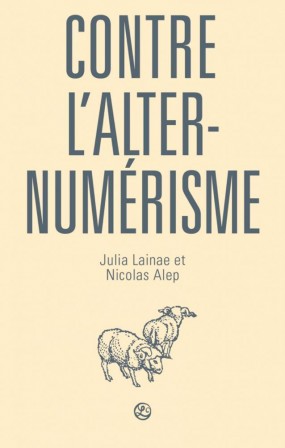 Julia Laïnae, Nicolas Alep, Contre l'alternumérisme, La Lenteur (2020), 2023, 144 pages, 10 €
Julia Laïnae, Nicolas Alep, Contre l'alternumérisme, La Lenteur (2020), 2023, 144 pages, 10 €
Je reprends ici la chronique, parue juste avant la crise sanitaire, d'un ouvrage republié ce mois-ci.
Julia Laïnae et Nicolas Alep tapent large en consacrant un petit livre à l'« alternumérisme ». Large mais toujours juste, car chaque cible est précisément définie et sa contribution à une « autre informatisation possible » fait l'objet d'une critique sérieuse et bien documentée. Des utopistes d'Internet aux inquiet·es des écrans, ces tendances ont ceci en commun qu'elles ne refusent ni les outils numériques, ni leur omniprésence dans la vie sociale, mais souhaitent en encadrer l'usage. Voyons plutôt.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 23 avril, 2023
Par Aude le dimanche, 23 avril, 2023, 11h29 - Textes
Il y a quelques jours, dans un groupe féministe, nous avons déplié un paragraphe de notre manifeste qui reprenait le slogan « Mon corps, mon choix ». J’avais émis quelques doutes sur cette formulation car si entendue comme un appel à la liberté reproductive et sexuelle des femmes elle fait consensus, elle contient aussi tout un monde contre lequel, en tant que féministes au sein d’un syndicat de transformation sociale, nous luttons. Enfin, j’espère.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 15 mars, 2023
Par Aude le mercredi, 15 mars, 2023, 12h39 - Textes
Samedi dernier à la manif, l’ambiance était morose dans le cortège contre la réforme des retraites. Et dans les conversations des gens qui ne prennent pas la peine de venir, j’entends beaucoup cet argument selon lequel la question se réglera lors des prochaines élections. Comme si les élections ne se jouaient pas sur d’autres sujets. Comme si la rue ne gouvernait pas à partir du moment où un mandat était accordé par une élection. Dans la tête de beaucoup de monde, l’élection dresse la feuille de route du gagnant de la course à l’échalote et des mini-gagnant·es de la mini-réplication en 577 exemplaires. D’ailleurs, pour une fois, la réforme majeure du quinquennat était annoncée (d’habitude ils ne prennent pas cette peine, en 2017 par exemple un vague programme macroniste avait été improvisé trois semaines avant le scrutin). Une fois n’est pas coutume, elle l’a été en 2022, en pire, puisqu’elle prévoyait un départ à la retraite à 65 ans. En théorie, donc, les personnes qui ont comme moi voté pour empêcher l’accession au pouvoir de pire encore ont plébiscité cette réforme qu’aujourd’hui une majorité écrasante refuse… et refusait déjà durant la campagne électorale (1).
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 26 septembre, 2022
Par Aude le lundi, 26 septembre, 2022, 08h26 - Textes
C’est un air connu, que les marionnettes du jeu électorat se remettent à siffler quand elles s’inquiètent qu’on les ait oubliées. Fabiend’chez nous Roussel et sainte Sandrine Rousseau, deux héros de la défaite de la gauche en Hauts-de-France qui se sont imposé·es dans l’arène nationale, remettent le couvert sur la question de la consommation de viande. Rousseau, qui n’était pas végétarienne la dernière fois que j’ai mangé avec elle, renforce son image d’écoféministe en dénonçant une consommation masculine de viande qui détruit la planète. Sur le fond, le propos est assez juste : la manière dont sont associées la consommation de viande et la masculinité, la chasse, la prédation, la force physique et même la couleur rouge (1), dite aussi virilo-carnisme ou carno-phallogocentrisme pour faire plus simple, est une représentation sociale mise en lumière depuis plusieurs décennies et qui explique encore aujourd’hui la consommation différenciée de viande entre femmes et hommes (2). La journaliste féministe Nora Bouazzouni a d’ailleurs produit récemment deux ouvrages éclairants et bien argumentés sur le sujet, Faiminisme et Steaksisme (Nouriturfu, 2017 et 2021). Roussel, qui drague un électorat en tout point opposé, en a profité pour faire son apologie des vraies valeurs françaises, vin, viande et fromage.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 8 juillet, 2022
Par Aude le vendredi, 8 juillet, 2022, 08h51 - Textes
Deux ans après les mensonges sur les masques, que le gouvernement n’avait pas pris la peine de provisionner en masse malgré les multiples alertes de virus se transmettant par voie d’air, les autorités ont été jugées fautives par le Conseil d’État. Mais aucune responsabilité n’a été précisément établie concernant les personnes mortes des conséquences de leur action car après tout c’est aussi la faute à pas de chance quand on chope le Covid et parce que les dites autorités ont quand même montré leur bonne volonté pour lutter contre l’épidémie en promouvant largement la distanciation physique et le lavage des mains. Voilà qui pose problème. Car la distanciation physique et le lavage des mains ne contribuent pas vraiment à la réduction des risques Covid. Pire, les efforts qui leur sont dédiés sont divertis du cœur du problème : la transmission par aérosols, qui nécessite port du masque et aération des locaux. Et depuis deux ans et demie, ce cœur de la réduction des risques est sous-estimé ou ignoré et nous perdons « la bataille de l’air ».
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 29 mars, 2022
Par Aude le mardi, 29 mars, 2022, 17h53 - Lectures
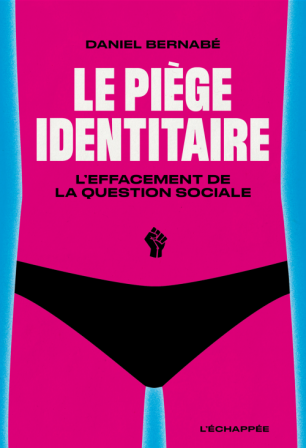 Le Piège identitaire. L’Effacement de la question sociale, Daniel Bernabé, traduit de l’espagnol par Patrick Marcolini avec Victoria Goicovich, L’Échappée, 312 pages, 20 €
Le Piège identitaire. L’Effacement de la question sociale, Daniel Bernabé, traduit de l’espagnol par Patrick Marcolini avec Victoria Goicovich, L’Échappée, 312 pages, 20 €
En 2018, le journaliste et essayiste Daniel Bernabé publiait en Espagne un ouvrage critique des tendances de la gauche à servir les besoins de reconnaissance des minorités tout en abandonnant toute prétention à lutter contre l’organisation socio-économique qui permet l’exploitation des travailleurs et travailleuses. Résumé comme ça, le livre semble rejoindre le lot de ces nombreuses imprécations moqueuses et convenues contre les « racialisateurs », les féministes post-modernes ou les poses de la bourgeoisie de gauche dans l’espace public. Mais l’exercice est bien plus subtil et cette publication, traduite et légèrement adaptée au contexte français de 2022 par Patrick Marcolini (1), est une réussite. Car il ne s’agit pas pour l’auteur de déclarer la nullité des demandes des groupes sociaux minorisés (femmes, personnes non blanches, LGBT, etc.) mais de les articuler à une critique sociale plus large et vigoureuse, celle d’un capitalisme en roue libre, qui ne rencontre plus guère d’opposition dans les sociétés européennes.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 25 janvier, 2022
Par Aude le mardi, 25 janvier, 2022, 09h12 - Textes
 Écrire et publier, sur quelque support que ce soit, c’est s’exposer. Aux désaccords diversement exprimés mais aussi à des attaques personnelles, ce qui est plus regrettable. Il y a quelques années j’ai fait l’objet d’une telle attaque. Trois pages d’une méchante brochure étaient consacrées à montrer quelle raclure j’étais : opportuniste et arriviste, je n’écrivais jamais que pour faire une carrière d’autrice « radicale », changeant de cheval au gré des modes militantes, au fond « jalouse » de l’auteur du libelle. Après une réponse en privé, où j’avais mis en copie d’autres personnes attaquées dans le texte, et bien que j’aie été souvent tentée de rétablir un peu de vérité parmi des mensonges très factuels et mesquins, je n’ai jamais pris la peine de commenter cette brochure autrement que par des allusions ici-même. Je connais Thomas J, l’auteur de ces malheureuses pages, depuis 2008 et notre passage chez les jeunes écolos alternatifs et solidaires, une asso soutenue par les Verts puis EELV. J’ai de lui une opinion très mélangée : un homme arrogant mais intéressant, un militant très actif et efficace mais qui a pris des partis douteux, un auteur qui se flatte de comprendre « le » féminisme et « le » Islam sur lesquels il écrit des textes haineux et de faible tenue (on a là le 100 000e islamologue du pays) mais qui documente honnêtement le déferlement technologique dans sa région, une personnalité que j’ai découverte tardivement narcissique et au fond fragile, dont l’écriture carbure à la haine, prenant des cibles pas toujours choisies avec la plus grande sagacité.
Écrire et publier, sur quelque support que ce soit, c’est s’exposer. Aux désaccords diversement exprimés mais aussi à des attaques personnelles, ce qui est plus regrettable. Il y a quelques années j’ai fait l’objet d’une telle attaque. Trois pages d’une méchante brochure étaient consacrées à montrer quelle raclure j’étais : opportuniste et arriviste, je n’écrivais jamais que pour faire une carrière d’autrice « radicale », changeant de cheval au gré des modes militantes, au fond « jalouse » de l’auteur du libelle. Après une réponse en privé, où j’avais mis en copie d’autres personnes attaquées dans le texte, et bien que j’aie été souvent tentée de rétablir un peu de vérité parmi des mensonges très factuels et mesquins, je n’ai jamais pris la peine de commenter cette brochure autrement que par des allusions ici-même. Je connais Thomas J, l’auteur de ces malheureuses pages, depuis 2008 et notre passage chez les jeunes écolos alternatifs et solidaires, une asso soutenue par les Verts puis EELV. J’ai de lui une opinion très mélangée : un homme arrogant mais intéressant, un militant très actif et efficace mais qui a pris des partis douteux, un auteur qui se flatte de comprendre « le » féminisme et « le » Islam sur lesquels il écrit des textes haineux et de faible tenue (on a là le 100 000e islamologue du pays) mais qui documente honnêtement le déferlement technologique dans sa région, une personnalité que j’ai découverte tardivement narcissique et au fond fragile, dont l’écriture carbure à la haine, prenant des cibles pas toujours choisies avec la plus grande sagacité.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 30 juin, 2021
Par Aude le mercredi, 30 juin, 2021, 09h04 - Textes
Quand certains hommes croient devoir commenter l’actualité du féminisme, c’est pour dire quelles sont les bonnes idées et les mauvaises, les bonnes féministes et les mauvaises, ce à quoi le féminisme doit s’intéresser (pas à remettre en question leur confort et leur pouvoir). Il n’y a pas de bonnes et de mauvaises féministes, il n’y a que des questions à discuter, des choix qui peuvent être interrogés et parfois des propos regrettables. Aujourd’hui j’ai envie de mettre l’accent sur un chantier qui a été un peu délaissé mais qui semble resurgir. Cela ne signifie pas qu’il soit plus important que d’autres qui ont plus été au centre de nos préoccupations ces dernières années. Au contraire, tout s’imbrique, la réalité matérielle est une conséquence des représentations genrées et des injonctions sexistes, les violences sexuelles se nourrissent des violences économiques. Mais ces questions économiques se rappellent à notre attention (1).
Lire la suite...
aucun rétrolien
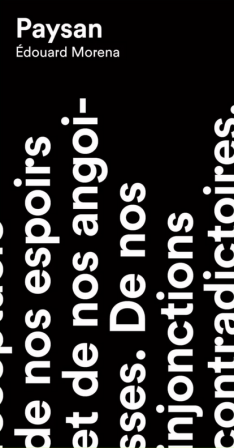 Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €
Édouard Morena, Paysan, Anamosa, 2024, 112 pages, 9 €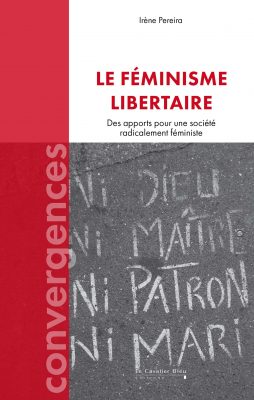 Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €
Irène Pereira, Le Féminisme libertaire. Des apports pour une société radicalement féministe, Le Cavalier bleu, 2024, 136 pages, 18 €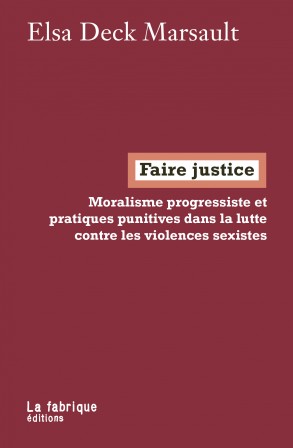 Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La Fabrique, 2023, 168 pages, 13 €
Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La Fabrique, 2023, 168 pages, 13 € Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €
Anne Humbert, Tout plaquer. La désertion ne fait pas partie de la solution... mais du problème, Le Monde à l’envers, 2023, 72 pages, 5 €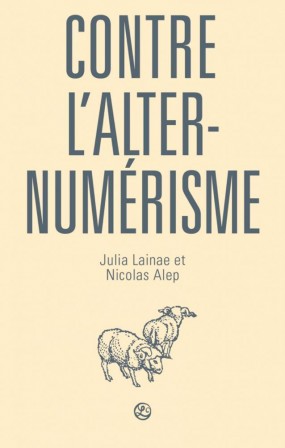 Julia Laïnae, Nicolas Alep, Contre l'alternumérisme, La Lenteur (2020), 2023, 144 pages, 10 €
Julia Laïnae, Nicolas Alep, Contre l'alternumérisme, La Lenteur (2020), 2023, 144 pages, 10 €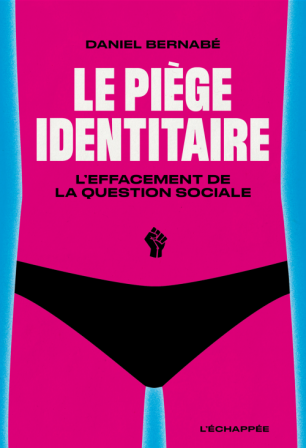 Le Piège identitaire. L’Effacement de la question sociale, Daniel Bernabé, traduit de l’espagnol par Patrick Marcolini avec Victoria Goicovich, L’Échappée, 312 pages, 20 €
Le Piège identitaire. L’Effacement de la question sociale, Daniel Bernabé, traduit de l’espagnol par Patrick Marcolini avec Victoria Goicovich, L’Échappée, 312 pages, 20 € Écrire et publier, sur quelque support que ce soit, c’est s’exposer. Aux désaccords diversement exprimés mais aussi à des attaques personnelles, ce qui est plus regrettable. Il y a quelques années j’ai fait l’objet d’une telle attaque. Trois pages d’une méchante brochure étaient consacrées à montrer quelle raclure j’étais : opportuniste et arriviste, je n’écrivais jamais que pour faire une carrière d’autrice « radicale », changeant de cheval au gré des modes militantes, au fond « jalouse » de l’auteur du libelle. Après une réponse en privé, où j’avais mis en copie d’autres personnes attaquées dans le texte, et bien que j’aie été souvent tentée de rétablir un peu de vérité parmi des mensonges très factuels et mesquins, je n’ai jamais pris la peine de commenter cette brochure autrement que par des allusions ici-même. Je connais Thomas J, l’auteur de ces malheureuses pages, depuis 2008 et notre passage chez les jeunes écolos alternatifs et solidaires, une asso soutenue par les Verts puis EELV. J’ai de lui une opinion très mélangée : un homme arrogant mais intéressant, un militant très actif et efficace mais qui a pris des partis douteux, un auteur qui se flatte de comprendre « le » féminisme et « le » Islam sur lesquels il écrit des textes haineux et de faible tenue (on a là le 100 000e islamologue du pays) mais qui documente honnêtement le déferlement technologique dans sa région, une personnalité que j’ai découverte tardivement narcissique et au fond fragile, dont l’écriture carbure à la haine, prenant des cibles pas toujours choisies avec la plus grande sagacité.
Écrire et publier, sur quelque support que ce soit, c’est s’exposer. Aux désaccords diversement exprimés mais aussi à des attaques personnelles, ce qui est plus regrettable. Il y a quelques années j’ai fait l’objet d’une telle attaque. Trois pages d’une méchante brochure étaient consacrées à montrer quelle raclure j’étais : opportuniste et arriviste, je n’écrivais jamais que pour faire une carrière d’autrice « radicale », changeant de cheval au gré des modes militantes, au fond « jalouse » de l’auteur du libelle. Après une réponse en privé, où j’avais mis en copie d’autres personnes attaquées dans le texte, et bien que j’aie été souvent tentée de rétablir un peu de vérité parmi des mensonges très factuels et mesquins, je n’ai jamais pris la peine de commenter cette brochure autrement que par des allusions ici-même. Je connais Thomas J, l’auteur de ces malheureuses pages, depuis 2008 et notre passage chez les jeunes écolos alternatifs et solidaires, une asso soutenue par les Verts puis EELV. J’ai de lui une opinion très mélangée : un homme arrogant mais intéressant, un militant très actif et efficace mais qui a pris des partis douteux, un auteur qui se flatte de comprendre « le » féminisme et « le » Islam sur lesquels il écrit des textes haineux et de faible tenue (on a là le 100 000e islamologue du pays) mais qui documente honnêtement le déferlement technologique dans sa région, une personnalité que j’ai découverte tardivement narcissique et au fond fragile, dont l’écriture carbure à la haine, prenant des cibles pas toujours choisies avec la plus grande sagacité.