Un texte qui doit beaucoup, ne serait-ce que l'envie de l'écrire, à
la lecture de Le Sucre et la faim. Enquête dans les régions sucrières du
Nord-Est brésilien, par Robert Linhart
Beaucoup de clichés courent sur les pays pauvres du Sud, spécialement sur
l'Afrique. On imagine des terres difficilement cultivables, sujettes à la
sécheresse, tous obstacles naturels à ce que l'abondance règne. En bref :
la malédiction. Celle, indécrottable, qui rendrait nécessaire le recours à la
charité, sacs de riz portés sur des épaules musclées, sourire dentifrice
inclus. Les structures sociales de ces pays et leur place dans la
mondialisation sont rarement interrogées. Cela fait pourtant belle lurette que
les associations de solidarité internationales nous alertent : ces pays
ont tout à fait les moyens de se nourrir, ils ont surtout besoin qu'on leur
lâche la grappe.
Lopin ou plantation ?
Dans le Brésil d'après le coup d'État de 1964, l'une des raisons principales
de la malnutrition qui règne dans le Nordeste, c'est la disparition des lopins
confisqués par les gros propriétaires. Les ouvriers agricoles qui triment dans
les plantations de canne à sucre n'ont alors plus qu'une source de
nourriture : l'importation depuis les autres régions du pays, épargnées
par la monoculture, de haricots secs (les fameux feijõas) et de
manioc. Passées par le marché national, par des chaînes de distribution longues
et coûteuses, acheminées sur des milliers de kilomètres (c'est l'échelle
brésilienne), ces denrées se retrouvent dans les bodegas du Nordeste à
des prix prohibitifs. Alors que le minuscule reço des ouvriers
agricoles, 20m2 à cultiver pour l'usage familial, apportait une nourriture
d'appoint, variée et gratuite, qui ne coûtait que le temps qu'on consacrait à
la faire pousser, le salaire ne suffit jamais à nourrir la famille dans les
mêmes proportions et la même qualité.
Aujourd'hui, avec une mécanisation accrue du travail agricole, l'emploi
n'est même plus assuré, d'où un exode rural qui amène les plus pauvres dans les
bidonvilles de Lagos ou de Rio. La filière soja brésilienne emploie une
personne pour 50 hectares, avec des conditions de travail et sociales qui sont
restées souvent indigentes. Le maïs et la canne à sucre font à peine mieux
(1). Et ce sont toutes des cultures concernées par les
agrocarburants. Dans le même temps, on considère qu'un hectare de terres suffit
à faire vivre une famille indienne (2).
Boycott de la banane !
Alors, comment mieux soutenir les pays pauvres qu'en n'achetant justement
pas leurs produits ? Ce n'est pas un choix démocratique ou populaire qui
est à l'origine des plantations de bananes, palmiers à huile, canne à sucre.
C'est l'expression des intérêts des plus gros acteurs économiques, dont les
populations locales n'ont eu aucun moyen de se protéger. On s'est habitué à
l'idée qu'acheter un produit, c'était soutenir, même dans de petites
proportions, la personne qui le fabrique. Le raisonnement dans le cas des
produits agricoles doit être radicalement différent. L'agriculture est une
activité accessible à tou-te-s, et on n'a pas besoin d'attendre un gros
investissement (privé ou coopératif), la mise en place de structures de
production de haute technologie, pour produire sur une terre. Une graine qui
germe, et c'est parti. Au contraire de ce qui peut se passer dans l'industrie,
quand on achète un produit agricole de plantation on ne soutient pas l'emploi
généré par cette activité, on soutient la prédation de terres que les
populations locales se voient confisquer.
La ruée vers les terres agricoles
L'Amérique latine est marquée par le régime foncier latifundiaire : la
latifundia est la grosse plantation d'un colon européen, espagnol ou portugais,
qui emploie des locaux sur ses terres, esclaves puis « libres ». Pendant
tout le long du XXe siècle, on a vu le recul de cette forme de propriété
coloniale... au profit non pas de réformes agraires, mais de l'achat des terres
par des multinationales. Agro-alimentaires évidemment, mais aussi industrielles
parfois (Ford s'était implanté en Amazonie pendant les riches heures du
caoutchouc naturel).
Le renchérissement des prix agricoles, suite entre autres aux tensions
provoquées sur le marché par les agrocarburants, rend ce genre d'agissement
d'autant plus profitable. Et crise alimentaire oblige, les spéculateurs aussi
investissent dans les terres du Sud, c'est une véritable ruée vers les terres
agricoles bon marché, qu'on appelle le land grab et qui est surveillée
de près par les ONG, autant pour ses conséquences environnementales que
sociales, toutes désastreuses (3).
La malédiction qui pèse sur la faculté des pays du Sud à se nourrir, c'est
désormais l'inclusion toujours plus pressante de leurs agricultures dans le
marché mondial. Marché des terres, marché des produits, qui rendent impossible
économiquement une agriculture orientée vers la satisfaction des besoins
alimentaires locaux.
Une agriculture mondialisée
Ajoutons à ce tableau le dumping auquel se livrent les pays riches. Notre
agriculture, dopée au engrais, pesticides et médocs, produit trop ?
« Il est devenu politiquement plus intéressant, et en général
économiquement plus avantageux, d’exporter les excédents – souvent sous forme
d’aide alimentaire – que de les stocker. Ces excédents, fortement
subventionnés, font baisser les prix sur le marché international de denrées
telles que le sucre et ils ont créé de sérieux problèmes pour plusieurs pays en
développement, dont l’économie se fonde sur l’agriculture »
(4).
Plus de vingt ans après le rapport Bruntland, qui posait les bases d'un
développement durable, la situation n'a pas beaucoup changé et
l'Europe continue à « être vache avec l'Afrique »
(5) en y exportant du lait en poudre à prix bradé. La
disparition des jachères, décidée par la PAC dans un monde où la crise
alimentaire se fait sentir, est une façon de redire la vocation exportatrice de
l'agriculture européenne. A priori, c'est tout bon pour les
consommateurs africains, qui paieront moins cher leurs aliments. Mais c'est la
catastrophe pour l'agriculture de type familial, moins compétitive. Notre lait
fortement subventionné vient concurrencer de manière déloyale celui qui est
produit localement (oui, il y a des vaches en Afrique), fermant ainsi les
débouchés des petits paysans. Et les condamnant économiquement.
Autonomie, camarade !
Pour permettre à tout le monde de bouffer sur cette planète, il ne s'agit
donc ni de produire plus (version révolution verte ou version OGM), ni de faire
la charité (commerce inéquitable ou moins inéquitable), mais d'accepter la
demande qui est faite au système politique mondial que l'agriculture des pays
pauvres se relocalise, qu'elle se réoriente sur les besoins des populations
locales plutôt que de rester tributaire des nôtres. Et ça passe par une sacré
remise en question, personnelle et politique, de notre mode de vie...
(1) Amis de la Terre Brésil et fondation Heinrich Böll,
Agrobusiness and biofuels: an explosive mixture, 2006), cités dans
Maryline Cailleux et Marie-Aude Even, « Les biocarburants :
opportunité ou menace pour les pays en voie de développement ? »,
Prospective et évaluation, n°3, janvier 2009,
agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/analyse30901.pdf.
(2) C'est le propos d'Ekta Parishad, mouvement populaire de
lutte pour la défense des droits des paysans sans terre et des peuples
indigènes en Inde.
(3) « Main basse sur les terres agricoles du Sud »,
Guy Debailleul, 26 février 2009, alternatives.ca/article4557.html. Signalons
aussi le blog animé par l'ONG Grain, farmlandgrab.blogspot.com.
(4) Rapport Brundtland (1987), chapitre 5, « Sécurité
alimentaire : soutenir le potentiel »,
fr.wikisource.org/wiki/Rapport_Brundtland/Chapitre_5.
(5) Du nom d'une des campagnes menées conjointement par le
CFSI, le CCFD, Oxfam-Agir ici, la Confédération paysanne, ATTAC et on en
oublie.
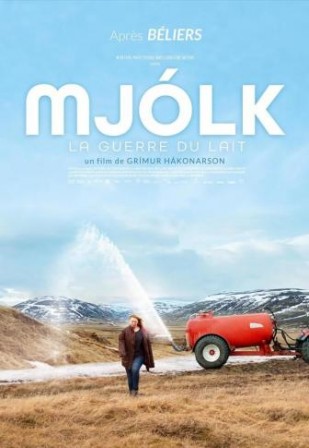 Mjólk de Grímur Hákonarson, sortie le 11 septembre
2019 en France
Mjólk de Grímur Hákonarson, sortie le 11 septembre
2019 en France Quelques liens vers des entretiens autour d'On achève bien les
éleveurs.
Quelques liens vers des entretiens autour d'On achève bien les
éleveurs. Vendredi 8 décembre, l'émission
Vendredi 8 décembre, l'émission  La Démocratie aux champs, Joëlle Zask
La Démocratie aux champs, Joëlle Zask