Homo domesticus
Par Aude le samedi, 23 janvier, 2021, 13h47 - Lectures - Lien permanent
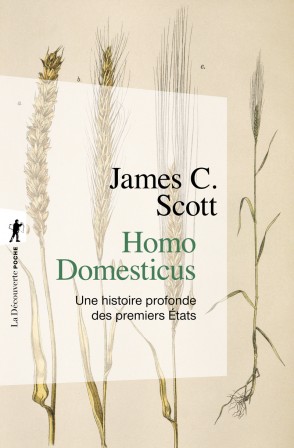 James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 €
James C. Scott, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers États, traduit de l’anglais par Marc Saint-Upéry, La Découverte, 2021, 324 pages, 13 €
C’est un récit classique, celui d’une humanité qui se dirige de manière continue vers son accomplissement. Jadis sans État ni agriculture, nos ancêtres découvrirent enfin comment planter des céréales puis comment s’organiser dans des formes politiques de plus en plus complexes. James C. Scott va à rebrousse-poil (against the grain en anglais, c’est aussi le titre original du livre) de cette histoire en présentant un tableau beaucoup plus critique des premiers États et de l’hésitation entre sociétés avec ou sans État. Car il ne s’agit déjà pas d’une histoire linéaire. Les individus qui vivent sous un État peuvent s’en libérer et les États eux-mêmes s’effondrer – sans que les individus qui y vivaient ne s’en trouvent plus mal.
À la source de l’État il y a la captation de richesses, des surplus de la céréaliculture, sans qu’on sache si c’est l’État qui naît de cette forme d’agriculture ou au contraire cette forme d’agriculture qui est imposée par le pouvoir. Scott, politiste et anthropologue spécialiste de l’Asie du Sud-Est, avait déjà popularisé dans Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Le Seuil, 2013) cette idée de la céréale comme propice à la prédation de l’État : dans les champs, les céréales mûrissent toutes en même temps et à la vue de tous, il est facile de les estimer et soumettre à l’impôt. Plus facile que des tubercules et racines diverses plantées çà et là dans des forêts-jardins par des chasseurs-cueilleurs(-cultivateurs, donc).
La culture des céréales a en outre le désavantage d’exiger plus de temps de travail que les chasseurs-cueilleurs n’en consacraient à leur subsistance et d’être aussi plus risquée que des pratiques de chasse et de cueillette dont Scott s’attache à montrer qu’elles étaient bien rodées et très profitables – en tout cas dans cette Basse Mésopotamie qui est au centre de sa démonstration et qui, alors marécageuse, constituait une mosaïque d’écosystèmes différents avec une faune et une flore variées. Citant avec ironie le régime paléo qui propose de revenir à la source d’une alimentation saine pour l’être humain, il ajoute à sa critique politique celle du régime de cette alimentation à forte base de céréales et moins favorable à la santé humaine.
Dans une grande partie de son ouvrage, Scott rappelle la vulnérabilité des concentrations humaines permises par l'agriculture. Le « camp de regroupement plurispécifique du Néolithique » (alias la ville) est très vulnérable sur le plan sanitaire d’abord, ce qui résonne d’autant plus fortement aujourd’hui que lors de la première parution en français, en 2019, de cet ouvrage publié en anglais en 2017. L’élevage a été l’occasion pour l’être humain de rencontrer les virus des animaux qu’il domestiquait et la concentration urbaine d’en stimuler la circulation. Homo domesticus n’avait pas un solde démographique positif dans ces premiers États agricoles. Sans compter les mauvais traitements et les nombreuses fuites de paysan·nes ou d’esclaves souhaitant échapper à leur triste sort de sujets administrés. Même la démographie de ces États ne tenait qu’à l’apport régulier de captifs et captives.
L’autre vulnérabilité est environnementale. La déforestation en amont des concentrations humaines, la surexploitation de leur milieu immédiat, la salinisation des terres due à l’irrigation… beaucoup de ces modèles n’étaient pas soutenables. Aussi l’État, que nous avons l’habitude de percevoir comme une institution solide, n’est-il souvent qu’un moment. Scott cite par exemple la dynastie Qin qui posa les bases de l’État chinois et lui donna le nom qu’il a dans les langues occidentales, en quinze ans seulement.
Les âges obscurs furent au fond plus nombreux que les moments d’éclat et ils ne sont obscurs que parce qu’on manque de documentation à leur propos, tellement notre histoire a été fascinée par les États en mesure de laisser derrière eux de grandes réalisations architecturales (ce ne fut pas le cas de tous) et des supports durables (minéraux plutôt que végétaux). L’histoire que nous connaissons, c’est celle donc qu’ont produites eux-mêmes les États et non les peuples sans État. Scott choisit dans cet ouvrage de réhabiliter les « barbares », ces peuples dont nous ignorons encore beaucoup. Contrairement à l’image que laissent les grandes murailles, les premiers États n’ont pas tant cherché à se protéger des barbares qu’à tenir prisonniers leurs sujets : qui donc est le plus « barbare » ? Hordes nomades sauvages exerçant leur prédation sur les sédentaires (c’est une autre forme de cueillette), sortes de quilombos accueillant les fuyard·es de l’État ou bien chasseurs-cueilleurs au milieu trop reculé pour avoir jamais été en contact avec un État, les configurations de vie sans État sont nombreuses. Ou plutôt elles l’étaient jusqu’à ce que le monde se referme et que les autres formes de vie politiques soient rendues impossibles.
James C. Scott avait dans Zomia fait une synthèse remarquée de travaux anthropologiques. Dans Homo domesticus, ce sont les archéologues et les historien·nes qu’il sollicite, nous livrant un ouvrage appuyé sur les travaux les plus récents – il y en aura sûrement d’autres qui continueront à éclairer ces sociétés sans État. Son travail, quand bien même il n'entretiendrait aucun doux rêve sur la possibilité de retourner en arrière et de vivre sans État, détruit au moins quelques mythes. Et c’est salutaire.