Les Irresponsables
Par Aude le dimanche, 11 mai, 2025, 09h48 - Lectures - Lien permanent
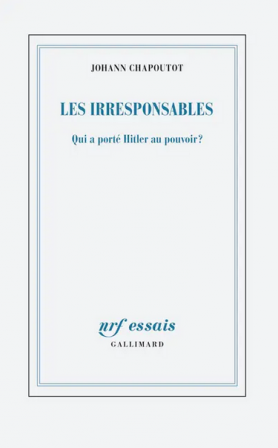 Johann Chapoutot, Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Gallimard, 2025, 304 pages, 21 €
Johann Chapoutot, Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Gallimard, 2025, 304 pages, 21 €
« Comme on le sait, Hitler a été élu démocratiquement », lisais-je il y a quelques jours à peine dans un article par ailleurs très fin sur la montée du fascisme. Voilà un topos auquel on espère échapper maintenant que l’historien Johann Chapoutot, une référence sur la période nazie, s’est attaqué aux mois qui ont précédé l’accession au pouvoir de Hitler. Il fait commencer cette histoire au 1er avril 1930, jour du discours de politique générale du chancelier Heinrich Brüning devant le Reichstag. Une coalition très large vient de tomber et le centriste Brüning a été nommé par le président Paul von Hindenburg pour mettre la barre à droite. Il promet « une sorte de cabinet technique » et applique une politique économique dure envers les travailleurs, avec le soutien discret du SPD (le parti social-démocrate) qui craint pire encore. Hindenburg, bien plus populaire que brillant (Chapoutot est féroce avec les protagonistes de cette histoire), est malgré tout mécontent que son chancelier doive encore aux sociaux-démocrates de ne pas tomber. Cette figure autoritaire, qui tord la Constitution pour gouverner à coups d’article 48, prérogative présidentielle en principe réservée à un état d’urgence, dissout le Reichstag à l’été 1930, espérant de meilleurs résultats pour son camp alors que le parti nazi vient de faire une percée lors d’élections locales et que le chômage est au plus haut suite à la crise qui vient d’éclater aux États-Unis en novembre 1929. Sans surprise, le Reichstag sort des élections divisé en trois grands camps dont aucun n’est en capacité d’emporter seul une majorité. Brüning garde néanmoins son siège avec des adversaires qui lui abandonnent la responsabilité de sa politique.
Quand il tombe au printemps 1932, c’est lâché par la droite. Il a osé remettre en question la manne étatique qui soutient une économie latifundiaire dans l’est du pays (aujourd’hui une bonne partie de la Pologne). Celle-ci engloutit des subventions sans produire grand-chose alors que le pays a son lot de chômeurs disposés à coloniser la région avec une agriculture plus productive. Mais Hindenburg est l’un de ces agrariens qui tiennent à leurs fiefs orientaux. Incapable de faire prospérer son domaine familial, il ne doit le maintien de sa propriété qu’à une souscription à laquelle les élites économiques allemandes ont participé, en un échange de bons procédés. Hindenburg, réélu président suite à un « tout sauf Hitler » dans lequel les Allemands de la gauche modérée et du centre lui ont donné leurs voix, congédie Brüning et nomme à sa place Franz von Papen, ex-Zentrum, qui nomme un gouvernement composé principalement d’aristocrates et lance une politique de classe plus violente que jamais. À l’été 1932, Papen ré-autorise les milices nazies, qui sèment le chaos dans les rues, et l’État fédéral prend la main sur l’État prussien, environ deux tiers du pays, gouverné entre autres par le SPD (le reste du pays est composé des deux États catholiques du Sud et d’une kyrielle de petits États). C’est dans cette ambiance sereine qu’Hindenburg dissout une nouvelle fois le Reichstag.
Des élections sortent un parti nazi de nouveau renforcé (il culmine à 37 % des voix) et une assemblée toujours divisée en trois. Adolf Hitler se voit offrir par Papen une position de vice-chancelier en échange du soutien de son parti mais il refuse, voulant tout ou rien. La droite souhaite l’avoir en force d’appoint et c’est là qu’achoppent les nombreuses tractations entre Papen, Hindenburg, Kurt von Schleicher, Hitler et Hermann Göring qui ont lieu ces années-là, pourparlers secrets dont Chapoutot rend compte principalement grâce au journal intime de Joseph Goebbels. Papen, n’ayant pas été assez vif à la rentrée 1932 pour apporter le décret de dissolution d’Hindenburg au Reichstag, est humilié par une censure du gouvernement votée par 90 % des députés. Tout le monde s’est ligué contre la droite : le KPD communiste, le SPD, le Zentrum et les deux partis d’extrême droite. De nouvelles élections sont convoquées lors desquelles le parti nazi perd enfin des voix, au plus grand désarroi de Goebbels qui craint l’échec définitif.
Schleicher, homme de confiance de Hindenburg, prend alors la chancellerie sans réelle majorité mais applique une politique plus conciliante envers la gauche, toujours présente dans les urnes et soutenue par quelques belles grèves. Côté nazi, il est à deux doigts de débaucher Gregor Strasser, principal rival, jugé plus « raisonnable », de Hitler. Cette attitude lui permet de gouverner pendant quelques semaines. Les indicateurs économiques s’améliorent et la crise politique semble écartée, c’est peut-être la fin de l’ascension nazie… jusqu’à ce que le chancelier reprenne le projet maudit de modernisation de l’agriculture dans l’est du pays qui menace les agrariens. Hindenburg, influencé par Papen, lui retire sa confiance et donne enfin sa chance au petit caporal Hitler, qui n’avait plus qu’une carte à jouer, un scandale concernant le domaine terrien du président. (Hitler n’a donc pas été élu, il a été nommé par celui-là même qui avait été élu pour lui faire barrage.) Au-delà de la complaisance présidentielle, Hitler et Göring ont surtout su convaincre les classes dominantes allemandes (l’industrie, la bourgeoisie cultivée, l’aristocratie terrienne) que les nazis seraient leurs meilleurs alliés. Lorsque Hindenburg et Papen investissent Hitler, c’est en pensant que les nazis seraient ces bons supplétifs. Ils leur cèdent la chancellerie et le ministère de l’intérieur, pensant garder pour eux le pouvoir avec un grand nombre de ministères. Les nazis n’ont besoin que de ces deux positions et d’une sale habitude désormais acquise de tordre la Constitution et de piétiner l’État de droit. Quand Hindenburg meurt en 1934, à 86 ans, Hitler se nomme chancelier-président. Il a déjà fait tuer ses opposants nazis ainsi que l’ex-chancelier Schleicher.
Dans ce livre passionnant mais où l’on peut vite se perdre dans les intrigues et les cabales, Chapoutot rend compte des agissements de cette classe politique, marchepied à nazis, avec un mépris non-dissimulé (1) et une colère sensible. C’est que tant d’éléments évoquent la situation actuelle… Dissolutionnite présidentielle, entre-soi (masculin) des lieux de pouvoir, refus de tout compromis avec une gauche pourtant conciliante, complaisance des milieux d’affaire envers le racisme et le nazisme et tant de menus détails… le tout sous la bannière d’un libéralisme autoritaire. L’expression semble oxymorique mais Eugénie Mérieau (Géopolitique de l’état d’exception) et Lauréline Fontaine (La Constitution au XXIe siècle) nous ont déjà montré en quoi le libéralisme n’était pas foncièrement attaché à la démocratie et à l’égalité des conditions. Chapoutot cite Grégoire Chamayou dans son épilogue, consacré aux parallélismes entre hier et aujourd’hui. En 2020, le philosophe publiait une analyse du libéralisme autoritaire à travers deux textes d’époque, un discours du juriste Carl Schmitt présentant son rêve d’une société gouvernable et rassurant le capitalisme rhénan sur la capacité des nazis à servir ses intérêts, et le social-démocrate Hermann Heller qui dans sa réponse défendait l’État de droit.
Chapoutot, qui dans le livre a une approche contrefactuelle très fine, identifiant les possibles de chaque moment, défend sa méthode devant des reproches dont celui de « franchir » (sic) le point Godwin… Drôle de reproche à faire à un historien du nazisme. « Hugenberg (un patron de presse qui contribua à la diffusion d’idées fascistes) n’est pas Bolloré et Papen n’est pas Macron mais leurs positions dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 2025 et de l’Allemagne de 1932 sont analogues », assume Chapoutot. Un des fils que l’historien découvre entre les deux situations est la Constitution de la Ve République dont il rappelle qu’elle n’est pas née casquée de la cuisse d’un général mais qu’elle est largement inspirée de juristes actifs dès les années 1930, favorables aux évolutions autoritaires de l’Allemagne de Hindenburg car partisans de « l’infléchissement autoritaire des institutions par trop parlementaristes de la IIIe République » pour gouverner plus efficacement, toujours dans l’intérêt du capital. Alors que l’on voit à l’œuvre aux États-Unis un État de droit adossé à une solide culture juridique devenir le terrain de jeux de qui ose, il nous faut mieux comprendre comment les États libéraux peuvent ainsi se transformer, dès que les classes dominantes en ressentent le besoin, en de violentes monarchies.
NB : Outre Chamayou, Chapoutot cite les philosophes Michaël Fœssel, auteur de Récidive. 1938, et Barbara Stiegler, ainsi que l’historien de la Révolution française Pierre Serna, auteur d’ouvrages sur l’« extrême centre ».
(1) La langue de Chapoutot est châtiée et son lexique très riche, comme pour rappeler aux dirigeants leur médiocrité et la finesse du vernis de leur éducation élitiste. C’est le genre de livre qui mériterait, justement car son auteur est exigeant, que son éditeur y consacrât quelques jours de travail d’une personne qui fait profession de corriger des livres. Au lieu de ça, l’ouvrage a son lot de coquilles (comme un gérondif latin auquel manque le n). Pour un livre à 21 € des éditions Gallimard, ça la fout vraiment mal. Les correcteurs et correctrices, rappelons-le, sont seul·es en capacité de rendre des livres impeccables.