jeudi, 17 mars, 2022
Par Aude le jeudi, 17 mars, 2022, 20h03 - Service du travail obligatoire
C’est un spectacle que beaucoup d’entre nous n’avions jamais vu avant, ou alors dans les films ou dans des pays lointains : des avis de recrutement fleurissent devant les commerces, parfois en grand sur des espaces publicitaires. Jamais autant d’efforts n’avaient été déployés pour nous convaincre de prendre un boulot. Avant c’était plutôt le contraire, à nous surnuméraires de séduire les employeurs, d’accepter des temps partiels ou des horaires très étendus, de modérer nos revendications salariales. C’est la loi du marché, il y a peu de postes et tellement de candidat·es…
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 6 décembre, 2021
Par Aude le lundi, 6 décembre, 2021, 20h13 - Lectures
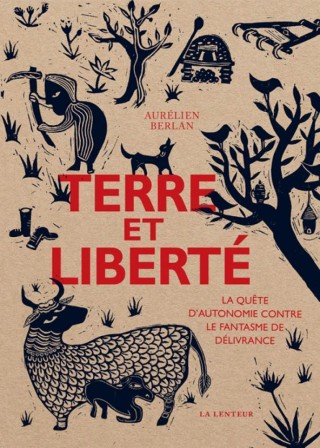 Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Le constat par lequel commence la démonstration d’Aurélien Berlan, c’est celui d’une « liberté dans le coma » : pourquoi la révélation que les États surveillent les communications de leurs citoyen·nes ne nous a-t-elle pas plus ému·es que ça ? Parce que nous le savions déjà ou parce que cette liberté-là, celle d’avoir une vie vraiment privée, ne nous importe pas tant ? Les classiques du libéralisme mettaient pourtant au-dessus de tout les libertés individuelles : d’opinion, d’expression, de mouvement, d’association, de faire des choix de vie qui nous appartiennent et accessoirement ne pas être surveillé·e. Cette liberté-là s’est construite contre des droits politiques à exercer collectivement, comme la souveraineté politique. L’auteur reprend dans les détails la pensée de Benjamin Constant (le théoricien de la liberté de ne se mêler que de ses propres affaires et d’abandonner à d’autres le gouvernement de la cité) pour affirmer qu’au fond, cette liberté des libéraux est la délivrance des exigences du quotidien : être au chaud sans couper du bois (ou au frais sans avoir planté d’arbre), repu·e sans avoir cultivé ni préparé sa nourriture, pouvoir se détacher de son lieu de vie, etc. Délivrance qui inclut également de ne plus avoir se soucier de politique, ne plus s’engager publiquement.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 30 novembre, 2021
Par Aude le mardi, 30 novembre, 2021, 08h36 - Textes
Vaccin, j’oublie tout
Allez les enfants, les vacances sont finies, les mesures sanitaires sont de retour. Après avoir offert quelques mois de répit aux personnes vaccinées, papa Macron cogite pour gérer le seul chiffre qui lui importe, celui des admissions hospitalières qui doivent rester à la limite de capacités bien écornées, et par la politique d’austérité, et par la crise sanitaire. Tout en respectant au mieux les besoins de l’économie, c’est à dire des classes qui en tirent le plus grand profit.
Pendant tout l’automne, les salarié·es n’ont pas eu la possibilité de choisir de télétravailler et ont dû s’entasser dans le métro ou contribuer à des embouteillages qu’on n’avait plus vus depuis longtemps. Les lieux recevant du public n’ont plus eu d’obligation de port du masque en intérieur, sauf à l’initiative des organisateurs ou des préfets. C’était la fête. À un détail près : nous en avons tenu à l’écart les personnes non-vaccinées ou qui ne se soumettaient pas au pass sanitaire. Pendant qu’elles étaient de facto confinées, nous avons enfin joui. Pendant ce temps, je fermais ma gueule, un peu parce que j’en ai marre de faire les Cassandre qui sait comment ça va finir (dans un futur proche, pas plus), un peu parce que la seule réponse accordée aux questions que je pose à la sphère écolo radicale à ce sujet, c’est du bullying (j’en reparlerai).
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 7 novembre, 2021
Par Aude le dimanche, 7 novembre, 2021, 18h47 - Textes
Voilà une expression que j’entends beaucoup quand il est question d’agriculture et d’alimentation : « On vote avec son portefeuille. » Manière de dire que même si des choix politiques concernant l’agriculture nous échappent, on a toujours un second tour au moment d’aller faire ses courses, pour réparer les dégâts d’une alimentation qui constitue environ un quart de notre empreinte carbone et d’innombrables atteintes au milieu. Sans compter les transports de marchandises alimentaires, leur stockage et leur transformation, l’agriculture est fortement émettrice de gaz à effet de serre, quand bien même les recherches agronomiques et les pratiques paysannes sauraient refermer les cycles du carbone en produisant autrement. Elle n’émet pas seulement le fameux méthane des ruminants mais aussi les gaz produits par les engrais azotés, de la fabrication à base d’hydrocarbures à l’épandage dans les champs (1), entre autres (au niveau mondial, il faut également prendre en compte la déforestation ou changement d’affectation des sols). Elle est en outre consommatrice nette d’énergie alors qu’elle est plutôt supposée en produire, magie de la photosynthèse : aux USA il faut déjà 7 calories d’énergies fossiles pour produire une (1) calorie d’aliment. Et ne mentionnons pas les atteintes à la santé humaine et à la faune sauvage. Mais tout va bien, vous pouvez éviter tout ça avec votre petit caddie !
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 15 août, 2021
Par Aude le dimanche, 15 août, 2021, 20h27 - Lectures
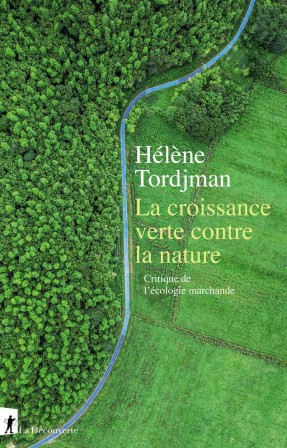 Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
La Croissance verte contre la nature est certainement le plus grand livre d’écologie de l’année. L’économiste Hélène Tordjman s’y attaque aux évolutions de la technologique et du capitalisme et à leur nouvelle prise en compte des questions environnementales. Entamé il y a moins de vingt ans, ce virage « vert » n’entend pas sortir de l’ornière productiviste mais ses innovations sont désormais accompagnées de justifications écologiques. Tordjman documente donc plusieurs dossiers pour tenter d’en comprendre les racines idéologiques et les logiques économiques.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 2 août, 2021
Par Aude le lundi, 2 août, 2021, 21h19 - Textes
Pandémie : du grec ancien πᾶν / pan « tous », et δῆμος / demos « peuple », maladie qui se propage dans le monde entier, par opposition aux épidémies qui sont localisées. Alors que le variant aujourd’hui majoritaire en France a été identifié pour la première fois en Inde, et que la manière dont chaque pays se débrouille avec la pandémie peut impacter les autres, nos débats restent très franco-français. Nous peinons à imaginer l’impact que peut avoir le simple fait de tomber malade et de rester alité·e dans un pays sans couverture médicale ni protection sociale qui assure le revenu des malades jusqu’à leur rétablissement. Nous ignorons les épisodes les plus graves de la pandémie, la vulnérabilité particulière des peuples autochtones d'Amazonie, les cadavres laissés à la rue en Bolivie ou en Équateur, les mort·es enterré·es en catimini dans des fosses communes au Pérou, le chaos en Inde. Le monde s’arrête à notre porte, aux 100 000 morts françaises.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 20 juillet, 2021
Par Aude le mardi, 20 juillet, 2021, 14h17 - Textes
Depuis que la ligne de train a été fermée, le car met presque deux heures pour aller à Châteauroux, à soixante kilomètres de là en traversant le Berry du sud, les terres de George Sand. La petite Fadette, la mare au diable font signe au passage, pas plus subtilement que le panneau marron qui évoque la dame de Nohant entre les foins pas encore rentrés et les champs de céréales. Mon amie Isabelle, qui vit au croisement du Cher, de la Creuse et de l’Allier depuis quatre ans, me dit se sentir mieux physiquement qu’à Lille, où elle et son compagnon ne trouvaient plus à se loger pour cause de précarité économique. En y repensant, je me dis que c’est heureux. Car cette jolie région agricole, où chaque bourg avait son champ de foire et qui est l’objet d’un petit renouveau de l’agriculture paysanne, est aussi ce qu’on appelle un désert médical. La petite ville où habite mon amie, avec ses deux boulangeries et son petit musée, est désormais à une heure de voiture du premier médecin disponible. Celles et ceux qui exercent aux alentours, jeunes ou vieux, sont débordé·es et ne prennent plus de nouveaux patient·es. La « maison médicale » ? Construite dans le cadre d’un programme étatique appelé « revitalisation du centre-bourg », elle est sous-occupée, il n’y a que deux infirmières surmenées qui ne sont pas en mesure d’établir des diagnostics et de prescrire un médicament (1), même pour un rhume. Le dernier médecin, une Roumaine qui a repris une patientèle à grands frais pour elle et une belle commission pour l’intermédiaire qui était allée la chercher en Italie, est partie sans chercher de repreneur, épuisée par la masse de travail et sans doute trop isolée dans cette campagne qui n’est pas la sienne (2). Les ancien·nes consultent encore les rebouteux ou le prêtre exorciste, les « néo » un peu « alterno » font appel à des naturopathes, à leur frais et sans garantie de succès. En cas d’urgence, aucun médecin du coin n’intervient et il ne reste plus qu’à filer aux urgences de l’hôpital.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 16 juillet, 2021
Par Aude le vendredi, 16 juillet, 2021, 09h39 - Textes
 La pandémie de Covid-19 s’est propagée à une vitesse jamais vue, la vitesse des classes les plus mobiles, au mode de vie le plus globalisé, de nos sociétés. Son origine est encore incertaine mais, qu’il s’agisse d’une fuite d’un labo P4 ou d’une zoonose (maladie se transmettant de l’animal à l’humain, c’est le cas de 75 % des maladies émergentes contre 60 % des maladies infectieuses classiques) due à la destruction d’écosystèmes, elle a des causes qui tiennent bien à notre modernité industrielle. Voilà qui converge avec la critique d’une partie des critiques de la technique et autres écologistes radicaux et radicales.
La pandémie de Covid-19 s’est propagée à une vitesse jamais vue, la vitesse des classes les plus mobiles, au mode de vie le plus globalisé, de nos sociétés. Son origine est encore incertaine mais, qu’il s’agisse d’une fuite d’un labo P4 ou d’une zoonose (maladie se transmettant de l’animal à l’humain, c’est le cas de 75 % des maladies émergentes contre 60 % des maladies infectieuses classiques) due à la destruction d’écosystèmes, elle a des causes qui tiennent bien à notre modernité industrielle. Voilà qui converge avec la critique d’une partie des critiques de la technique et autres écologistes radicaux et radicales.
Mais outre ces quelques éléments, cette pandémie a des airs plus familiers – que nous pensions ne plus jamais connaître, nous qui vivons dans des sociétés industrielles et très médicalisées. Les maladies infectieuses ont beaucoup reculé au XXe siècle, notamment en raison de la vaccination, et les maladies du mode de vie les ont remplacées : maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers sont nos maladies de riches. Et nous voilà de nouveau vulnérables à ces maladies de pauvres.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 30 juin, 2021
Par Aude le mercredi, 30 juin, 2021, 09h04 - Textes
Quand certains hommes croient devoir commenter l’actualité du féminisme, c’est pour dire quelles sont les bonnes idées et les mauvaises, les bonnes féministes et les mauvaises, ce à quoi le féminisme doit s’intéresser (pas à remettre en question leur confort et leur pouvoir). Il n’y a pas de bonnes et de mauvaises féministes, il n’y a que des questions à discuter, des choix qui peuvent être interrogés et parfois des propos regrettables. Aujourd’hui j’ai envie de mettre l’accent sur un chantier qui a été un peu délaissé mais qui semble resurgir. Cela ne signifie pas qu’il soit plus important que d’autres qui ont plus été au centre de nos préoccupations ces dernières années. Au contraire, tout s’imbrique, la réalité matérielle est une conséquence des représentations genrées et des injonctions sexistes, les violences sexuelles se nourrissent des violences économiques. Mais ces questions économiques se rappellent à notre attention (1).
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 13 juin, 2021
Par Aude le dimanche, 13 juin, 2021, 09h40 - Lectures
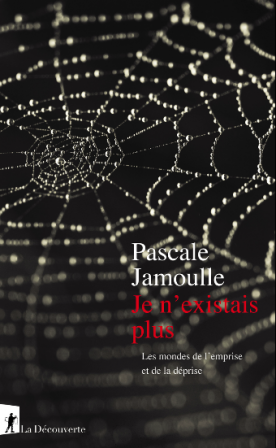 Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €
Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €
L’ouvrage de Pascale Jamoulle, une anthropologue exerçant sur des terrains français et belges, est composé de cinq parties autonomes décrivant des situations d’emprise sur des terrains bien différents. Les premières sont consacrées au parcours très singulier d’une amie de l’autrice, entre violences sexuelles, emprise dans le couple et dans une organisation politique sectaire, puis à ceux, plus brefs, de femmes victimes de violences dans le couple. Les femmes prises dans ces relations disent à quel point elles « n’existent plus », ne sont plus en mesure d’exercer leur libre arbitre. Jamoulle s’attache aux caractères systémiques de l’emprise, au-delà de la rencontre entre deux personnes. Ces phénomènes d’emprise sont très marqués par la domination masculine et des représentations de mise à disposition (sexuelle, domestique, affective) des femmes. Celles-ci sont d’autant plus susceptibles de s’y engager qu’on socialise les filles à la docilité et au sacrifice de soi, dimension incontournable de l’amour dans les représentations traditionnelles.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 9 juin, 2021
Par Aude le mercredi, 9 juin, 2021, 08h29 - Textes
Le minibus filait sur l’autoroute, ramenant à Paris les dernier·es participant·es d’un séminaire écologiste. Sur l’un des ponts autoroutiers, ce slogan d’Extinction Rebellion : 48 000 morts prématurées sont dues chaque année à la pollution de l’air (1). Parce que ces morts nous importent, nous n’avons jamais proposé que les personnes fragiles restent chez elles pendant que nous autres (2) continuerions à polluer. Alors que les autorités nous opposaient une inertie coupable, nous proposions plutôt d’entamer ensemble une décroissance organisée et équitable des transports. La prévention et la responsabilité, la reconnaissance de notre interdépendance, c’était nous. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et nous, les écologistes, avons en partie rejoint la masse des jouisseurs qui refusent de négocier leur mode de vie, quand ce n’est pas les rangs d’une extrême droite libertarienne qui hurle à la « dictature sanitaire » quand sont prises des mesures collectives contre la circulation du Covid. À la dictature sanitaire, nous n’avons pas opposé de démocratie sanitaire mais un libéralisme sanitaire, pour le dire poliment.
Lire la suite...
aucun rétrolien
Par Aude le mercredi, 9 juin, 2021, 08h12 - Lectures
Autour de Sylvie Laurent, Pauvre petit Blanc, Éditions de la MSH, 2020, 320 pages, 12 €
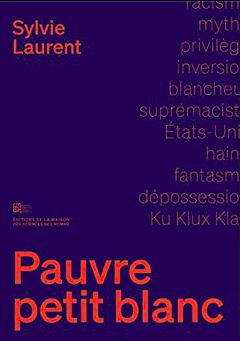 « Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.
« Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 30 mai, 2021
Par Aude le dimanche, 30 mai, 2021, 10h09 - Textes
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais… Alors que la situation sanitaire qui s’impose à nous depuis plus d’un an requiert des changements de comportement importants et que changer est difficile (même quand les efforts demandés sont moindres, c’est en soi un effort que d’acquérir de nouvelles habitudes), les personnes qui prétendent la gérer nous imposent le spectacle de leur incapacité à adopter elles-mêmes les comportements auxquels elles nous contraignent avec plus d’autoritarisme que jamais.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 9 mai, 2021
Par Aude le dimanche, 9 mai, 2021, 12h06 - Textes
Évidemment qu'une maladie infectieuse se combat « ensemble » et oblige à penser les politiques de santé non comme l'organisation d'une offre de soins qu'il faudrait mériter (par ses cotisations ou son appartenance nationale) mais comme un bien commun auquel il appartient à chacun·e de prendre soin. Mais « ensemble », vraiment ?
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 5 mai, 2021
Par Aude le mercredi, 5 mai, 2021, 13h10 - Textes
Il y a cinq ans, suite aux attaques du 13 novembre, certain·es à gauche avaient érigé le fait de sortir et de boire des verres comme l'emblème de notre civilisation. Nous étions attaqué·es dans nos bars et nos restaurants, en tant que civilisation jouisseuse ? Nous allions porter haut et fort les couleurs de la liberté, rouge aux joues et pintes dorées. Et qu'importait que nos assaillant·es eussent été des petites frappes aussi volontiers alcoolisées que nous autres mais récemment converties à un cliché d'islam censé justifier leur haine et leur violence. Qu'importait aussi que cette communion républicaine subversive se fît sous les auspices d'une activité commerciale pas franchement inclusive. Qu'importait enfin que la France eût « éteint les Lumières » en cette sombre année 2015 et qu'il fallût lutter sur tant de fronts, contre le récit du choc des civilisations, contre les lois sécuritaires qui prenaient indifféremment comme cibles des terroristes et des militant·es. Qu'importait, car cette posture du petit-bourgeois satisfait des moments festifs de sa vie était bien la plus confortable.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 5 avril, 2021
Par Aude le lundi, 5 avril, 2021, 20h10 - Textes
l y a quelques jours, la polémique a fait rage autour du montage des extraits les plus racistes d’une émission des années 1990 mettant en scène une jeune femme noire dont le rôle était celui d’une potiche ironique. À propos de l’une des séquences, où celle-ci était comparée à un singe (oui), celle-ci prenait la parole en 2021 pour dire que l’ambiance dans l’équipe était très sympa et que c’était sa propre blague qui avait été utilisée dans l’émission. Les anti-racistes, qui avaient condamné les propos, étaient alors renvoyé·es à leurs pénates par les anti-anti-racistes (que j’appellerai ici pour simplifier : les racistes (1)) au motif que ce n’est pas raciste et Pepita en est juge puisqu’elle-même est une des « personnes les premières concernées ».
Contrairement à une majorité de personnes dont je partage l’engagement féministe ou les idées anti-racistes, je suis critique de la notion de « personnes les premières concernées » dont il faudrait sanctuariser les prises de position. Je ne propose pas non plus d’ignorer leurs propos mais de leur accorder une considération particulière car ils enrichissent considérablement le débat et car ils témoignent de situations en première ligne qui peuvent être douloureuses et qu’il appartient aux autres, dans une société démocratique, de ne pas négliger. Mais les sanctuariser ? Non, car non seulement ces personnes ne constituent pas un groupe homogène (dont tous les membres auraient le même statut social, le même revenu, le même lieu de résidence, la même nationalité, etc.) qui parlerait d’une seule voix mais surtout elles ont le droit, comme n’importe qui, d’avoir des idées qui leur sont propres, au-delà de l’expérience, singulière ou partagée, qui reste un substrat de notre pensée.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 24 mars, 2021
Par Aude le mercredi, 24 mars, 2021, 20h57 - Textes
Cet hiver le Haut conseil pour le climat, une instance créée en 2018 pour « apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat », a livré un rapport sur l'impact écologique du déploiement de la 5G. Ce rapport, commandé par le Sénat, anticipe une augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre due à l'utilisation de cette nouvelle technique, pourtant plus efficace que la 4G. L'empreinte carbone du numérique, aujourd'hui autour de 15 millions de tonnes par an en France, est amenée à croître ces prochaines années mais le déploiement de la 5G devrait entraîner vers 2030 un doublement de cette croissance, a minima, si ce n'est un quadruplement. Les raisons en sont le renouvellement du matériel, l'effet-rebond des consommations (soit les nouveaux usages induits par exemple par l'Internet des objets, si j'ai bien compris). Le tout nous entraînant vers une empreinte de 25 millions de tonnes bien incompatible avec les engagements déjà peu ambitieux de la France en matière d'émissions.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 19 mars, 2021
Par Aude le vendredi, 19 mars, 2021, 17h02 - Lectures
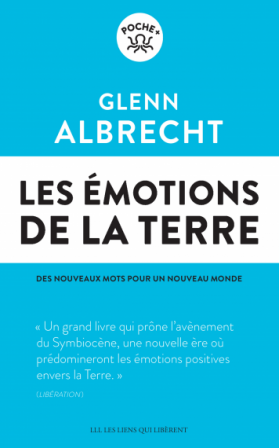 Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Lors du premier confinement, c'est un fait qui est apparu avec plus d'évidence que jamais : la nature fait du bien, au corps et à l'esprit. Or dans une société industrielle qui détruit son milieu, l'accès à la nature est restreint ou dégradé. Glenn Albrecht a nommé le malaise devant cette dégradation la solastalgie, néologisme ou plutôt mot-valise évoquant la consolation et la nostalgie, soit la douleur d'avoir perdu un milieu qui faisait du bien. Ce philosophe australien est d'ailleurs gourmand de néologismes, les siens et ceux des autres. On connaît la nostalgie (un mot inventé au XVIIe siècle pour décrire le sentiment douloureux pour un pays éloigné et, dans une acception plus récente, une époque révolue) ; l'Anthropocène, la période géologique qui a succédé à l'Holocène et se caractérise par le changement apporté par l'être humain (on y reviendra) à son milieu ; l'écocide (l'équivalent d'un crime de guerre ou crime contre l'humanité mais perpétré contre le milieu). Je dis « milieu » pour éviter cette expression récusée par l'auteur d'« environnement », bien trop anthropocentrique. À ces mots il faut ajouter ses créations propres, entre beaucoup d'autres la météoranxiété, ou angoisse devant un climat devenu imprévisible, la Terraphthora, les forces qui détruisent la Terre alors que la Terranascia est au contraire l'ensemble des forces créatrices.
Lire la suite...
aucun rétrolien
Par Aude le vendredi, 19 mars, 2021, 11h12 - Textes
Cela faisait huit semaines maintenant que nous étions suspendu·es à la menace d'un reconfinement. Le bon côté des choses, c'est que nous vivions dans l'angoisse depuis tout ce temps. L'autre bon côté des choses, c'est que nous sommes sur un plateau haut et que 2 000 personnes meurent chaque semaine du Covid (1). Et le pompon, c'est quand après tout ça, cette angoisse pour rien, ces morts évitables (combien sur les 16 000 de cette période ?), on apprend qu'on sera reconfiné·es et qu'on a gagné sur les deux tableaux.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 15 mars, 2021
Par Aude le lundi, 15 mars, 2021, 12h58 - Textes
Je suis tombée malade du Covid il y a quelques jours, avec des symptômes assez classiques et plutôt légers. Les premiers symptômes ressemblant à n’importe quelle crève, j’ai dans un premier temps pris des précautions et je ne suis allée me faire tester qu’à l’emblématique disparition de mon odorat. Et, une fois n’est pas coutume puisque d’habitude je suis plutôt un mauvais esprit, j'étais positive, donc confinée et en arrêt maladie.
Lire la suite...
aucun rétrolien
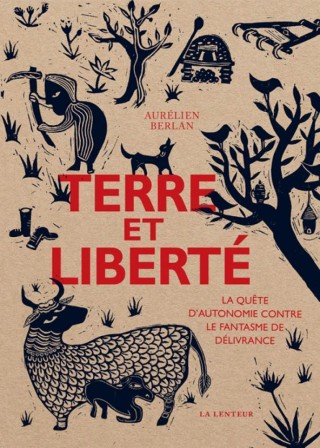 Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €
Aurélien Berlan, Terre et liberté. La Quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021, 220 pages, 16 €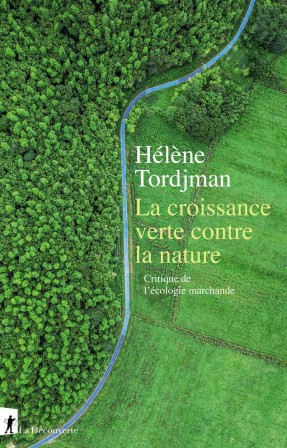 Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 €
Hélène Tordjman, La Croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte, 2021, 352 pages, 22 € La pandémie de Covid-19 s’est propagée à une vitesse jamais vue, la vitesse des classes les plus mobiles, au mode de vie le plus globalisé, de nos sociétés. Son origine est encore incertaine mais, qu’il s’agisse d’une fuite d’un labo P4 ou d’une zoonose (maladie se transmettant de l’animal à l’humain, c’est le cas de 75 % des maladies émergentes contre 60 % des maladies infectieuses classiques) due à la destruction d’écosystèmes, elle a des causes qui tiennent bien à notre modernité industrielle. Voilà qui converge avec la critique d’une partie des critiques de la technique et autres écologistes radicaux et radicales.
La pandémie de Covid-19 s’est propagée à une vitesse jamais vue, la vitesse des classes les plus mobiles, au mode de vie le plus globalisé, de nos sociétés. Son origine est encore incertaine mais, qu’il s’agisse d’une fuite d’un labo P4 ou d’une zoonose (maladie se transmettant de l’animal à l’humain, c’est le cas de 75 % des maladies émergentes contre 60 % des maladies infectieuses classiques) due à la destruction d’écosystèmes, elle a des causes qui tiennent bien à notre modernité industrielle. Voilà qui converge avec la critique d’une partie des critiques de la technique et autres écologistes radicaux et radicales.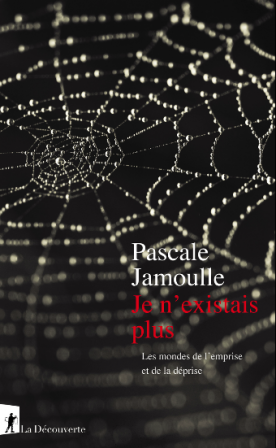 Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €
Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €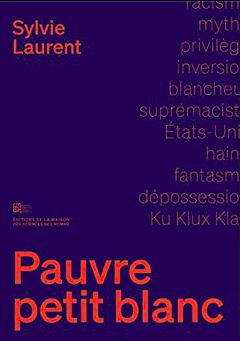 « Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.
« Amérique : L’exalter quand même, surtout quand on n’y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. » Voilà ce qu’il fallait penser des États-Unis du temps de Flaubert. Aujourd’hui il est de bon ton de déplorer tout ce qui nous arrive d’Amérique du Nord avec dix ans de retard, un peu moins depuis que les idées traversent l’Atlantique en moins d’une seconde. C’est bien connu, tout ce qui nous vient d’Amérique, plus précisément des campus états-uniens, est haïssable. Le vulgarisateur de philosophie Pascal Bruckner n’avait il y a quelques semaines à la radio (1) pas de mots assez durs contre l’expression male gaze, forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 et très en usage de nos jours chez les féministes françaises. Si l’on traduit comme il le fait gaze par regard, l’expression n’a pas lieu d’être utilisée en français, si ce n’est pour faire croire qu’on a lu Visual Pleasure and Narrative Cinema en VO. Sauf que le regard, c’est look en anglais, et que gaze est un regard appuyé qui correspond à notre verbe fixer. C’est un universel anthropologique (valable même au-delà de la barrière des espèces) : un regard appuyé est a priori agressif, on ne regarde pas autrui comme on regarde un bout de gras. C’est pourtant comme cela que les hommes s’accordent le droit de regarder les femmes, au motif de leur seul plaisir scopique et sans considération pour ce qui n’est que l’objet de leur regard. J’ai tenté un jour une traduction en français de male gaze, pour faire plaisir à Bruckner, et j’ai risqué relougarder, un mot-valise à la québécoise moyennement satisfaisant… Oui, c’est vrai que nous féministes utilisons beaucoup de mots et de concepts nés aux USA. C’est vrai que c’est parfois ridicule quand cela semble mal plaqué sur la France (le « pro-sexe » à la française, l’« inclusivité » à la française) ou que l’anglais est mal prononcé ou sert de critère de distinction sociale. Mais c’est vrai aussi que les USA accueillent beaucoup de chercheurs et chercheuses de partout, d’Amérique du Sud, d’Inde et même de France… Ça bouillonne et le résultat est partagé avec le monde entier.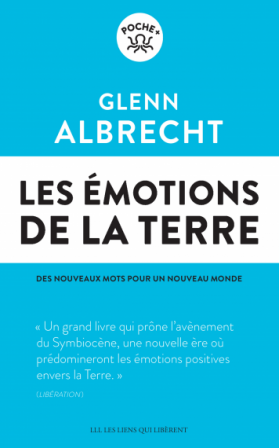 Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €