samedi, 13 mars, 2021
Par Aude le samedi, 13 mars, 2021, 20h55 - Textes
L'an dernier, un 13 mars, les rumeurs d'une action publique très dure pour assurer la santé de tou·tes m'avaient poussée à écrire sur cette notion de santé publique. Sur ce qu'est la santé en régime capitaliste, un secteur marchand dont le premier objectif est de faire du profit. Sur notre refus d'entendre que la santé de tou·tes suppose de prendre soin de chacun·e, y compris des personnes migrantes qui ont été privées d'accès aux soins en France dans les années 1990. Nous avions oublié, en raison notamment de la faible prévalence des maladies infectieuses, que la santé était un bien commun.
Cette année nous avons compris qu'on ne peut pas se protéger, se soigner seul·e. Nous avons compris ce qui nous unit.
Et pourtant, nous continuons sur notre lancée.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 11 mars, 2021
Par Aude le jeudi, 11 mars, 2021, 12h26 - Textes
Nous sommes nombreuses (1) à devoir vivre avec le souvenir d’agressions ou d’abus restés impunis et qui n’ont donné lieu, au mieux, qu’à des excuses merdiques qui ont sûrement été l’occasion pour leurs auteurs de se faire briller l’ego une fois de plus mais nous laissent, à nous, un goût amer. Parce que derrière l’évidence de cette figure imposée (on demande pardon) il y a souvent une incompréhension de ce qui se joue et un refus d’aller jusqu’au bout de la démarche.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 8 mars, 2021
Par Aude le lundi, 8 mars, 2021, 08h08 - Lectures
 Sandrine Rousseau et François-Xavier Devetter, Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Raisons d'agir, 2011
Sandrine Rousseau et François-Xavier Devetter, Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Raisons d'agir, 2011
Écrit il y a maintenant dix ans, sous l’ère Sarkozy, Du balai reste un livre précieux. Les gouvernements de droite qui s’étaient succédé depuis 2002 s'étaient attachés à réinventer les emplois domestiques et à exploiter les « gisements d'emploi » en accordant des avantages fiscaux aux particuliers qui consentiraient à créer de nouveaux emplois en recourant aux services de femmes de ménage. Rousseau et Devetter, conjuguant des approches économiques et sociologiques, faisaient de ces politiques un constat accablant. Passées les premières mesures incitatives, les encouragements se faisaient toujours plus coûteux et pour un résultat toujours moindre (jusqu'à 50 000 € par emploi, si j'ai bonne mémoire car je n'ai pas relu le livre depuis sa publication – mais Morel et Carbonnier, dans un livre plus récent chroniqué ici-même, fournissent une évaluation encore plus sévère). Ces politiques s’inscrivaient surtout dans un mouvement d’allégement des impôts des ménages les plus aisés. Les deux auteur·es démontraient en effet que le critère déterminant le plus fortement le recours aux emplois domestiques de nettoyage n’était ni le temps travaillé du couple, ni celui de la femme mais leur revenu, tout simplement. Se payer une femme de ménage ne correspond pas tant à un besoin qu’à un cadeau qu’on s’offre parce qu’on en a les moyens.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 28 février, 2021
Par Aude le dimanche, 28 février, 2021, 10h09 - Lectures
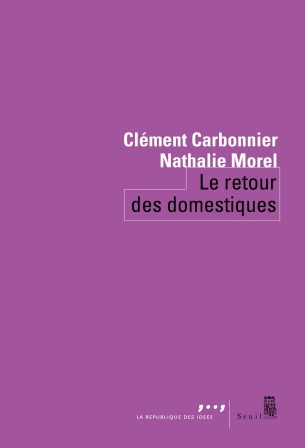 Clément Carbonnier et Nathalie Morel, Le Retour des domestiques, Le Seuil, 2018, 112 pages, 11,80 €
Clément Carbonnier et Nathalie Morel, Le Retour des domestiques, Le Seuil, 2018, 112 pages, 11,80 €
C'est en 1991, sous un gouvernement socialiste, que la France s'engage dans une stratégie de création d'emplois domestiques. La désindustrialisation et les gains de productivité ont fait perdre beaucoup d'emplois « du milieu de la distribution des revenus » et il s'agit alors d'exploiter un « gisement » d'emplois dans les services. L'outil qui est alors mis en œuvre, c'est la défiscalisation des dépenses des ménages à hauteur de 50 %, le tout dans une limite de 3 800 € par an. Les décennies suivantes verront ce seuil évoluer, à la baisse puis à la hausse, sans que soit fondamentalement remis en question le principe de faire assurer par la collectivité la moitié de ces dépenses privées par des impôts non-perçus. En 2003 cette limite est relevée à 10 000 €, puis à 12 000 € par le plan Borloo deux ans plus tard.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 7 février, 2021
Par Aude le dimanche, 7 février, 2021, 11h00 - Lectures
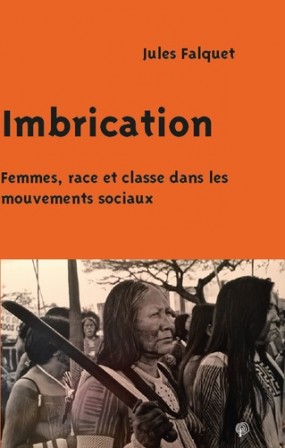 Jules Falquet, Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, éditions du Croquant, 2020, 302 pages, 15 €
Jules Falquet, Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, éditions du Croquant, 2020, 302 pages, 15 €
Depuis plus de trente ans, la sociologue Jules Falquet travaille sur les mouvements féministes et lesbiens en Amérique latine et dans les Caraïbes (ou Abya Yala, un terme autochtone qui se diffuse sur le continent). Imbrication est un riche recueil d’articles réécrits à partir de ses travaux antérieurs sur divers terrains de recherche : avec des militantes salvadoriennes peinant à faire valoir leurs droits auprès de leurs camarades révolutionnaires ; avec des Indiennes du Chiapas qui édictent leurs droits en tant que femmes malgré des conflits de loyauté avec leurs communautés ; autour d’un collectif d’intellectuelles lesbiennes noires aux États-Unis qui observent l’imbrication de rapports sociaux qui leur sont tous défavorables ; avec des féministes noires posant les bases de leur engagement au niveau continental ; avec des féministes latino-américaines observant l’ONGisation de leur mouvement. Ce sont toutes des femmes en lutte mais majoritairement des intellectuelles (lesbiennes, ce que rappelle Falquet, qui se présente elle-même comme lesbienne, blanche et appartenant à la petite bourgeoisie académique) et même si leurs débats semblent nourris d’expériences militantes et d’organisation populaire, il n’est pas toujours facile de comprendre le lien entre théorie et pratiques.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 12 décembre, 2020
Par Aude le samedi, 12 décembre, 2020, 13h04 - Lectures
Kate Pickett et Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! Comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous, Les Liens qui libèrent, 2020, 416 pages, 8,90 €
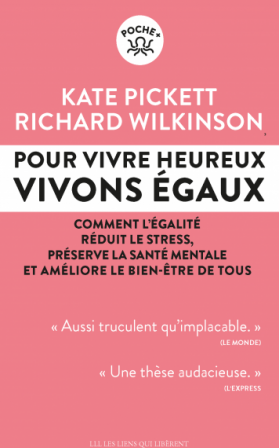
On se doutait que l'inégalité est préjudiciable aux personnes en bas de la hiérarchie, qu'elle est responsable de maux physiologiques et psychologiques. Les hommes de classe populaire meurent jusqu'à dix ans plus tôt que les cadres et à l'extrême, le dénuement cause jusqu'à des retards de développement chez les enfants mal nutris. Mais ce que nous apprennent Pickett et Wilkinson, c'est que l'inégalité s'attaque au bien-être dans l'ensemble de la société. Les deux Britanniques, déjà auteur·es d'un ouvrage intitulé Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous (Les Petits Matins, 2013), s'attaquent ici plus précisément aux questions de santé mentale à partir de leurs recherches en épidémiologie, soit une approche statistique des questions sanitaires. Leur propos se fonde sur des corrélations entre les inégalités économiques et d'autres faits établis (la proportion de personnes schizophrènes, d'enfants victimes de harcèlement scolaire, les performances en mathématiques) dans une variété de pays, majoritairement européens et anglo-saxons (ainsi que le Japon et Singapour), et quand il s'agit d'indicateurs plus communs le panel est encore élargi à des pays moins bien étudiés. Puisque une corrélation ne prouve rien, elle et il vont chercher dans la psychologie expérimentale, l'économie ou l'anthropologie physique et sociale de quoi étayer leurs hypothèses. Leur ouvrage est dense, leur approche quantitative leur permet de couvrir nombre de sujets, au point de parfois noyer leur lectorat sous les tableaux, mais le résultat est passionnant. Et il constitue un désaveu criant du choix de l'inégalité qui a été fait depuis environ 1980 dans les économies développées.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 30 novembre, 2020
Par Aude le lundi, 30 novembre, 2020, 09h11 - Lectures
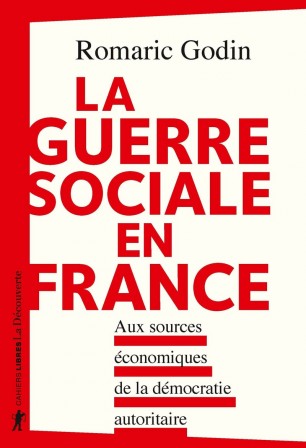 Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €
Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €
L’an dernier sortait un ouvrage important, destiné à nous sortir de la sidération devant la situation actuelle : une sorte de blitzkrieg d’un néolibéralisme longtemps contenu en France. Romaric Godin, journaliste économique à La Tribune puis à Mediapart, y fait dans un premier temps l’histoire du néolibéralisme, cette idéologie apparue dès la première moitié du XXe siècle mais tardivement épanouie (1). Aujourd’hui le néolibéralisme constitue une vérité révélée pour nombre d’économistes, il est perçu comme un « "consensus scientifique" en économie » mais « repose sur des prémisses (...) fort contestables sur le plan théorique et (…) très fortement remis en cause par les faits ». Cette doctrine, qui vise la neutralité du marché, refuse tout rôle redistributif à l’État, à contre-courant du compromis français établi en 1936 puis 1945 et qui pose l’État en arbitre entre les exigences du capital et les besoins d’un peuple de travailleurs et de travailleuses.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 25 octobre, 2020
Par Aude le dimanche, 25 octobre, 2020, 12h13 - Lectures
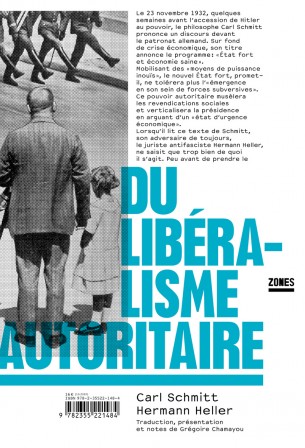 Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
La collection Zones réédite une polémique qui date de quelques mois avant la concession du pouvoir à Hitler en Allemagne en 1933. Carl Schmitt, juriste conservateur, sur le point de rejoindre les rangs nazis, fait allégeance au pouvoir économique rhénan (il est l'invité d'une « société au long nom » d'entrepreneurs du sud-ouest du pays). Quelques semaines après, Hermann Heller, social-démocrate et juif, lui répond. L'ouvrage est introduit par le directeur de collection, Grégoire Chamayou, auteur de ce livre remarquable qu'est La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire (La Fabrique, 2018). Il s'agit donc ici de poursuivre l'histoire qu'il fait du libéralisme autoritaire, oxymore aujourd'hui au pouvoir un peu partout dans le monde.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 4 octobre, 2020
Par Aude le dimanche, 4 octobre, 2020, 11h52 - Lectures
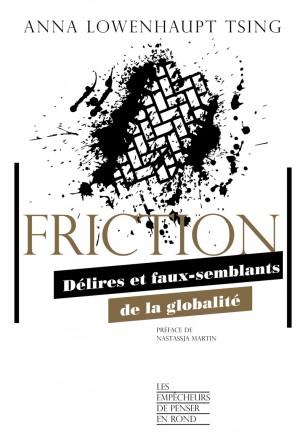 Friction. Délires et faux-semblants de la globalité, Anna Lowenhaupt Tsing, La Découverte, 2020, 460 pages, 24 €
Friction. Délires et faux-semblants de la globalité, Anna Lowenhaupt Tsing, La Découverte, 2020, 460 pages, 24 €
En 1998, le leader autoritaire indonésien Suharto doit abandonner le pouvoir. Les années qui suivent sont celles de la Reformasi, mouvement de démocratisation qui est aussi une période de grande insécurité : la déforestation s'accélère et l'armée empoche les dessous de table. Anna Tsing écrit dans les années suivantes, depuis l'île de Bornéo, cet ouvrage, Friction, où il est question d'un aventureux entrepreneur canadien, d'étudiant·es amateurs de nature, d'une femme qui cite une millier d'espèces animales et végétales présentes autour d'elle, de chef·fes de village capables de parler la langue des écologistes comme celle des développeurs. Entre autres. L'autrice, connue du lectorat français pour son livre Le Champignon de la fin du monde (La Découverte, 2017), est anthropologue et travaille depuis les années 1980 à Bornéo (ou Kalimantan), dans la partie indonésienne de cette île, la plus grande de l'archipel, jadis couverte de forêts équatoriales.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 14 septembre, 2020
Par Aude le lundi, 14 septembre, 2020, 08h59 - Textes
Il existe en français des adjectifs qui ne peuvent pas être modalisés, renforcés par très ou atténués par un peu. On ne dit pas *très formidable, *assez délicieux, *un peu sublime. C'est ou ce n'est pas essentiel, admirable, horrible. Ou alors c'est qu'on a oublié le sens même de ces mots, qui a un caractère absolu. Les autres adjectifs appellent la modalisation, la nuance. Et ceux-là sont beaucoup plus nombreux. Parce que les choses dans notre expérience nous arrivent rarement toutes blanches ou toutes noires, elles obéissent à une certaine gradation : un plat est plus ou moins bon, salé, épicé, une personne est plus ou moins intelligente, malveillante, originale.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 29 août, 2020
Par Aude le samedi, 29 août, 2020, 14h16 - Textes
Le soir du jeudi 12 mars, je m'étais couchée très en colère : osaient parler de « santé publique » ceux qui avaient traité le soin comme une marchandise et en avaient exclu une partie du corps social (les personnes en séjour irrégulier, voir ici) comme si la santé n'était pas un bien commun, à entretenir ensemble, d'autant plus dans le contexte de maladies infectieuses et contagieuses. Quelques jours plus tard, nous étions sommé·es de participer à un effort de réduction des risques extrêmement coûteux, conçu par en haut, inadapté à la réalité des personnes les plus fragiles de ce pays, les mal logé·es, les sans balcon ni jardin, les qui vivent seul·es ou à trop de monde, bref tout ce qui n'est pas un homme aisé en télétravail sur la terrasse pendant que maman s'occupe des gosses. Le tout pendant que les travailleurs et travailleuses exposé·es, les indispensables, les « premier·es de corvée », allaient trimer dans des lieux peu ou pas sécurisés, prenant des transports en commun toujours aussi bondés (il y avait moins de fréquence) alors que le gouvernement nous expliquait que nous ne devions pas porter de masques pour réduire la propagation du virus dans ces situations parfaites pour lui (densité humaine, intérieur mal aéré).
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 24 août, 2020
Par Aude le lundi, 24 août, 2020, 10h02 - Lectures
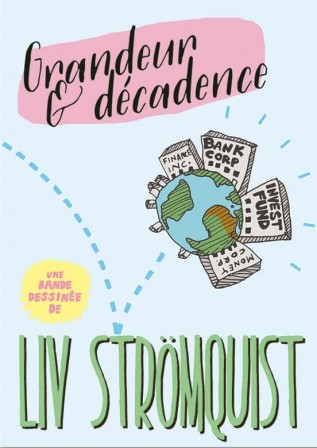 Grandeur et décadence, Liv Strömquist, Rackham, 2017, 128 pages, 20 €
Grandeur et décadence, Liv Strömquist, Rackham, 2017, 128 pages, 20 €
Je ne sais pas ce qui m'avait retenu tout ce temps de lire Grandeur et décadence, présent dans mes étagères depuis quelques années, cadeau de Noël ou d'anniversaire. Malgré tout le bien que je pense des Sentiments du prince Charles, une mauvaise appréciation m'avait retenue d'ouvrir ce livre-là : il y était question de capitalisme et le propos de Strömquist n'avait rien d'original, m'avait-on dit. J'avais peur de lire la énième BD dans la lignée d'Attac. C'est pourtant un ouvrage très original. Dans le style un peu bordélique des précédents, qui mêle histoires people et théorie politique, Strömquist livre une série d'essais (au sens traditionnel de tentative de réflexion) très stimulants qui interrogent l'infrastructure psychique du capitalisme.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 3 août, 2020
Par Aude le lundi, 3 août, 2020, 09h58 - Textes
C'est un beau dimanche de juillet et je vais réparer mon vélo sous la supervision amicale de F. dans le squat où il vit. F. a été réparateur de vélos dans une autre vie mais aujourd'hui il partage son temps entre des cours de français pour les migrant·es, des carcasses de vélo remontées entièrement et ce qui lui chante, comme d'aider des gens comme moi le dimanche à réparer leur biclou. Je dois être la seule cet aprem qui peut se payer les transports en commun ou les services d'un vélociste, les autres sont fauché·es comme les blés, avec ou sans papiers (la preuve que le vélo, c'est vraiment un truc de bobos). Heureusement pour nous qu'il y a l'atelier du dimanche. Derrière la verrière sous laquelle on transpire abondamment (mais rassurez-vous, il y fait très froid en hiver, ça équilibre), un petit jardin et une petite piscine gonflable. Un truc écrit sur la porte de sortie : « Si ta dernière douche ne date pas d'aujourd'hui, rince-toi avant de rentrer dans la piscine. » Voilà : tout ça pour dire que mêmes chez les anars, y'a des règles.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 19 juillet, 2020
Par Aude le dimanche, 19 juillet, 2020, 21h15 - Lectures
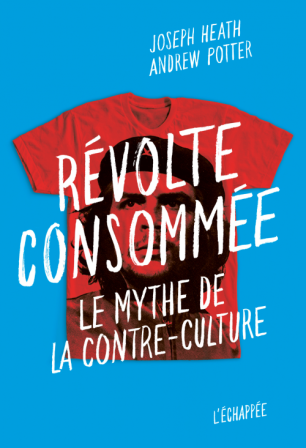 Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée. Le Mythe de la contre-culture, traduit de l'anglais par Élise de Bellefeuille et Michel Saint-Germain, L'Échappée, 2020, 368 pages, 20 €
Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée. Le Mythe de la contre-culture, traduit de l'anglais par Élise de Bellefeuille et Michel Saint-Germain, L'Échappée, 2020, 368 pages, 20 €
C'est une drôle d'idée éditoriale, que de republier un ouvrage traduit en français il y a quinze ans (1) et qui se pose aussi fièrement contre le reste de son catalogue : la technique qui dépend de ce qu'on en fait, l'agriculture bio qui n'est pas écologique, l'anarchisme qui est la loi de la jungle… Tout y est, dans cet ouvrage qui finit avec de belles propositions de réforme : un impôt sur le revenu progressif, un marché des droits à polluer et des voitures hybrides. Les amis de L'Échappée auraient-ils perdu la tête ?
Peut-être pas. Parce que malgré tout ça, Révolte consommée pose des questions que ne peuvent plus désormais éviter les ami·es de l'émancipation. Ne serait-ce que parce que la rebellitude et l'hégémonie culturelle se portent très bien à l'extrême droite, ce que les auteurs, écrivant au temps d'Empire (Hardt et Negri) et de No Logo (N. Klein), n'avaient d'ailleurs pas vu venir.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 15 juin, 2020
Par Aude le lundi, 15 juin, 2020, 09h37 - Textes
Elles prennent de l'assurance, ces voix qui condamnent notre servilité
pendant le confinement. C'est un propos qu'on attendrait chez les lecteurs et
lectrices de Henry D. Thoreau et d'Étienne de La Boétie, deux théoriciens de la
désobéissance civile, ou bien chez les anarchistes, chez celles et ceux qui
disent « non »… mais ça infuse bien plus largement. À vrai dire, il
me semble que ce n'est pas de la part de celles et ceux qui se souhaitent
ingouvernables que j'entends ces sorties rebelles mais plutôt des autres. Ce
n'est pas honteux, d'avoir éteint son esprit critique pendant le confinement
parce qu'on avait besoin
d'irénisme. On a tou·tes nos mauvais moments. Mais revenir critiquer une
servilité généralisée ?
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 12 avril, 2020
Par Aude le dimanche, 12 avril, 2020, 10h55 - Textes
 La vie politique, dans les
régimes représentatifs libéraux, est traditionnellement structurée autour des
partis (et autres corps intermédiaires comme les syndicats). Traditionnellement
mais pas de tous temps puisque avant 1848 les corps intermédiaires étaient
interdits, accusés de briser le bel unanimisme du peuple. Quand les
associations, les syndicats et les partis sont autorisés en 1848, cette
disposition est l'occasion pour des classes qui jusqu'ici avaient été tenues à
l'écart de la vie publique, et pas seulement par le suffrage censitaire, d'y
participer pleinement. Avant 1848, être élu supposait d'avoir les moyens de
mener campagne sur des ressources individuelles. Après 1848, non seulement tout
le peuple est invité à voter (tout le peuple ? à l'exception des femmes,
soit de sa moitié) mais en plus il gagne le droit de s'auto-organiser dans des
structures qui lui permettent de mettre en commun des moyens pour peser dans le
débat public – et plus concrètement de s'organiser dans son bras de fer avec
ses employeurs. En théorie, les corps intermédiaires portent une dimension
démocratique du gouvernement représentatif (lequel est, en théorie aussi,
faiblement démocratique).
La vie politique, dans les
régimes représentatifs libéraux, est traditionnellement structurée autour des
partis (et autres corps intermédiaires comme les syndicats). Traditionnellement
mais pas de tous temps puisque avant 1848 les corps intermédiaires étaient
interdits, accusés de briser le bel unanimisme du peuple. Quand les
associations, les syndicats et les partis sont autorisés en 1848, cette
disposition est l'occasion pour des classes qui jusqu'ici avaient été tenues à
l'écart de la vie publique, et pas seulement par le suffrage censitaire, d'y
participer pleinement. Avant 1848, être élu supposait d'avoir les moyens de
mener campagne sur des ressources individuelles. Après 1848, non seulement tout
le peuple est invité à voter (tout le peuple ? à l'exception des femmes,
soit de sa moitié) mais en plus il gagne le droit de s'auto-organiser dans des
structures qui lui permettent de mettre en commun des moyens pour peser dans le
débat public – et plus concrètement de s'organiser dans son bras de fer avec
ses employeurs. En théorie, les corps intermédiaires portent une dimension
démocratique du gouvernement représentatif (lequel est, en théorie aussi,
faiblement démocratique).
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 30 mars, 2020
Par Aude le lundi, 30 mars, 2020, 14h45 - Textes
Le besoin d'être ensemble qui nous caractérise, nous humain·es grégaires,
s'exprime d'autant plus fort que nous sommes tenu·es à des mesures de
confinement en cette période de pandémie. Il trouve tous les moyens de
s'exprimer : on appelle les personnes qu'on aime ou dont on sait qu'elles
sont les plus seules et vulnérables, on communique maladivement sur les réseaux
sociaux et les moyens les plus inventifs sont trouvés pour être ensemble à
distance : applaudissements depuis chez soi pour les soignant·es à 20 h
chaque soir, bougie à la fenêtre pour une fête chrétienne. On a tellement envie
d'unanimité que
Macron a remonté dans les sondages, prenant 50 % de points en plus,
après son discours de mobilisation. Une chèvre aurait fait l'affaire, peut-être
même beaucoup mieux : aucune chèvre n'a lutté contre les soignant·es
pendant les mois précédant la pandémie de coronavirus pour leur imposer une
énième baisse des moyens de l'hôpital public.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 21 mars, 2020
Par Aude le samedi, 21 mars, 2020, 13h16 - Textes
Le 6 mars, monsieur le président se rendait au théâtre. On n'allait pas
se laisser abattre : « La vie continue. Il n’y a aucune raison,
mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de
sortie. » Cinq jours plus tard, il en remettait une
couche : « Nous ne renoncerons à rien. Surtout pas à rire, à
chanter, à penser, à aimer. Surtout pas aux terrasses, aux salles de concert,
aux fêtes de soir d’été. Surtout pas à la liberté. » Deux jours après
cette sortie rappelant la grandeur de notre civilisation, avant tout celle des
loisirs marchands, Macron posait les bases de notre nouvelle vie :
rassemblements interdits, contacts physiques limités (mais pas la peine de
porter un masque, d'ailleurs on n'en a pas), privé·es de sorties sauf pour les
activités vitales (les courses, la promenade du chien, le kilomètre de marche
pour ne pas perdre la main, aller bosser dans une usine produisant des biens
pas spécialement vitaux en temps d'épidémie). Y'a pas à dire, le type voit la
fin du monde arriver avec plus de clairvoyance que Jojo et les Gilets jaunes
qui, elles et eux, ont vite compris à quel point les luttes écologistes et
démocratiques étaient aussi les leurs…
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 16 mars, 2020
Par Aude le lundi, 16 mars, 2020, 08h45 - Lectures
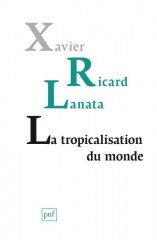 Xavier Ricard Lanata, La Tropicalisation
du monde, PUF, 2019, 128 pages, 12 €
Xavier Ricard Lanata, La Tropicalisation
du monde, PUF, 2019, 128 pages, 12 €
Et si le monde occidental, celui des pays riches et peuplés de Blanc·hes,
faisait aujourd'hui l'objet d'un processus de
« tropicalisation » ? Lanata, anthropologue et économiste du
développement, fait l'hypothèse que nous sommes à un point où le monstre
capitaliste, créé et nourri dans les pays du nord, est devenu tellement avide
que le Sud ne lui suffit plus. Jusqu'alors, l'économie capitaliste a connu des
pratiques différentes dans les pays colonisés et les pays colonisateurs. Là-bas
il était violemment prédateur, utilisant les territoires comme puits de
ressources et les populations locales comme bras pour les exploiter. Et quand
les locaux n'étaient pas assez nombreux, d'autres peuples étaient déportés pour
servir de main d’œuvre (1). La vision toxique que nous avons de l'environnement
comme d'un milieu à exploiter ne s'est jamais mieux déployée que pendant
l'histoire coloniale à son apogée, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe.
C'est alors qu'on a assisté à « la décorrélation entre les lieux de
consommation et les lieux de production, par l'extension considérable des
réseaux d'échange et des chaînes de valeur » (p. 61). Nous vivons
encore dans ces structures et ces représentations, avec plus ou moins
d'inquiétude sur le fait de toucher un jour le fond et d'arriver à épuisement
du modèle.
Lire la suite...
aucun rétrolien
vendredi, 13 mars, 2020
Par Aude le vendredi, 13 mars, 2020, 08h05 - Textes
Les soins de santé en France sont en grande partie pris en charge par un
système d'assurance collectif financé par les cotisations des un·es et des
autres et étendu à leurs proches. Il semble donc justifié par certain·es d'en
exclure les migrant·es qui n'ont pas encore cotisé : résidant depuis moins de
trois mois, en séjour irrégulier, etc. C'est une revendication assez commune à
droite et elle a été mise en œuvre par les fameuses lois Pasqua en 1993. Ce
n'est pas sous des gouvernements d'extrême droite que le ministre de Jacques
Chirac puis d'Édouard Balladur a fait refuser l'accès à l'Assurance maladie
pour les personnes en séjour irrégulier.
Lire la suite...
aucun rétrolien
 Sandrine Rousseau et François-Xavier Devetter, Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Raisons d'agir, 2011
Sandrine Rousseau et François-Xavier Devetter, Du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité, Raisons d'agir, 2011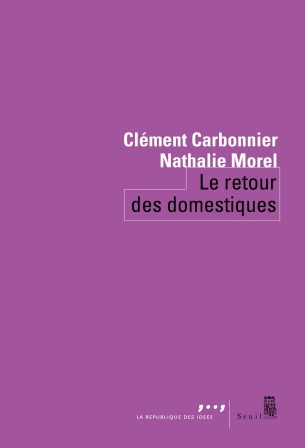 Clément Carbonnier et Nathalie Morel, Le Retour des domestiques, Le Seuil, 2018, 112 pages, 11,80 €
Clément Carbonnier et Nathalie Morel, Le Retour des domestiques, Le Seuil, 2018, 112 pages, 11,80 €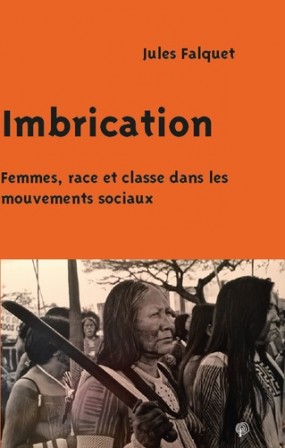 Jules Falquet, Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, éditions du Croquant, 2020, 302 pages, 15 €
Jules Falquet, Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux, éditions du Croquant, 2020, 302 pages, 15 €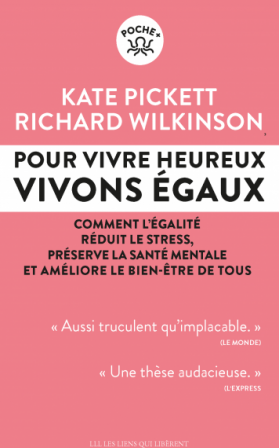
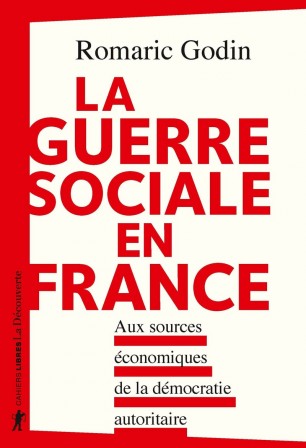 Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €
Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €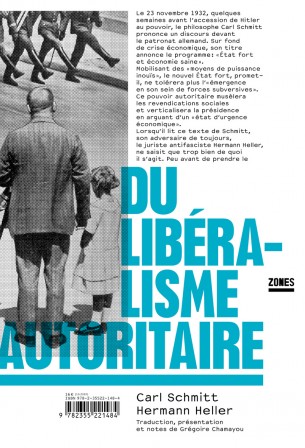 Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €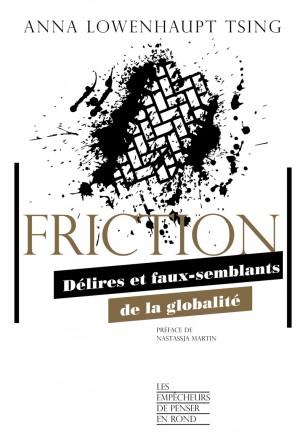 Friction. Délires et faux-semblants de la globalité, Anna Lowenhaupt Tsing, La Découverte, 2020, 460 pages, 24 €
Friction. Délires et faux-semblants de la globalité, Anna Lowenhaupt Tsing, La Découverte, 2020, 460 pages, 24 €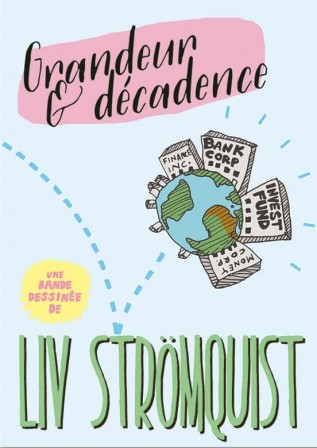 Grandeur et décadence, Liv Strömquist, Rackham, 2017, 128 pages, 20 €
Grandeur et décadence, Liv Strömquist, Rackham, 2017, 128 pages, 20 €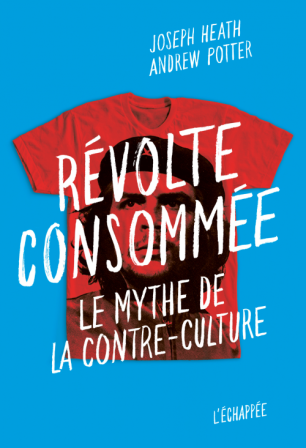 Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée. Le Mythe de la contre-culture, traduit de l'anglais par Élise de Bellefeuille et Michel Saint-Germain, L'Échappée, 2020, 368 pages, 20 €
Joseph Heath et Andrew Potter, Révolte consommée. Le Mythe de la contre-culture, traduit de l'anglais par Élise de Bellefeuille et Michel Saint-Germain, L'Échappée, 2020, 368 pages, 20 €
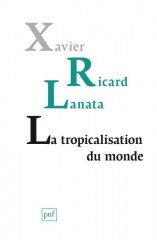 Xavier Ricard Lanata, La Tropicalisation
du monde, PUF, 2019, 128 pages, 12 €
Xavier Ricard Lanata, La Tropicalisation
du monde, PUF, 2019, 128 pages, 12 €