Je n’existais plus
Par Aude le dimanche, 13 juin, 2021, 09h40 - Lectures - Lien permanent
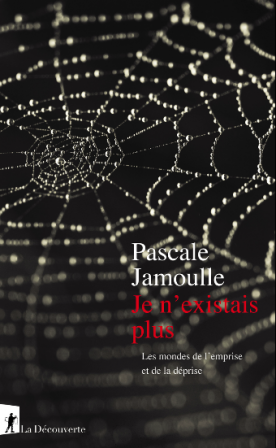 Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €
Pascale Jamoulle, Je n’existais plus. Les Mondes de l’emprise et de la déprise, La Découverte, 2021, 300 pages, 22 €
L’ouvrage de Pascale Jamoulle, une anthropologue exerçant sur des terrains français et belges, est composé de cinq parties autonomes décrivant des situations d’emprise sur des terrains bien différents. Les premières sont consacrées au parcours très singulier d’une amie de l’autrice, entre violences sexuelles, emprise dans le couple et dans une organisation politique sectaire, puis à ceux, plus brefs, de femmes victimes de violences dans le couple. Les femmes prises dans ces relations disent à quel point elles « n’existent plus », ne sont plus en mesure d’exercer leur libre arbitre. Jamoulle s’attache aux caractères systémiques de l’emprise, au-delà de la rencontre entre deux personnes. Ces phénomènes d’emprise sont très marqués par la domination masculine et des représentations de mise à disposition (sexuelle, domestique, affective) des femmes. Celles-ci sont d’autant plus susceptibles de s’y engager qu’on socialise les filles à la docilité et au sacrifice de soi, dimension incontournable de l’amour dans les représentations traditionnelles.
Dans le troisième chapitre, Jamoulle raconte comment une famille entière subit dans les années 1970 la volonté de pouvoir d’un maître à penser pervers se présentant comme psychothérapeute autodidacte. L’histoire peut sembler anecdotique mais ces années ont été particulièrement propices à des dérives sectaires en matière de soins et de thérapies alternatives. Un couple d’enseignant·es en difficulté psychologique livrent leur famille et leurs enfants à l’autorité de cette personne prétendant faire leur bien : les filles sont privées d’éducation (le gourou adhère à une idéologie très conservatrice), les familles déchirées quand il impose que les enfants soient hébergé·es dans d’autres familles sous emprise. À cela les enfants réagissent très différemment. L’aînée, déjà étudiante, arrive à poursuivre son chemin malgré les vivres coupés, la benjamine entre sous emprise et après cet épisode renouvellera la situation avec son conjoint. Quant au cadet, on n’entend pas sa voix puisqu’il s’est suicidé peu après. Comme le montre Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations (La Discussion, 2013, réed. Pocket 2021), la violence se réplique d’une génération sur l’autre, en formatant les individus aux relations violentes, côté victime ou côté bourreau.
Dans les deux derniers chapitres, Jamoulle aborde l’emprise dans un cadre moins privé et domestique. Et aussi plus masculin. Elle étudie les effets de leurs conditions de travail sur des livreurs ubérisés, sur le modèle décrit par Ken Loach dans son film Sorry We Missed You. Son analyse met en évidence l’accroche progressive des livreurs par leurs donneurs d’ordres, avec des conditions qui empirent au fur et à mesure que les livreurs se sont investis dans ce travail et ont fini d’en peser les avantages et les inconvénients. Le superviseur tire sur la corde d’autant plus que les travailleurs sont accrochés. Un élément interne les rend d’autant plus vulnérables, c’est la place accordée au travail dans leur système de valeur. En chier au boulot sans se plaindre fait partie de leur ethos, pleinement adapté à un monde néolibéral qui précarise, ce qui réduit d’autant leur capacité d’action, rétifs comme ils sont à l’organisation ouvrière. L’absence de régulation due à leur statut les envoie dans la gueule du loup sans espoir de pouvoir se défendre.
Néanmoins, cette situation d’exploitation sans merci contre laquelle il semble impossible ou illégitime de se rebeller ne fait pas dire à ses victimes qu’elles « n’existaient plus » car les personnes y semblent moins engagées intimement. Il ne semble pas y avoir ici de relation interpersonnelle d’emprise ou de manipulation, enchâssée avec le lien de subordination et d’exploitation, comme dans les récits de harcèlement au travail. Le superviseur exploite au maximum la disponibilité des livreurs mais n’entre pas dans leur intimité, comme je l’ai vécu personnellement, malgré les cadres plus protecteurs du salariat et d’une administration, une situation que j’ai racontée ici et ailleurs.
Et dans le cinquième chapitre, aussi poignante soit l’histoire d’abandon d’une cité marseillaise défavorisée aux mains de réseaux criminels, la qualification d’emprise semble là encore compliquée à utiliser dans les mêmes termes que dans les chapitres précédents. On n’entend pas les ados au premier chef concernés par l’intégration au réseau (avec la même logique de séduction, hameçonnage et exploitation, la menace en plus en cas de défection, que les entreprises de logistique) et il y est surtout question de l’organisation des mères pour protéger la cité du rôle toxique joué par ces réseaux, de leur puissance accrue par l’action collective, de leurs vulnérabilités propres et de leurs forces, amplifiées par leur statut social de femmes racisées. C’est encore une fois la régulation par un collectif plutôt que l’abandon de chacun·e à son sort qui donne les moyens de lutter contre des systèmes dans lesquels prolifèrent des personnes peu respectueuses de l’intégrité des autres mais parle-t-on toujours d’emprise ? Si cette suite de monographies est passionnante, elle semble néanmoins un peu hétéroclite.
Les trois premiers chapitres explorent dans les détails cette situation où un être humain abandonne son autonomie, sa volonté propre, à un autre. L’existence de telles situations invitent à dépasser l’exigence de « consentement », qui est peu attentive aux effets de captivité et aux vulnérabilités. Trop jeune, vulnérable ou sous emprise, l’individu ne peut pas consentir, pas plus qu’il n’est en mesure de refuser. Comprendre ce qui se joue là-dedans, ce qui manque pour reprendre contact avec soi-même, ses désirs et tout simplement ses besoins, est essentiel pour combattre ces violences interindividuelles, intimes mais qui pâtissent aussi d’un défaut de régulation collective et sociale. Je n’existais plus y apporte une contribution intéressante.