Les Émotions de la Terre
Par Aude le vendredi, 19 mars, 2021, 17h02 - Lectures - Lien permanent
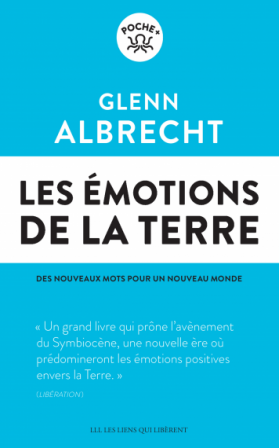 Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Lors du premier confinement, c'est un fait qui est apparu avec plus d'évidence que jamais : la nature fait du bien, au corps et à l'esprit. Or dans une société industrielle qui détruit son milieu, l'accès à la nature est restreint ou dégradé. Glenn Albrecht a nommé le malaise devant cette dégradation la solastalgie, néologisme ou plutôt mot-valise évoquant la consolation et la nostalgie, soit la douleur d'avoir perdu un milieu qui faisait du bien. Ce philosophe australien est d'ailleurs gourmand de néologismes, les siens et ceux des autres. On connaît la nostalgie (un mot inventé au XVIIe siècle pour décrire le sentiment douloureux pour un pays éloigné et, dans une acception plus récente, une époque révolue) ; l'Anthropocène, la période géologique qui a succédé à l'Holocène et se caractérise par le changement apporté par l'être humain (on y reviendra) à son milieu ; l'écocide (l'équivalent d'un crime de guerre ou crime contre l'humanité mais perpétré contre le milieu). Je dis « milieu » pour éviter cette expression récusée par l'auteur d'« environnement », bien trop anthropocentrique. À ces mots il faut ajouter ses créations propres, entre beaucoup d'autres la météoranxiété, ou angoisse devant un climat devenu imprévisible, la Terraphthora, les forces qui détruisent la Terre alors que la Terranascia est au contraire l'ensemble des forces créatrices.
Le propos d'Albrecht se fonde sur sa biographie, dans un premier temps, de jeune rural australien éduqué à la faune et à la flore locales par ses grand-parents, puis par l'observation d'un territoire dégradé par l'extraction minière, la Upper Hunter Valley dans les Nouvelles Galles du Sud. Il décrit un paysage éventré par les mines de charbon à ciel ouvert et ses habitant·es solastalgiques, accablé·es par la perte de leur milieu, en colère contre la compagnie, affligé·es par la perte de valeur de leurs maisons. Comme les Aborigènes depuis trois cents ans, ces Occidentaux découvrent ce que cela fait, de se voir privé·e de son milieu, de ses terrains de chasse, de ses lieux rituels, des terres où l'on a des souvenirs. Albrecht choisit de confondre dans les sentiments négatifs qui peuvent s'emparer de chacun·e à la vue d'un paysage dégradé des sentiments esthétiques, des sentiments d'attachement, des pertes bien matérielles de subsistance ou des dangers sanitaires dus à la pollution d'un cours d'eau, à la déforestation d'une région, au changement climatique responsable d'incendies ou de maladies de la flore. Et c'est un peu gênant car sans en faire la hiérarchie, on peut admettre que tous ces sentiments ne se valent pas.
Albrecht tient à conter une histoire, à fonder un mythe. Les forces terraphthoriennes contre les forces terranaissantes, l'humanité pouvant choisir d'être la seconde alors que depuis trois siècles elle est la première. Le combat sera culturel. Il s'appuie beaucoup sur Avatar, ce film dont le succès a précipité en France le verrouillage de l'équipement en numérique des salles de cinéma (désolée pour les détails bien matériels, c'est ce que cela m'évoque) et dont l'histoire met en scène le combat d'une humanité avide et destructrice alors que les natifs anthropoïdes vivent en symbiose avec la nature. Le récit d'Albrecht est simple comme un film hollywoodien, bien trop simple. Et il est en fin de compte faux. « À qui profitent in fine l'exploitation de ces mines à ciel ouvert et l'écrêtage des montagnes pour extraire le charbon ? » À l'humanité, bien entendu, riches et pauvres communiant dans leur contentement d'avoir de l'électricité, et non aux compagnies multinationales de l'énergie qui se sont battues contre la prise de conscience du changement climatique et qui se battent encore contre des mesures politiques volontaristes pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre des pays les plus responsables du changement climatique. Il faudra attendre la page 163 pour entendre parler de « rapports sociaux pathologiques » (un peu, oui !) et la page 166 pour qu'il soit enfin question de capitalisme.
Glenn Albrecht est également fermier et se dit « anarchiste ». Un peu comme James C. Scott, l'anthropologue et politiste états-unien, mais la comparaison s'arrête là car dès le début Albrecht reprend le récit bien connu de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs qui avaient une vie matérielle si dure, les pauvres, heureusement la civilisation et les États ont inventé l'abondance et c'est de ce trop d'abondance que notre milieu souffre aujourd'hui, ce qui nous saute aux yeux après cet âge d'or sans guerre (1) des Trente Glorieuses. Voilà qui a été brillamment réfuté par Scott dans Homo domesticus. Quand à l'anarchisme… si c'était une absence de considération pour les rapports de pouvoir dans le monde social, pourquoi pas, seulement voilà, l'anarchisme combat ces rapports d'abord en les dévoilant, tandis qu'Albrecht les nie.
Il souhaite voir dépassée la démocratie pour voir advenir une Sumbiocratie qui rende compte de l'interdépendance de tous les êtres vivants sur cette Terre, vague « gouvernance » emmenée par les « humains de bonne volonté », plus précisément des personnes qui ont une « profonde compréhension » des questions en jeu, soit des experts. Et précise que ce nouveau régime ne sera ni de droite ni de gauche. Certes on peut être d'accord avec lui sur le peu d'intérêt écologique du socialisme ou capitalisme d'État mais il refuse même de la gauche la notion de solidarité. Déroulons l'utopie et regardons de quoi sera fait son Symbiocène : d'abord d'un symbiofilm qui recouvrira toutes les saletés de monde d'avant et les ensevelira à jamais, ensuite des emballages en cellulose, des champignons domestiques qui créeront pour nous des matières nouvelles, de l'exploration spatiale (!), de l'énergie solaire photovoltaïque mais avec des cellules organiques compostables et autres énergies décentralisées, le refus des brevets et le mélange à la mode permaculture-agriculture bio-agriculture biodynamique. Cette allusion à la biodynamie est complétée par une présentation sommaire de la pensée de Rudolf Steiner, expert en tout (agronomie, architecture, médecine, pédagogue et bien sûr philosophie) et maître à penser d'un mouvement parfois qualifié de sectaire qui livre le même gloubi-boulga indigeste sur les émotions, la connexion avec les énergies de la nature, etc. Mouvement qui parie lui aussi, pour changer la société, sur le changement culturel par la création de « pôles où germine une contre-société. Qu’ils soient scolaires, médicaux, économiques ou agricoles, ces îlots s’emploient à "régénérer spirituellement" les individus. C’est en changeant les consciences qu’on agit sur l’ensemble de la société, estimait Steiner » (2).
Les Émotions de la Terre est composé de laborieux chapitres abordant superficiellement des éléments d'histoire naturelle qui étaient déjà en 2019 des topos de la pensée écologiste (la symbiose, les mycéliums, les bactéries de notre intestin (3)), ainsi que de bribes de récits anthropologiques qui mélangent toutes les sagesses « indigènes » (en français, l'indigène étant le sujet colonial, on dit plus volontiers autochtone et ce n'est pas le seul défaut de cette traduction) dont aborigènes d'Australie. C'est assez indigent, surtout quand on a pris la peine de découvrir chez Philippe Descola la variété des représentations de leur lien avec le milieu qu'ont les peuples autochtones (et les autres) ou qu'on sait l'immensité de la littérature anthropologique sur les Aborigènes d'Australie.
Le dernier chapitre, le plus « politique », multiplie les erreurs et les imprécisions et continue à fatiguer la lectrice de bonne volonté. Une seule réflexion intéressante dans tout le livre, celle de la taille idéale d'une communauté politique. Albrecht cite le théologien Reinhold Niebuhr : « Plus le groupe est grand, plus il s'exprimera de façon égoïste au sein de la communauté humaine. » C'est vrai que les habitant·es de Nauru n'ont fait chier personne en sciant la branche sur laquelle elles et ils étaient assis·es. Plus sérieusement, on peut en effet se demander dans quelle mesure l'éloignement géographique ne contribue pas à l'éloignement politique entre le milieu, les gens qui y vivent et ceux qui sont aujourd'hui les plus grands responsables des dégradations écologiques : les États qui distribuent des licences d'exploitation ou décident de projets d'aménagement et les grandes entreprises qui les mettent en œuvre. Maigre récolte pour trois cents pages, et rien sur une question assez proche, celle de la technique et du degré de complexité à partir duquel une technique dégrade le rapport des humains entre eux et avec la nature.
Une question se pose devant ce malheureux livre : l'attention à la santé mentale et au bien-être psychologique est-elle par essence apolitique et ignorante des logiques sociales ? Non, c'est ce que montraient dans la même collection Kate Pickett et Richard Wilkinson dans Pour vivre heureux, vivons égaux !, ouvrage chroniqué ici-même. C'est donc un choix regrettable de l'auteur que de dépolitiser à ce point la question importante de l'effet sur nos psychismes des dégradations du milieu. Et pourquoi pas des autres caractères pathogènes (pas que les jeux vidéo (4)) de nos vies dans des sociétés industrielles.
(1) Enfin si, écrit-il en notes, mais les autres « ont des impacts plus limités ». Ce ne sont que des génocides rwandais et indonésien (un million de morts en 1965-1966), des sales guerres de décolonisation du Portugal (Angola, Mozambique, Guinée Bissau), des Pays-Bas (Indonésie) et de la France (Viet Nam, Algérie), des sales guerres contre-insurrectionnelles en Amérique latine, etc.
(2) Jean-Baptiste Malet, « L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme », Le Monde diplomatique, juillet 2018.
(3) Lire à ce sujet L'Entraide de Pierre Kropotkine, sa remise à jour par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, L'Entraide, l'autre loi de la jungle (je l'ai vu en conférence, c'est passionnant) et Le Charme discret de l'intestin de Giulia Enders, pas lu non plus.
(4) Albrecht blâme les jeux vidéo pour la montée de la tolérance à la violence. Les commentaires du Figaro, qui respirent la haine contre les musulman·es, les féministes, les gauchistes et le reste du monde, ne sont pourtant pas le fait de joueurs assidus. Cet « ensauvagement » dont on blâme depuis des décennies (peut-être des siècles) la jeunesse prolétaire est surtout, quand on l'examine à plus longue focale, un essor mondial de l'extrême droite et des extrémismes religieux.