vendredi, 19 mars, 2021
Par Aude le vendredi, 19 mars, 2021, 17h02 - Lectures
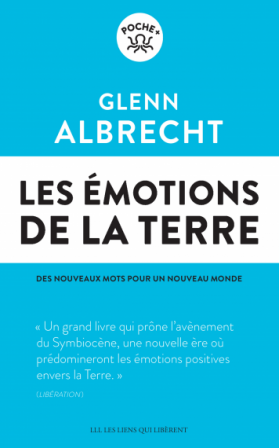 Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Lors du premier confinement, c'est un fait qui est apparu avec plus d'évidence que jamais : la nature fait du bien, au corps et à l'esprit. Or dans une société industrielle qui détruit son milieu, l'accès à la nature est restreint ou dégradé. Glenn Albrecht a nommé le malaise devant cette dégradation la solastalgie, néologisme ou plutôt mot-valise évoquant la consolation et la nostalgie, soit la douleur d'avoir perdu un milieu qui faisait du bien. Ce philosophe australien est d'ailleurs gourmand de néologismes, les siens et ceux des autres. On connaît la nostalgie (un mot inventé au XVIIe siècle pour décrire le sentiment douloureux pour un pays éloigné et, dans une acception plus récente, une époque révolue) ; l'Anthropocène, la période géologique qui a succédé à l'Holocène et se caractérise par le changement apporté par l'être humain (on y reviendra) à son milieu ; l'écocide (l'équivalent d'un crime de guerre ou crime contre l'humanité mais perpétré contre le milieu). Je dis « milieu » pour éviter cette expression récusée par l'auteur d'« environnement », bien trop anthropocentrique. À ces mots il faut ajouter ses créations propres, entre beaucoup d'autres la météoranxiété, ou angoisse devant un climat devenu imprévisible, la Terraphthora, les forces qui détruisent la Terre alors que la Terranascia est au contraire l'ensemble des forces créatrices.
Lire la suite...
aucun rétrolien
Par Aude le vendredi, 19 mars, 2021, 11h12 - Textes
Cela faisait huit semaines maintenant que nous étions suspendu·es à la menace d'un reconfinement. Le bon côté des choses, c'est que nous vivions dans l'angoisse depuis tout ce temps. L'autre bon côté des choses, c'est que nous sommes sur un plateau haut et que 2 000 personnes meurent chaque semaine du Covid (1). Et le pompon, c'est quand après tout ça, cette angoisse pour rien, ces morts évitables (combien sur les 16 000 de cette période ?), on apprend qu'on sera reconfiné·es et qu'on a gagné sur les deux tableaux.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 15 mars, 2021
Par Aude le lundi, 15 mars, 2021, 12h58 - Textes
Je suis tombée malade du Covid il y a quelques jours, avec des symptômes assez classiques et plutôt légers. Les premiers symptômes ressemblant à n’importe quelle crève, j’ai dans un premier temps pris des précautions et je ne suis allée me faire tester qu’à l’emblématique disparition de mon odorat. Et, une fois n’est pas coutume puisque d’habitude je suis plutôt un mauvais esprit, j'étais positive, donc confinée et en arrêt maladie.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 13 mars, 2021
Par Aude le samedi, 13 mars, 2021, 20h55 - Textes
L'an dernier, un 13 mars, les rumeurs d'une action publique très dure pour assurer la santé de tou·tes m'avaient poussée à écrire sur cette notion de santé publique. Sur ce qu'est la santé en régime capitaliste, un secteur marchand dont le premier objectif est de faire du profit. Sur notre refus d'entendre que la santé de tou·tes suppose de prendre soin de chacun·e, y compris des personnes migrantes qui ont été privées d'accès aux soins en France dans les années 1990. Nous avions oublié, en raison notamment de la faible prévalence des maladies infectieuses, que la santé était un bien commun.
Cette année nous avons compris qu'on ne peut pas se protéger, se soigner seul·e. Nous avons compris ce qui nous unit.
Et pourtant, nous continuons sur notre lancée.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 6 janvier, 2021
Par Aude le mercredi, 6 janvier, 2021, 08h44 - Textes
Cette semaine, trente-cinq personnes sont tirées au sort pour « nourrir le pouvoir exécutif et législatif » dans la conduite de la campagne de vaccination « et d'ajuster les réponses qui doivent être apportées aux Français ». L’annonce, qui a été faite le mois dernier, a suscité beaucoup de sarcasmes : confier à n’importe qui une question aussi technique, mais vous n’y pensez pas ?
J’entends de même des conversations sur la crise sanitaire conclues d’un « je ne suis pas épidémiologiste » supposé arrêter là tout échange de vues. Non, nous ne sommes pas épidémiologistes. Ni virologues d’ailleurs, une spécialité pas moins utile dans la situation actuelle. Nous ne sommes pas mêmes médecins. Certes non.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 12 décembre, 2020
Par Aude le samedi, 12 décembre, 2020, 13h04 - Lectures
Kate Pickett et Richard Wilkinson, Pour vivre heureux, vivons égaux ! Comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous, Les Liens qui libèrent, 2020, 416 pages, 8,90 €
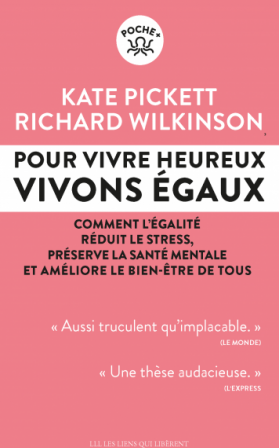
On se doutait que l'inégalité est préjudiciable aux personnes en bas de la hiérarchie, qu'elle est responsable de maux physiologiques et psychologiques. Les hommes de classe populaire meurent jusqu'à dix ans plus tôt que les cadres et à l'extrême, le dénuement cause jusqu'à des retards de développement chez les enfants mal nutris. Mais ce que nous apprennent Pickett et Wilkinson, c'est que l'inégalité s'attaque au bien-être dans l'ensemble de la société. Les deux Britanniques, déjà auteur·es d'un ouvrage intitulé Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous (Les Petits Matins, 2013), s'attaquent ici plus précisément aux questions de santé mentale à partir de leurs recherches en épidémiologie, soit une approche statistique des questions sanitaires. Leur propos se fonde sur des corrélations entre les inégalités économiques et d'autres faits établis (la proportion de personnes schizophrènes, d'enfants victimes de harcèlement scolaire, les performances en mathématiques) dans une variété de pays, majoritairement européens et anglo-saxons (ainsi que le Japon et Singapour), et quand il s'agit d'indicateurs plus communs le panel est encore élargi à des pays moins bien étudiés. Puisque une corrélation ne prouve rien, elle et il vont chercher dans la psychologie expérimentale, l'économie ou l'anthropologie physique et sociale de quoi étayer leurs hypothèses. Leur ouvrage est dense, leur approche quantitative leur permet de couvrir nombre de sujets, au point de parfois noyer leur lectorat sous les tableaux, mais le résultat est passionnant. Et il constitue un désaveu criant du choix de l'inégalité qui a été fait depuis environ 1980 dans les économies développées.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 25 octobre, 2020
Par Aude le dimanche, 25 octobre, 2020, 12h13 - Lectures
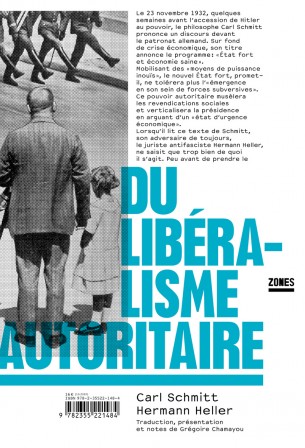 Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
La collection Zones réédite une polémique qui date de quelques mois avant la concession du pouvoir à Hitler en Allemagne en 1933. Carl Schmitt, juriste conservateur, sur le point de rejoindre les rangs nazis, fait allégeance au pouvoir économique rhénan (il est l'invité d'une « société au long nom » d'entrepreneurs du sud-ouest du pays). Quelques semaines après, Hermann Heller, social-démocrate et juif, lui répond. L'ouvrage est introduit par le directeur de collection, Grégoire Chamayou, auteur de ce livre remarquable qu'est La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire (La Fabrique, 2018). Il s'agit donc ici de poursuivre l'histoire qu'il fait du libéralisme autoritaire, oxymore aujourd'hui au pouvoir un peu partout dans le monde.
Lire la suite...
aucun rétrolien
lundi, 14 septembre, 2020
Par Aude le lundi, 14 septembre, 2020, 08h59 - Textes
Il existe en français des adjectifs qui ne peuvent pas être modalisés, renforcés par très ou atténués par un peu. On ne dit pas *très formidable, *assez délicieux, *un peu sublime. C'est ou ce n'est pas essentiel, admirable, horrible. Ou alors c'est qu'on a oublié le sens même de ces mots, qui a un caractère absolu. Les autres adjectifs appellent la modalisation, la nuance. Et ceux-là sont beaucoup plus nombreux. Parce que les choses dans notre expérience nous arrivent rarement toutes blanches ou toutes noires, elles obéissent à une certaine gradation : un plat est plus ou moins bon, salé, épicé, une personne est plus ou moins intelligente, malveillante, originale.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 25 avril, 2020
Par Aude le samedi, 25 avril, 2020, 18h29 - Textes
S'il est un domaine dans lequel nos représentations baignent dans un mélange
de connaissances assurées et d’irrationalité, c'est le corps et la santé. J'y
pense depuis longtemps mais la crise sanitaire en a donné de nombreuses
illustrations, notamment avec les ruées sur la chloroquine, la nicotine et
maintenant l'eau de Javel… J'y pense depuis que j'ai lu
Le Sain et le malsain (Le Seuil, 1993), ouvrage dans lequel
l'historien Georges Vigarello montrait que ce qui est bon pour la santé et ce
qui ne l'est pas constitue une sorte de système d'images mentales à la logique
parfois étonnante. Par exemple, les épices (poivre, cannelle, clou de girofle,
etc.) ont la particularité de pourrir difficilement, en conséquence de quoi
elles ont été perçues comme saines : la pourriture étant malsaine,
l'imputrescibilité – des minéraux, des épices, etc. – était saine. Comme elles
ont aussi un goût très fort, l'analogie avec l'ail a constitué une évidence,
quand bien même le goût et les vertus thérapeutiques n'auraient aucun lien
entre eux. L'ail a donc été investi des mêmes qualités que les épices au coût
prohibitif, pour devenir l'épice des pauvres. Étrangement, ces qualités prêtées
à l'ail sont en grande partie reconnues par la science moderne. Antibactérien,
aliment santé, excellent en cas de rhume avec de l'eau chaude, du thym, du
citron, du miel, du gingembre… (sans oublier de porter un cristal en contact
avec votre peau !) Aujourd'hui encore, ce que nous savons de source sûre
et ce que nous imaginons et transmettons comme représentations est encore un
peu confus… Tout ça pour dire que cette crise sanitaire appuie pile là où nous
sommes les moins rationnel·les.
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 12 avril, 2020
Par Aude le dimanche, 12 avril, 2020, 10h55 - Textes
 La vie politique, dans les
régimes représentatifs libéraux, est traditionnellement structurée autour des
partis (et autres corps intermédiaires comme les syndicats). Traditionnellement
mais pas de tous temps puisque avant 1848 les corps intermédiaires étaient
interdits, accusés de briser le bel unanimisme du peuple. Quand les
associations, les syndicats et les partis sont autorisés en 1848, cette
disposition est l'occasion pour des classes qui jusqu'ici avaient été tenues à
l'écart de la vie publique, et pas seulement par le suffrage censitaire, d'y
participer pleinement. Avant 1848, être élu supposait d'avoir les moyens de
mener campagne sur des ressources individuelles. Après 1848, non seulement tout
le peuple est invité à voter (tout le peuple ? à l'exception des femmes,
soit de sa moitié) mais en plus il gagne le droit de s'auto-organiser dans des
structures qui lui permettent de mettre en commun des moyens pour peser dans le
débat public – et plus concrètement de s'organiser dans son bras de fer avec
ses employeurs. En théorie, les corps intermédiaires portent une dimension
démocratique du gouvernement représentatif (lequel est, en théorie aussi,
faiblement démocratique).
La vie politique, dans les
régimes représentatifs libéraux, est traditionnellement structurée autour des
partis (et autres corps intermédiaires comme les syndicats). Traditionnellement
mais pas de tous temps puisque avant 1848 les corps intermédiaires étaient
interdits, accusés de briser le bel unanimisme du peuple. Quand les
associations, les syndicats et les partis sont autorisés en 1848, cette
disposition est l'occasion pour des classes qui jusqu'ici avaient été tenues à
l'écart de la vie publique, et pas seulement par le suffrage censitaire, d'y
participer pleinement. Avant 1848, être élu supposait d'avoir les moyens de
mener campagne sur des ressources individuelles. Après 1848, non seulement tout
le peuple est invité à voter (tout le peuple ? à l'exception des femmes,
soit de sa moitié) mais en plus il gagne le droit de s'auto-organiser dans des
structures qui lui permettent de mettre en commun des moyens pour peser dans le
débat public – et plus concrètement de s'organiser dans son bras de fer avec
ses employeurs. En théorie, les corps intermédiaires portent une dimension
démocratique du gouvernement représentatif (lequel est, en théorie aussi,
faiblement démocratique).
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 21 mars, 2020
Par Aude le samedi, 21 mars, 2020, 13h16 - Textes
Le 6 mars, monsieur le président se rendait au théâtre. On n'allait pas
se laisser abattre : « La vie continue. Il n’y a aucune raison,
mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de
sortie. » Cinq jours plus tard, il en remettait une
couche : « Nous ne renoncerons à rien. Surtout pas à rire, à
chanter, à penser, à aimer. Surtout pas aux terrasses, aux salles de concert,
aux fêtes de soir d’été. Surtout pas à la liberté. » Deux jours après
cette sortie rappelant la grandeur de notre civilisation, avant tout celle des
loisirs marchands, Macron posait les bases de notre nouvelle vie :
rassemblements interdits, contacts physiques limités (mais pas la peine de
porter un masque, d'ailleurs on n'en a pas), privé·es de sorties sauf pour les
activités vitales (les courses, la promenade du chien, le kilomètre de marche
pour ne pas perdre la main, aller bosser dans une usine produisant des biens
pas spécialement vitaux en temps d'épidémie). Y'a pas à dire, le type voit la
fin du monde arriver avec plus de clairvoyance que Jojo et les Gilets jaunes
qui, elles et eux, ont vite compris à quel point les luttes écologistes et
démocratiques étaient aussi les leurs…
Lire la suite...
aucun rétrolien
dimanche, 1 décembre, 2019
Par Aude le dimanche, 1 décembre, 2019, 14h21 - Lectures
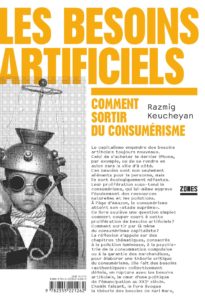 Les Besoins
artificiels. Comment sortir du consumérisme, Razmig Keucheyan, La
Découverte, « Zones », 2019, 250 pages, 18 euros
Les Besoins
artificiels. Comment sortir du consumérisme, Razmig Keucheyan, La
Découverte, « Zones », 2019, 250 pages, 18 euros
Depuis quelques années le Black Friday, ce lendemain de Thanksgiving dévoué à
la consommation, donne lieu en France à des soldes frénétiques. L'édition de
2019 a été également l'occasion de nombreuses actions de sabotage, dans le
monde comme ici. L'impact écologique et social de la fièvre acheteuse est
connu, régulièrement dénoncé. Le Buy Nothing Day du magazine
Adbusters, dernier samedi de novembre, a longtemps été marqué d'une
pierre blanche dans l'agenda des militant·es de la décroissance, un jour dédié
à des actions de sensibilisation dans les temples de la consommation. Mais
l'urgence climatique toujours plus pressante, la part croissante de la vente en
ligne et de ses conséquences
sociales
et
écologiques,
tout ça a donné cette année des actions directes plus radicales, souvent menées
dans les magasins plutôt que dans les nœuds logistiques. Cette orientation,
côté consommation plutôt que production, a suscité quelques malaises :
« Le Black Friday, c'est l'occasion pour des classes moins aisées de payer
des cadeaux pas trop chers à leur petite famille », ai-je entendu ici ou
là. L'urgence écologique, oui, mais acheter pour Noël (1) est un besoin qui
doit être pris en compte. Peut-être est-ce là un de ces besoins artificiels à
remettre en cause ? Et comment ?
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 7 mai, 2019
Par Aude le mardi, 7 mai, 2019, 03h19 - Textes
Il est entendu dans le sens commun que les régimes dans lesquels on choisit
son gouvernement sont des démocraties. Et c'est ce que nous répètent à l'envi
politiques et journalistes, pour qui les non-démocrates, ce sont les
autres : groupes politiques minoritaires ou pays éloignés. Or, pour les
historien·nes et les politistes, nos « démocraties libérales » ont
bien des caractères démocratiques mais subtilement mélangés à d'autres
qui tiennent plutôt de l'aristocratie (le pouvoir des meilleurs) et de la
monarchie (le pouvoir d'un seul). On considère souvent à tort que
l'élection est le seul geste démocratique, dédaignant l'environnement dans
lequel le peuple est amené à voter : liberté et vitalité de la presse, des
structures dans lesquelles le peuple s'organise (partis, syndicats,
associations, collectifs et groupes informels), diffusion de l'esprit critique
dans des débats publics de qualité. Un régime dans lequel la presse relaie la
désinformation du gouvernement (comme on l'a vu le 1er mai 2019 avec l'affaire de la fausse
« attaque » d'un hôpital mais les exemples
abondent) et qui dénigre les formes d'organisation populaire et ses
expressions (de la présence dans l'espace médiatique à la manif) a des
caractères non-démocratiques.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 30 avril, 2019
Par Aude le mardi, 30 avril, 2019, 10h58 - Textes
En voilà une question bête, bien sûr que non ! Les populistes, ce sont
ces politiques qui ne cessent de faire appel au peuple et de flatter ses bas
instincts. Notre président-philosophe (Frédéric de Prusse et Voltaire enfin
réunis dans le même corps jeune et presque athlétique, waw !) en appelle,
lui, à la raison et à la bonne gouvernance. Macron ne fait pas appel au peuple,
c'est une des habitudes de la droite que de vendre la puissance du pays et
qu'importent les gens qui y vivent.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 3 janvier, 2019
Par Aude le jeudi, 3 janvier, 2019, 09h34 - Textes
Dans les manuels d'éducation civique, les choses sont simples : les
élections sont un marché où la demande populaire rencontre l'offre électorale
et les deux s'apparient le temps d'un mandat, qui est une sorte de carte
blanche donnée à un élu. Les mouvements sociaux sont une remise en cause
incongrue de la légitimité construite par l'élection. Il est donc dans l'ordre
des choses qu'un président élu explique au milieu d'une grève d'ampleur, suite
à plus d'un an de manifestations hebdomadaires et des mois de blocages de
ronds-points, qu'il fera comme il souhaite. Et qu'il distingue, pour bien
marquer son autorité, le patron français de
l'entreprise
qui devrait être la principale bénéficiaire de la dégradation annoncée de
notre système de retraites (ainsi que d'autres
personnalités du monde de la finance), façon « je vous emmerde,
n'oubliez pas de voter pour moi dans deux ans ».
Lire la suite...
aucun rétrolien
mercredi, 12 décembre, 2018
Par Aude le mercredi, 12 décembre, 2018, 14h42 - Textes
C’est bientôt Noël et c’est déjà l’overdose. Des pubs qui dégoulinent de
rouge, des passant·es avec leurs gros sacs en papier remplis de cadeaux venus
du cœur et d’usines où le travail est bon marché, des questions existentielles
sur ce qu’on aimerait recevoir alors qu’il faut bien l’admettre, on n’a
franchement besoin de rien… ou bien de tout. C’est la grande bouffe et il y a
du monde à table. Des week-ends en avion dans une ville où on n’a personne à
aller voir (à part un hôte AirBnB) aux changements d’équipement parce qu’un
nouveau vient de sortir qui est tellement mieux (et pas parce que l’ancien ne
marche plus), tout déborde.
Et à côté de ça, les histoires de ces familles qui payent les activités de
leurs enfants, vingt euros l’année grâce aux aides municipales, en trois fois
sans frais ou de ce petit garçon qui raconte à ses copains de classe qu’hier il
a dîné – parce que c’est pas tous les soirs que ça arrive.
Lire la suite...
aucun rétrolien
mardi, 2 octobre, 2018
Par Aude le mardi, 2 octobre, 2018, 03h27 - Textes
C’était il y a presque vingt ans. La formatrice était venue avec son bébé,
qu’elle allaitait, pour nous présenter les grandes lignes de ce qu’est le
changement climatique. Les particules de gaz à effet de serre plus denses dans
l’atmosphère, qui font que l’énergie solaire est recapturée en plus grande
proportion après qu’elle a touché la Terre. Le réchauffement de la planète, qui
s’ensuit, ces deux ou trois degrés (selon les différents scénarios) qui ne sont
pas uniformément répartis mais constituent une énergie en plus phénoménale,
laquelle nourrit des épisodes climatiques plus intenses et plus fréquents. Et
puis ce qu’on peut y faire : un quart des émissions dû aux transports, un
autre à l’agriculture (pas seulement l'élevage mais aussi le mésusage des
sols), un autre au bâtiment, un dernier à l’industrie et une troisième moitié
pour tout ce que nous achetons sur le marché mondial et qui n'est pas compté
dans la consommation nationale… Les solutions ? Des techniques plus
écologiques et moins industrielles et une réduction : du nombre de
kilomètres effectués par les biens et les personnes, de la consommation, de
l'extraction des ressources, etc. Changer de mode de vie mais aussi changer de
modèle économique. Ça tombait bien, les échos de Seattle se faisaient encore
entendre et la mondialisation néolibérale était nommée, décrite et
combattue.
Lire la suite...
aucun rétrolien
jeudi, 18 janvier, 2018
Par Aude le jeudi, 18 janvier, 2018, 10h03 - Malaisie et Indonésie
Les prochaines élections législatives en Malaisie devraient se tenir en
février ou mars prochains. La date n’est pas encore connue, elle est laissée à
la discrétion de Najib Razak. Le Premier ministre a l’obligation de convoquer
ces élections avant août 2018 et de les annoncer avec onze jours d’avance,
durée minimale de la campagne. Cette latitude compte parmi les nombreuses
cartes que le parti au pouvoir a en main pour garder son hégémonie à
l’assemblée, comme c’est le cas depuis 1957, date de l’indépendance du pays.
Début décembre, le public malaisien prenait connaissance d’un article
académique dans lequel un chercheur basé au Canada, Kai Ostwald, fait le point
sur les caractères autoritaires du régime, caractères qui donnent à la Malaisie
une place parmi les pays où « l’intégrité électorale » est la plus faible.
L’annonce a choqué, même si ces critiques rejoignent celles de l’opposition
politique malaisienne depuis des années. Car la Malaisie est le seul pays à son
niveau de développement dans le groupe des régimes très autoritaires. Qu’est-ce
qui fait donc du régime parlementaire malaisien l’un des moins démocratiques au
monde ?
La suite sur
Asialyst.
aucun rétrolien
dimanche, 9 juillet, 2017
Par Aude le dimanche, 9 juillet, 2017, 08h24 - Textes
On savait qu’on pouvait faire tout dire aux sondages… C’est le cas également
pour les élections. Le dernier cycle électoral a donné lieu à des votes
apparemment contradictoires et inconséquents, au point de douter de la santé
mentale des électeurs et électrices. Voyons un peu : après un premier tour où
quatre candidat·es étaient au coude à coude, le second tour dégage une grosse
majorité pour l’un des deux finalistes. Les électeurs et électrices,
conscient·es que l’élection s’est jouée dès le premier tour et non au second
comme cela devrait être le cas, conscient·es que leur vote a été contraint par
la peur de l’accession d’un parti d’extrême droite à la fonction présidentielle
dans un pays doté d’une constitution qui manque singulièrement de garde-fous à
cette fonction, expriment un souhait somme tout assez bien vu : il ne faut pas
que la farce se rejoue au second tour. Et devinez quoi… il s’est passé pile la
même chose dans la plupart des 577 circonscriptions.
Lire la suite...
aucun rétrolien
samedi, 22 avril, 2017
Par Aude le samedi, 22 avril, 2017, 20h14 - Textes
Je les avais vues
de loin pendant des semaines, ces affiches électorales, parfois à moitié
arrachées. Mais c’est hier que le détail m’a sauté aux yeux. C’est vrai que le
personnel politique ne se caractérise pas par sa ressemblance avec le reste du
pays. Pour la plupart ce sont de vieux mecs blancs bourgeois. Mais vieux à ce
point ?

Même Macron, qui
a environ l’âge médian constaté en France (c’est dire s’il est jeune !), a
sur les affiches un visage marqué par les rides. On ne voit qu’elles,
rétrospectivement. Pattes d’oie ou front parcheminé, tou.tes les candidat.es ou
presque les arborent fièrement. À se demander si elles n’ont pas été accentuées
par un logiciel de retouche bien connu…

Lire la suite...
aucun rétrolien
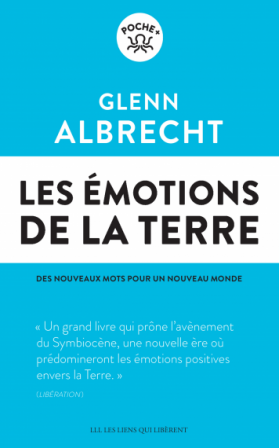 Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €
Glenn Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2021, 366 pages, 9,90 €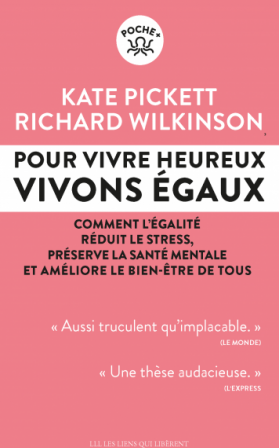
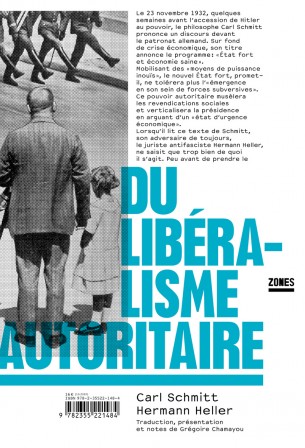 Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
Du libéralisme autoritaire, Carl Schmitt et Hermann Heller, présenté par Grégoire Chamayou, La Découverte, « Zones », 2020, 144 pages, 16 €
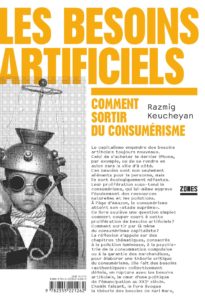 Les Besoins
artificiels. Comment sortir du consumérisme, Razmig Keucheyan, La
Découverte, « Zones », 2019, 250 pages, 18 euros
Les Besoins
artificiels. Comment sortir du consumérisme, Razmig Keucheyan, La
Découverte, « Zones », 2019, 250 pages, 18 euros
