Entre le PS et ses électeurs/rices, c'est le désamour : le parti ne
fait pas une politique de gauche, une politique en rupture avec la doxa
néolibérale qui s'est emparée de l'Europe à la fin des années 1970. Chaque
élection est celle du changement qui change, de la nouvelle chemise qu'on
essaiera quelques années, parce qu'elle nous promet que tout sera différent,
avant de la jeter par déception. Cette année l'Italie bascule à gauche pendant
que l'Espagne bascule à droite, les deux pays, qui sont dans la même situation
socio-économique, pour les mêmes raisons. L'alternance ne change rien, elle
n'est que le signe du malaise.
Pourtant nous savons que les membres du PS sont porteurs/ses des mêmes
aspirations que nous, qu'ils et elles partagent des valeurs d'égalité (non, pas
d'égalité des chances, tout le monde sur la ligne de départ et si tu loupes la
course tu n'as plus rien), qu'ils et elles apprécient le service public (rendu
à chacun-e sans considération pour ses moyens ou sa situation géographique).
Alors pourquoi renier constamment ces valeurs, pourquoi laisser les inégalités
exploser depuis trois décennies, pourquoi ne pas apporter une réponse de gauche
à la crise ?
Effet de rente
La petite boutique électorale nous donne l'impression d'être un marché où
l'offre politique rencontre la demande, processus équitable et honnête où
chacun-e doit trouver son compte. D'ailleurs même les perdant-e-s ne le mettent
pas en cause. Mais dans ce marché, tout biaise la concurrence entre les idées
politiques. D'abord le système électoral, qui oblige un parti qui pèse
15 % lors d'élections à la proportionnelle à dépendre de ses alliances
politiques (avec un parti à 25 %) pour s'assurer péniblement d'avoir
0,7 % des sièges à l'Assemblée. Ensuite la personnalisation de la
politique, qui rend moins audible les idées et les fait passer derrière le
langage, la façon d'être des candidat-e-s. Les biais ne s'arrêtent pas là, ils
tiennent aussi à l'imaginaire autour de l'offre politique.
Aussi attirante et sympathique soit l'offre d'un petit parti, aussi forte soit
notre envie de rupture, au fond nous avons peur de changer, comme la France
pompidolienne ou giscardienne se faisait des frayeurs en pensant que le
mouvement post-68 allait tôt ou tard porter Mitterrand au pouvoir. Nous ne
risquions rien de moins que l'effondrement économique et sociétal. Vu de loin,
ça fait sourire. Mais rien n'a changé, nous avons trop peur de l'alternative
pour lui donner sa chance.
C'est une véritable rente sur lesquelles sont assises les formations politiques
qui ont comme le PS prouvé qu'avec elles, tout peut changer parce qu'au fond
rien ne changera. Si la petite boutique électorale était un marché, ce serait
deux hypermarchés en concurrence et quelques échoppes en bois adossées à leurs
flancs, dans lesquelles on ose quelques achats avant d'aller pousser le caddie
là où il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi mettre cette rente en danger en
mettant en œuvre des idées de gauche audacieuses alors qu'il est si facile de
simplement les montrer pendant la campagne ?
L'élection, un processus aristocratique
La représentation a été inventée à la fin du XVIIIe siècle non pas pour
contourner la difficulté d'un corps de citoyens trop large, trop étendu
géographiquement. Il aurait été aussi facile de recourir également au tirage au
sort, ou bien d'encadrer l'élection avec des mandats impératifs ou la
révocabilité des élus. Non, la représentation a été mise en œuvre pour filtrer
la parole du peuple, ou disons la « traduire », à travers des
personnalités choisies, sélectionnées.
Le phénomène est aussi vrai dans les partis, où d'une base informe se dégage
une élite éclairée, assise sur son statut social (celui d'énarque par exemple,
mais ce n'est pas la seule expertise reconnue) ou sur son habileté à manœuvrer
jusqu'au sommet de la pyramide. Cette sélection des personnes est aussi
sélection des idées et des pratiques. Même si la base du PS peut douter que la
France ait raison d'encourager la production d'énergie nucléaire quand les
autres pays se tromperaient en l'abandonnant ou en ne lui accordant pas tous
leurs crédits, l'élite du PS n'en démord pas, et la même contradiction se
retrouvera entre les aspirations du peuple, maintenant globalement opposées à
l'énergie nucléaire, et le choix qu'il aura au second tour entre un candidat
activement pro-nucléaire et un candidat qui tente de cacher qu'il souhaite que
la France reste aussi nucléarisée. Électrons, piège à cons ?
Concernant les grands choix socio-économiques acceptés par les élites du PS
avec le consensus néolibéral, il faut aller chercher plus loin que la morgue
d'une élite qui sait ce qui est bon, qui sait que construire une autoroute vaut
mieux que d'encourager les transports en commun, qu'une voie nouvelle de TGV
vaut mieux qu'un aménagement des lignes sur lesquelles passent les TER, qui
arbitre systématiquement en faveur du neuf, qui va vite et coûte cher (ce n'est
plus un coût mais un investissement pour l'avenir) aux dépens de solutions plus
économes et plus écologiques. Même si ces choix politiques sont ceux d'une
autre ère, celle où on irait un jour passer le w-e sur la Lune, nos bons pères de famille savent ce qui
est bon pour nous, croissance plutôt que ménagement du milieu naturel,
mondialisation plutôt que protectionnisme. Et nous peinons à les démentir. La
mondialisation, qui désormais dicte sa loi et fait la météo, n'est pas le
résultat d'un complot international des élites politiques pilotées par
l'oligarchie économique, c'est un choix effectué par nos élites... pour servir
nos intérêts.
Avons-nous vraiment envie de ne plus manger le monde ?
La division du monde en différentes zones de production, en concurrence les
unes avec les autres et qui échangent leurs produits à bas coûts (ni les
transports ni les tarifs douaniers ne sont prohibitifs), a détruit en France un
tissu industriel capable de nous fournir il y a encore trente ans les
chaussures et les vêtements, les objets de la vie quotidienne, les équipements
des usines qui fabriquent tout cela. Cette même division nous permet de
continuer à grignoter les terres les plus fertiles du pays pour assurer
l'étalement de la ville, aux dépens de notre capacité à nous nourrir tou-te-s
dans les territoires que nous habitons. Mais c'est cette division-là qui nous
permet de porter des vêtements bon marché, des produits électroniques fabriqués
pour trois fois rien.
Considérons un peu le prix des objets dont nous nous entourons, et imaginons
leur coût s'ils étaient fabriqués par des smicard-e-s bien françai-se-s. Avec
un même salaire nous ne pourrions plus nous offrir autant d'objets si
indispensables à la vie moderne, adieu i-phone, adieu pèse-personne
électronique, adieu lecteur Blu-ray, adieu pompes de randonnée, adieu vacances
en Thaïlande ou au Maroc.
Les élites politiques savent mieux que nous ce que nous voulons... Elles ont
fait un arbitrage en faveur des consommateurs/rices que nous sommes, et nous
n'avons pas eu d'autres réponse que « nous voulons le beurre et l'argent
du beurre, l'aisance des consommateurs/rices et la protection due aux
producteurs/rices » (1). Après les réunions de la gauche
de gauche, nous n'avons aucun scrupule à nous montrer sur nos smartphones les
photos de snorkling dans la mer Rouge, tandis que nous en aurions bien plus à
ne pas venir à la manif de mardi contre la disparition de nos acquis
sociaux.
Cet arbitrage néolibéral imposé par les élites politiques, « à l'insu de
notre plein gré », nous sommes encore incapables de le remettre en cause
véritablement. Est-ce que la merde qui nous attend fera mûrir plus vite notre
pensée politique ? On pense décidément mieux quand on n'est pas en pleine
digestion d'un repas trop copieux...
(1) Lire à ce sujet « Supermarchés
et pouvoir d'achat : avec Sarko, je positive ! » dans ma brochure
« Les structures mentales de la France
d'après ».
 Une chronique à retrouver sur
Une chronique à retrouver sur 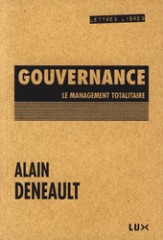 Alain Deneault
Alain Deneault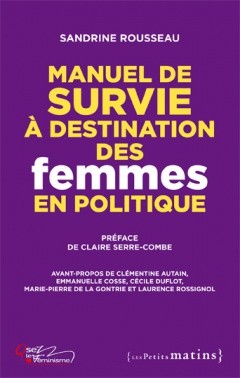 Sandrine
Rousseau, Manuel de survie à
destination des femmes en politique, Les Petits Matins, 2015, 108 pages,
9,90 €
Sandrine
Rousseau, Manuel de survie à
destination des femmes en politique, Les Petits Matins, 2015, 108 pages,
9,90 €