Le Mythe de l’entrepreneur
Par Aude le lundi, 30 janvier, 2023, 08h49 - Lectures - Lien permanent
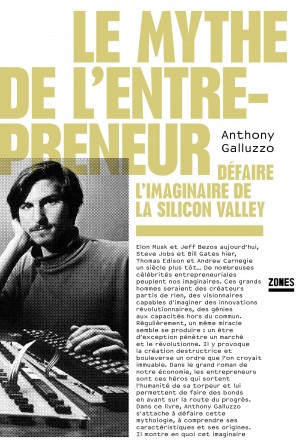 Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €
Anthony Galluzzo, Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l'imaginaire de la Silicon Valley, « Zones », La Découverte, 2023, 240 pages, 20 €
Auteur de La Fabrique du consommateur, Anthony Galluzzo nous livre ici le pendant de sa remarquable histoire de la consommation, une analyse du mythe de l’entrepreneur aux USA. Son histoire commence par la fin, avec la célébration de Steve Jobs. Galluzzo tente une histoire du succès d’Apple par plusieurs angles. Et si cette entreprise devait tout à Steve Wozniak, l’ingénieur de talent associé à Jobs depuis les fameux débuts de l’entreprise dans un garage ? Ou bien à Mark Markkula, l’homme qui réussit à intéresser les investisseurs au destin de la start-up, avec un succès tel qu’elle dut vite refuser des propositions d’entrée dans le capital ? Ou bien à la Silicon Valley, ce tissu d’entreprises dont Hewlett-Packard où Wozniak fit ses premiers pas et Xerox qui inventa dès 1973 l’interface graphique qui fit le succès d’Apple ? Ou bien à l’État, très volontaire dans la création de ce cluster de laboratoires de recherche fondamentale financés par le public, complété par des entreprises qui en valorisaient l’innovation ? Un peu de chaque, évidemment. Le mythe de Steve Jobs illustre bien ce que François Flahaut appelait le « paradoxe de Robinson », cette image de l’homme qui ne doit rien à personne – mais qui survit grâce au bateau échoué dont la cale contient tous les outils nécessaires, pour ne rien dire des savoirs acquis en Angleterre et que le naufragé a emportés avec lui sur son île déserte.
La biographie de Steve Jobs, ce mythe copié-collé ad nauseam d’article de presse en livre best-seller, avec les mêmes anecdotes et la même interprétation du parcours de cet entrepreneur, s’attache à nier ce que Jobs doit à son milieu. Elle refuse « toute analyse rationnelle et contextuelle de la réussite individuelle et du processus de création », c’est à dire de porter son regard sur la société qui a rendu possible le parcours de Jobs et sur l’état des savoirs et de la technologie qui a rendu possible le surgissement de la micro-informatique à un instant T, ni avant, ni après. Si l’iPod a été inventé à la fin des années 1970, bien avant Apple, la miniaturisation de l’époque ne permettait pas d’en faire un objet de consommation. Il faut bien une convergence dans les contextes social, technologique et même politique pour voir surgir des parcours dont le mythe de l’entrepreneur persiste à dire qu’ils sont singuliers. Une telle convergence s’est produite dans les années 1975-1977, date à laquelle Steve Jobs et Bill Gates, nés tous deux en 1955 (1), ont des conditions idéales pour lancer leur entreprise : ni trop jeunes ni installés dans la vie et ayant déjà trop à perdre professionnellement.
Le même effet de génération a été déterminant pour des patrons nés dans les années 1830 et ayant profité de conditions idéales pour établir chacun dans son industrie une situation monopolistique, encouragés par les effets d’aubaine comme la guerre civile, qui donna lieu à beaucoup de profits, et un contexte législatif favorable aux trusts. Galluzzo consacre un chapitre central à ceux qui ont été qualifiés de « barons voleurs » dans les dernières décennies du XIXe siècle. Un capitalisme féroce se déploie à cette époque (La Jungle d’Upton Sinclair, roman faisant l’histoire d’une famille migrante ouvrière dans les abattoirs de Chicago, donne une idée de l’exploitation des ouvrier·es et des produits alimentaires frelatés vendus par l’industrie, le tout sans autre régulation que le marché). Cette situation perturbe le système de valeurs dominant aux États-Unis et Galluzzo en fait le cœur de son propos sur le mythe de l’entrepreneur et l’individualisme de marché. Les barons voleurs de la deuxième partie du XIXe siècle (Rockefeller, Carnegie, JP Morgan) mettent au défi des valeurs états-uniennes de petite entreprise et d’autonomie, qui valorisent le travail et les efforts. La guerre économique, souvent déloyale, menée par les empires industriels contre les plus petites entreprises, le lobbying et la collusion, la distorsion de concurrence mettent à mal l’idée que chacun reçoit le fruit de ses efforts. Travail, valeur morale et aisance économique ne sont plus associées et les barons voleurs font l’objet de critiques acerbes dans la presse, où leurs méfaits sont dénoncés (c’est de cette époque que date l’iconographie du chapeau haut-de-forme et du cigare). Est-ce une remise en cause du capitalisme ? La presse, qui emmène le débat public, est dans les mains d’autres patrons et les attaques contre les capitaines d’industrie les plus controversés permettent au fond de valoriser d’autres entrepreneurs.
Le mythe de l’entrepreneur se structure à cette époque autour de quelques éléments : le déni des conditions favorables qui ont permis la réussite, comme on l'a vu (2), et la mise en valeur de certaines qualités personnelles, dont la moindre n’est pas la volonté. L’entreprise idéologique consiste à imposer l’image d’un champ économique ouvert et démocratique, dans lequel chacun a la possibilité de s’épanouir mais seuls quelques-uns en sont véritablement capables. On reconnaît le système de valeurs paradoxal du développement personnel décrit par le sociologue Nicolas Marquis et dont j’ai souvent parlé ici : le caractère pseudo-démocratique et la surestimation de l’ouverture à chacun·e des opportunités justifie l’inégalité des conditions. Chaque époque a ses héros – tyrans, hommes de lettres ou sportifs – dont la presse tresse les lauriers. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les patrons sont sur le devant de la scène, investis de qualités diverses, et leur richesse explose. Galluzzo signale des périodes de reflux de cet imaginaire : la crise de 1929 le remet légèrement en cause et le milieu du XXe siècle est plus favorable aux organisateurs plus conformistes. Né en 1920, Steve Jobs aurait souffert de son autoritarisme et de son incapacité au compromis, qui sont aujourd’hui louées comme génie incompris de l’artiste au-dessus de la mêlée des mortels (une représentation dont Pierre Bourdieu dans Les Règles de l’art (1992) a montré le caractère historiquement ancré). Depuis la vague néolibérale, le mythe de l’entrepreneur providentiel, destructeur-disrupteur qui fait advenir un monde nouveau, a de nouveau le vent en poupe et les rémunérations en témoignent (je conseille cette émission très accessible du podcast Spla$h sur la rémunération des patron·nes).
Avec les précautions d’usage, Galluzzo compare les parcours d’Andrew Carnegie et de Steve Jobs. Malgré une popularité importante, nourrie d’interventions nombreuses dans les médias, Carnegie a vu son aura entamée par la répression meurtrière de la grève de Homestead en 1892 (un conflit social grave initié par la décision de passer la journée de travail de huit à douze heures). Steve Jobs, au contraire, n’a jamais été mis en cause pour ses positions politiques libertariennes, pour sa participation à un cartel d’entrepreneurs qui s’était donné pour objectif de geler les salaires des ingénieurs de la Silicon Valley ni pour les conditions de travail dans les usines de son sous-traitant en Chine Foxconn. Le quasi-esclavagisme des migrant·es chinois·es de l’intérieur (les mingong), pourtant largement documenté, a été nié par le patron-star avant qu’il ne s’efface sur cette question, refusant d’associer sa personne à la mise en débat des conditions sociales et économiques de production de ses produits, préférant le pur ether de ses cérémonies de présentation du nouvel iPhone ou les interviews de journalistes complaisant·es. Cette coupure symbolique entre Steve Jobs, le patron artiste, et l’activité concrète de l’entreprise qu’il dirigeait a été accentuée, explique l’auteur, par l’éloignement et la fragmentation des chaînes de production. L’éloignement géographique de la Chine l’a accentuée mais la même logique prévaut pour les classes sociales assignées aux emplois ouvriers dans la Silicon Valley (même s’ils sont moins nombreux qu’avant la généralisation des stratégies de délocalisation), classes pauvres, migrantes et habitant le sud de la région, loin des opportunités des villes de la classe moyenne dans le nord de la vallée – celles où a grandi Steve Jobs.
Ce mythe de l’entrepreneur nous en dit beaucoup sur le regard majoritaire porté sur le monde social et explique l’incapacité d’une grande partie d’entre nous à trouver injustes les inégalités de condition et les traitements biaisés, à refuser de se laisser fasciner par la richesse et le pouvoir. Galluzzo, en conclusion, nous prévient que le seul moyen de lutter contre des mythes aussi toxiques n’est pas d’en prouver l’inanité mais d’en créer de nouveaux.
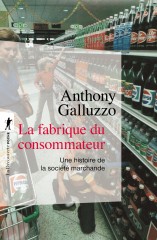 NB : La Fabrique du consommateur (même collection, 2020, réédité en poche cette année) est un ouvrage à lire absolument. Si l’histoire de la consommation est globalement assez bien connue, Galluzzo lui donne une cohérence nouvelle, évente quelques mythes (3) et ouvre des pistes pour la reconsidération des besoins. Il n’était pas acquis qu’un regard aussi critique sur la société de consommation, son histoire et celle de la création de besoins par les acteurs capitalistes ouvrît des pistes de reconsidération des dits besoins. Keucheyan, malgré l’histoire bien documentée de la consommation qu’il fait dans l’ouvrage Les Besoins artificiels (dans la même collection, 2019), rate son objectif. De quoi avons-nous vraiment besoin ?, livre-programme des Économistes atterrés (Les Liens qui libèrent, 2021), échoue encore plus lamentablement. J'aimerais revenir dessus un jour dans ce blog.
NB : La Fabrique du consommateur (même collection, 2020, réédité en poche cette année) est un ouvrage à lire absolument. Si l’histoire de la consommation est globalement assez bien connue, Galluzzo lui donne une cohérence nouvelle, évente quelques mythes (3) et ouvre des pistes pour la reconsidération des besoins. Il n’était pas acquis qu’un regard aussi critique sur la société de consommation, son histoire et celle de la création de besoins par les acteurs capitalistes ouvrît des pistes de reconsidération des dits besoins. Keucheyan, malgré l’histoire bien documentée de la consommation qu’il fait dans l’ouvrage Les Besoins artificiels (dans la même collection, 2019), rate son objectif. De quoi avons-nous vraiment besoin ?, livre-programme des Économistes atterrés (Les Liens qui libèrent, 2021), échoue encore plus lamentablement. J'aimerais revenir dessus un jour dans ce blog.
(1) C’est le journaliste Malcolm Gladwell qui propose cette hypothèse, incluant d’autres entrepreneurs et une fenêtre d’opportunité ouverte pour des hommes nés entre 1953 et 1956.
(2) Derrière telle figure de self-made man, un capital familial, économique ou social qui a été laissé hors champ du tableau. Derrière le mythe du garçon pauvre entreprenant, des premiers travaux sociologiques qui démontrent que les chefs d’entreprise sont majoritairement issus des classes privilégiées.
(3) L’un d’eux concerne Edward Bernays manipulant les aspirations des femmes à la liberté pour les engager à fumer. Galluzzo rappelle que Bernays a aussi consacré des efforts à valoriser sa propre personne. Ironiquement, l’ouvrage dans lequel le publiciste surestime ses succès est disponible chez le même éditeur.