Le Genre du capital
Par Aude le jeudi, 11 juin, 2020, 07h35 - Lectures - Lien permanent
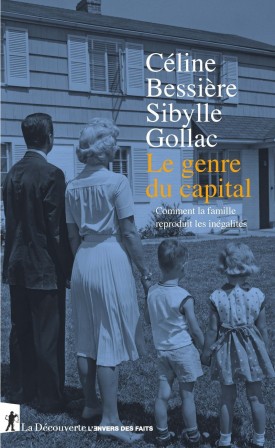 Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le Genre du capital, La Découverte, 2020, 336 pages, 21 €
Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le Genre du capital, La Découverte, 2020, 336 pages, 21 €
L'adhésion aux constats que dressent les féministes est souvent compliquée par ce fait que les femmes et les hommes vivent ensemble et s'aiment : deux époux de sexe opposé, un père sa fille, une sœur son frère. Le racisme, les haines de classe peuvent advenir quand des groupes sociaux sont séparés, ne se connaissent pas ou peu et admettent des intérêts divergents mais le sexisme, vraiment ? Vraiment. C'est le tableau que dressent Céline Bessière et Sibylle Gollac dans leur ouvrage Le Genre du capital, résultat de deux décennies de recherches (fois deux) sur comment deux moments importants de la vie économique des personnes, l'héritage et le divorce, appauvrissent les femmes en comparaison aux hommes. Au point que les inégalités de patrimoine entre femmes et hommes sont passées de 9 % en 1998 à 15 % moins de vingt ans plus tard. Celles-ci tiennent en partie à la place des femmes dans le monde du travail, domaine arpenté depuis quelques décennies par des sociologues féministes et dont les autrices rappellent rapidement quelques aspects. Les femmes en couple avec des enfants travaillent 54 heures par semaine dont seulement 20 sont rémunérées. Les hommes 51 dont 33 sont rémunérées. La répartition des richesses, elle aussi inégalitaire, tient à ce facteur mais également à d'autres moins connus et moins bien compris, que Bessière et Gollac mettent en lumière dans leur livre.
Céline Bessière a travaillé sur les transmissions d'entreprises familiales près de Cognac, Sibylle Gollac sur les stratégies immobilières des familles. Plus récemment, elles ont aussi contribué à une recherche collective autour des divorces devant la justice. L'héritage, très présent dans la première partie du livre, est une institution qui a ceci de particulier dans notre pays qu'elle est égalitaire. Loin de certaines traditions régionales qui avantagent les aînés masculins, l'héritage dans le code civil interdit de trop avantager un enfant car seule une petite réserve peut être allouée à la discrétion des parents. Outre cette réserve, les enfants doivent toucher la même part. Sauf que… les patrimoines contiennent des biens très différents : immobilier, entreprises, argent. Et peu de familles souhaitent tout liquider pour distribuer de l'argent. Ces familles qui ont des biens et aucune envie de s'en dessaisir n'ont pas forcément assez de biens différents ni d'argent pour compenser et faire un partage égalitaire. Une fois accordés les « biens structurants » aux enfants dont elles estiment qu'elles en feront le meilleur usage (devinez qui ?), les familles et les professionnel·les du droit s'engagent ensuite dans une « comptabilité à l'envers » : pour que les biens constituent des parts égales à celles constituées d'argent, de combien faut-il les sous-estimer (1) ? Le refus de l'impôt contribue aussi à cette sous-estimation. Le résultat, c'est que les héritages lèsent les enfants qui ne reçoivent pas ces biens structurants et que ce sont plutôt à des filles que cela arrive. Les acteurs de ce jeu peuvent s'abriter derrière le sexisme de la société, qui contribue à ce que les femmes ne « gèrent » pas bien ces biens, soit qu'elles ont moins de revenus pour entretenir une maison, soit qu'elles connaissent plus d'obstacles comme chefs d'entreprise : les autrices citent cette héritière d'une exploitation viticole près de Cognac obligée d'abandonner suite à des difficultés qui tiennent entre autres à la défiance contre les femmes dans ce milieu. Les droit ne fait rien à l'affaire et les arrangements économiques familiaux, en convergeant avec des stéréotypes sexistes, contribuent à déposséder les femmes de leur héritage au profit des hommes. Aimer ses filles et ses sœurs ne change rien à l'affaire, la relation affective étant plutôt préjudiciable aux femmes qui tiennent à la conserver en acceptant l'iniquité du partage et en ne réclamant pas leurs droits.
Lors de divorces également, femmes et hommes ne sont pas à égalité. Dès la mise en couple, à vrai dire, mais cela ne se voit pas encore : les hommes gagnent plus que leurs compagnes, qui sont plus souvent qu'eux orientées jeunes vers des secteurs peu rémunérateurs parce que féminisés, ont des carrières discontinues, travaillent gratuitement dans la sphère domestique… et parfois même dans l'entreprise de leur mari. Avoir plus de revenu disponible, c'est aussi être mieux conseillé par les professionnel·les du droit. Les époux qui ont des biens au moment du divorce ne souhaitent pas s'en dessaisir et les juges ont la même répugnance qu'eux à leur faire liquider une entreprise, un patrimoine immobilier. D'une part ces juges ne comprennent pas bien la nécessité d'une prestation compensatoire pour une épouse dont la carrière a été entravée par la conjugalité et la parentalité : quand on veut, on peut, disent ces femmes (les juges aux affaires familiales sont souvent des femmes) qui ont excellé à l'école, décroché des postes correctement rémunérés et trouvent les moyens de « concilier » travail et vie de famille en faisant travailler pour elles des femmes plus pauvres qu'elles. D'autre part, depuis qu'une ministre féministe a eu cette brillante idée au tournant des années 2000, la prestation n'est plus payée par mensualités, elle constitue désormais un solde de tout compte qui s'avère bien inférieur. Car qui est capable de payer rubis sur l'ongle à son ex des sommes importantes qui compensent leur mise à disposition de la famille sans liquider ses biens ? Les divorces avec pas ou peu de biens n'échappent pas à cette logique : il ne faut pas déposséder les maris de leur revenu. Même quand il s'agit d'une pension alimentaire censée permettre à l'épouse divorcée d'assumer l'entretien des enfants, les moyens du mari sont au centre de la décision judiciaire : les besoins des enfants, les moyens des épouses pour y répondre devraient être pris en considération à égalité d'après la loi mais de facto ils ne sont qu'accessoires. Aussi, de crainte que le mari voie son train de vie trop baisser et n'aie les moyens de fonder une deuxième famille, prive-t-on les femmes du minimum de moyens pour entretenir les enfants (ou compenser le fait qu'elles ne sont pas disponibles pour travailler à plein temps). Les autrices rappellent que les familles monoparentales sont plus souvent des mères seules avec enfants et que ce sont les types de familles les plus pauvres, dans lesquelles les mères sont capables de se priver de l'essentiel. Et ce sont les femmes qui ont le plus de mal à se remettre en couple après une séparation. Toujours le droit, égalitaire et neutre en théorie, est appliqué d'une manière incapable d'atténuer les inégalités, voire frontalement préjudiciable aux femmes, à travers les préjugés sexistes des justiciables et des professionnel·les, quelque soit leur genre.
Ces inégalités entre femmes et hommes ne sont pas bien connues, entre autres parce que l'imposition par ménage ne produit pas de statistiques genrées et laisse imaginer que le couple hétérosexuel aplanit les conditions. C'est presque vrai… jusqu'au divorce. Et quand femmes et hommes ne s'aiment plus, les femmes se rendent compte que leur travail gratuit et la vulnérabilité économique qui en découle sont un don qui n'engage aucune reconnaissance, ni de la part des conjoints ni de celle des juges. La déclaration des revenus et patrimoines par ménage n'est pas seulement un thermomètre cassé, c'est aussi (je reprends ici les analyses de Christine Delphy) une imposition inéquitable, qui avantage les hommes hétérosexuels ayant une femme « à charge » (c'est à dire bénéficiant de leur travail gratuit). Elle accroît la fiscalité sur le salaire le plus faible, souvent celui de l'épouse qui devient un salaire d'appoint jusqu'à cette séparation qui concerne un couple sur deux. Aujourd'hui peu de féministes demandent l'individualisation de l'imposition. C'est le cas des femmes divorcées de l'association Abandon de famille-Tolérance zéro que citent les autrices mais nous sommes encore trop peu nombreuses à en faire une question importante dans nos luttes.
La différence entre le droit et son application est un élément important de l'enquête de Bessière et Gollac, qui ont examiné les arrangements familiaux, interrogé les décisions des juges, vu comment les obligations juridiques étaient aménagées par ces différents acteurs. Le tout dans un livre qui fourmille d'histoires familiales évoquées très sobrement mais souvent déprimantes. Les termes de métiers (droit ou économie) et les dispositions du droit sont toujours expliquées simplement, l'expression est d'une belle clarté et cet ouvrage exigeant se révèle plus accessible qu'il ne le paraissait de loin. Le Genre du capital s'inscrit dans la sociologie du droit, genre un peu austère, mais c'est aussi une belle contribution féministe, qui dévoile des injustices criantes, des inégalités en train de se creuser sous nos yeux… Les autrices émettent sotto voce dans le livre, plus facilement lors de leurs interventions orales, une critique plus radicale des inégalités entre classes et du rôle tenu par l'héritage dans la reproduction sociale. Tout cela en fait un lecture chaudement recommandée, une sorte de complément féministe à ces livres sur le capitalisme qui ignorent le genre et les inégalités dont lui aussi est porteur.
(1) À l'issue de son enquête sur la sorcellerie dans le bocage (spoiler alert), Jeanne Favret-Saada mentionne la culpabilité des aînés héritant aux dépens de leurs sœurs et frères comme un ressort de leurs misères, qu'ils mettent sur le compte de la malveillance d'un sorcier. La tension entre le droit (un héritage égalitaire) et la pratique (une tradition qui engage à tout donner à l'aîné des garçons) se résout chez eux d'après l'anthropologue dans un mal-être dont ils cherchent un coupable à accuser.