Contact
Par Aude le jeudi, 17 mars, 2016, 16h44 - Lectures - Lien permanent
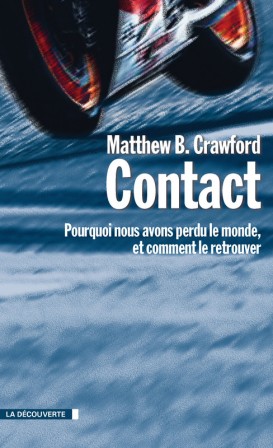 Matthew Crawford, Contact. Pourquoi nous avons perdu le
monde, et comment le retrouver, La Découverte, 2016, 283 pages, 21
euros
Matthew Crawford, Contact. Pourquoi nous avons perdu le
monde, et comment le retrouver, La Découverte, 2016, 283 pages, 21
euros
Donald Duck était plus humain dans sa lutte avec un placard que nous le sommes aujourd’hui quand nous n’avons plus aucune raison d’en chier pour avoir une prise sur notre environnement. Nous nous pensons souverainement détachés de nécessités honteuses alors que nous sommes administrés. Car le monde dont nous jouissons est formaté dans le but d’endormir notre « attention » aux choses, de n’en faire qu’une marchandise offerte aux stimuli « hyperapétissants » et omniprésents concoctés par les « architectes [de nos] choix ». Les lecteurs français le savent depuis certaine sortie sur leur « temps de cerveau disponible » : on ne nous rend pas la vie plus pratique et distrayante sans un intérêt bien compris.
Le mécanicien moto qu’est Crawford n’appréciera peut-être pas l’exemple mais cela m’évoque un chemin parcouru à vélo : des éléments, de la route ou de l’adversité (des bagnoles anonymes, bien que dûment identifiées), on ne sait ce qui est le plus rude. Objectivement, on serait mieux à se laisser porter dans un habitacle abrité, climatisé, sécurisé. Mais pourtant on est plus vivant à vélo, et au final plus satisfait, qu’on le serait à jouir du confort moderne et de la liberté très limitée de s’engager dans un trafic qui nous laisse amorphes et frustrés. Deux visions de l'individu s'opposent, l'automobiliste développant dans sa bulle de métal un ethos autocentré, aux préoccupations peu civiques (si j'en crois le trottoir qui sert de parking devant mes fenêtres), hyper-individualiste mais hyper-dépendant (des schémas de circulation qu'on trace pour lui, de l'alimentation en carburant, etc.) et de l'autre côté un cycliste toujours en prise avec son environnement, pour le meilleur et pour le pire. Soit l'individu-type des démocraties libérales, convaincu d'être unique mais administré en masse, et l'individu qui se frotte au réel mais en retire la compréhension de son inscription dans cet environnement physique et humain (en témoigne par exemple le sens des distances) ainsi qu'une certaine « joie » à exister pleinement. Le dernier offrant des bases plus prometteuses pour des vies moins misérables. Est-ce là la promesse d'une démocratie plus accomplie que nous fait Crawford à propos de pratiques qui semblent élitistes et moins démocratiques que des pratiques de masse ? Le vélo, pour peu coûteux et simple qu'il soit, semble aujourd'hui une pratique exclusive. Les cyclistes sont en grande partie des hommes jeunes, l'exercice semblant hors de portée de personnes peu aventureuses, faibles ou corpulentes. Inutile de remonter très loin dans le temps pour constater que le vélo est accessible à tous et toutes, y compris aux vieilles dames qui en ont été dépossédées quand les « architectes du choix » ont tout misé sur la bagnole.
L'exemple du vélo ne me satisfait toutefois pas et je suis plus sensible à ceux que Crawford tire du travail : tout y est lien, de l'apprentissage d'une tradition (et des ressources pour s'en écarter) à la collaboration et à la rémunération. Son développement sur le gabarit (« tension entre liberté et structure ») nous aide à reprendre contact avec une conception de l'autonomie qui n'est pas le fait d'un « moi souverain ». Le gabarit peut être une organisation par en-haut du travail ou de la vie sociale, comme la cuisine d'un fast-food industriel, mais il peut être aussi le cadre pour structurer nos actions et accomplir notre art, un cadre transmis par d'autres, amélioré par nos soins, qui « nous permet d'augmenter considérablement nos capacités ». Le gabarit est une contrainte qui nous porte. Désavoué par des projets politiques se voulant émancipateurs, son effacement nous laisse avec l'obligation pas moins forte de nous accomplir, cette fois en toute « autonomie » ou dans le déni de ce que nous devons au monde social qui nous entoure. Être des moi souverains produisant du commun bien au-delà de l'espace où ils s'incarnent, tout en étant reliés par des liens faibles comme la gratuité, voilà les utopies du jour. Ce ne sont visiblement pas celles de Crawford. Quand il nous raconte le temps nécessaire au dévoilement d'une facture à son client, il ne s'agit pas de gêne face à un geste trop pragmatique et mesquin : c'est qu'il faut le temps de faire comprendre les étapes de son travail et valider ce qu'il coûte. Cet accord sur la somme due fait partie du métier et nul doute selon lui que « l'absence de telles expériences de validation explique en partie le manque de confiance en soi des chômeurs de longue durée ». Je confirme.
Au-delà des thèmes qu'il aborde, Contact est une belle ressource pour penser le revenu garanti (je citais déjà Éloge du carburateur dans la brochure que j’ai consacrée au sujet). Des dispositifs comme celui-ci ont toute leur place dans une société où « les êtres sont considérés pour ainsi dire à la troisième personne, en tant que représentants d'une catégorie générique » et se voient allouer un revenu en conséquence. Mais « la personne qui est la cible d'une telle empathie ne se satisfait pas d'une reconnaissance générique », elle a besoin de la vraie reconnaissance, celle de sa personne en tant que telle, de ses efforts spécifiques. Pas de la catégorie abstraite (l'humanité, ou plutôt l'humanité dans sa déclinaison nationale) à laquelle elle appartient.
On n’échappera pas, à la lecture de Contact, à la photo de « modèle » féminin en maillot de bain punaisée sur le mur de l’atelier. Le métier, c’est viril, semble nous dire l’auteur d’Éloge du carburateur. Si dans cet ouvrage on aperçoit une travailleuse de métier (dit-on une artisane ?), c’est la seule qui se fait charrier par ses collègues : elle produit si peu de copeaux de métal qu’il est douteux qu’elle travaille, hé hé. Mon poissonnier faisait les mêmes blagues, depuis je mange du jambon. On aimerait voir Matthew Crawford se pencher sur des métiers plus féminins et moins prestigieux que celui de facteur d’orgues, même si la balade est passionnante. Il tente de nous rassurer en conclusion : son travail a de quoi intéresser au-delà du cercle réduit des compagnons et artisans. C’est le cas, heureusement. Et c'est ce qui donne envie non seulement de poursuivre la lecture mais aussi de la partager.