La Guerre sociale en France
Par Aude le lundi, 30 novembre, 2020, 09h11 - Lectures - Lien permanent
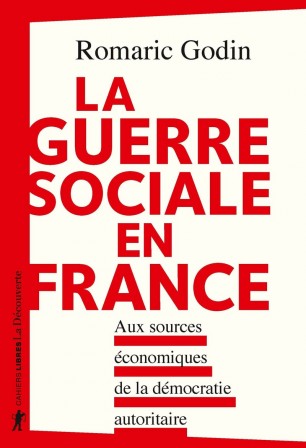 Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €
Romaric Godin, La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019, 250 pages, 18 €
L’an dernier sortait un ouvrage important, destiné à nous sortir de la sidération devant la situation actuelle : une sorte de blitzkrieg d’un néolibéralisme longtemps contenu en France. Romaric Godin, journaliste économique à La Tribune puis à Mediapart, y fait dans un premier temps l’histoire du néolibéralisme, cette idéologie apparue dès la première moitié du XXe siècle mais tardivement épanouie (1). Aujourd’hui le néolibéralisme constitue une vérité révélée pour nombre d’économistes, il est perçu comme un « "consensus scientifique" en économie » mais « repose sur des prémisses (...) fort contestables sur le plan théorique et (…) très fortement remis en cause par les faits ». Cette doctrine, qui vise la neutralité du marché, refuse tout rôle redistributif à l’État, à contre-courant du compromis français établi en 1936 puis 1945 et qui pose l’État en arbitre entre les exigences du capital et les besoins d’un peuple de travailleurs et de travailleuses.
Godin rappelle les décennies de tensions dans la classe politique française, en particulier à droite, entre néolibéraux et adeptes d’une économie planifiée ou d’un compromis politique avec… le peuple, régulièrement appelé à voter. Dans l’« autre pays du néolibéralisme », où les élites ont été dès les années 1930 sensibles à cette idéologie, les premières tentatives d’adopter des politiques économiques néolibérales datent de 1959 (avec le rapport Rueff-Armand), nous apprend Godin, mais elles ont longtemps été tenues en échec. Ceux qui se sont essayé à de telles politiques économiques (Giscard, Barre, Chirac, Sarkozy, Hollande) ont fini dans les poubelles de l’histoire, à l’exception du troisième dont on se rappelle la campagne victorieuse en 1995, grâce à un changement de direction très improbable suivi d’un virage dans l’autre sens tout aussi surprenant (une réforme des retraites mise en défaut par le mouvement social de novembre-décembre 1995). Mais en France, jusqu’à présent, le peuple sanctionnait dans les urnes les responsables de ces politiques très défavorables aux intérêts de nombre d’entre nous et si les recettes néolibérales étaient appliquées, ce n’était que de manière timorée et complexée. Jusqu’à présent.
« Réfractaires », les « Gaulois », comme le dit Emmanuel Macron avec condescendance ? Trop chouchoutés par un modèle social anachronique ? Godin rappelle que ce modèle social est une conquête de haute lutte. Si les « Gaulois·es » se sont soulevé·es en 1830, 1848 et 1871 (pour ne pas citer les défaites, comme celle de 1832 à laquelle l’auteur consacre un article passionnant), ce n’est pas en raison de leur caractère bagarreur sympathique mais parce que nulle part ailleurs en Europe le capitalisme industriel ne s’est déchaîné avec autant de violence qu’en France. Tout le long du XIXe siècle et jusqu’au Front populaire, les travailleurs et travailleuses en France ont été exploité·es plus durement que dans les pays voisins, l’Angleterre et l’Allemagne ayant toujours quelques décennies d’avance sur nous dans les réformes (temps de travail quotidien ou hebdomadaire, travail des enfants, protection sociale, etc.). La guerre sociale du XIXe siècle, après avoir couvé sous un compromis pendant quelques décennies, a peu à peu repris en intensité. Depuis 2016 et la loi travail, elle est plus frontale.
Le néolibéralisme a convaincu depuis les années 1970 une majorité d’économistes (« ce que Marx appelait les "économistes vulgaires", ceux qui se gardent bien de réfléchir aux sources du système économique »), ralliant même les néokeynésiens. Godin fait un bilan purement économique de la doctrine, à travers notamment une comparaison France-Allemagne (il connaît bien le modèle économique allemand et de ses nuances d’avec le néolibéralisme pur) : en période de croissance, les politiques néolibérales font gagner quelques points mais en cas de crise les pays plus protecteurs limitent la casse, sauvent leur société et, au passage, leur économie. La France a mieux tenu en 2008 que ses voisins, faisant à raison hésiter Nicolas Sarkozy à appliquer trop sauvagement un programme inspiré par la commission « pour la libération de la croissance » présidée par Jacques Attali et dont le rapporteur adjoint était déjà Emmanuel Macron. Il lui fallait être encore un peu patient.
Ce qui fait basculer les pays sous l’emprise néolibérale, c’est moins la volonté d’un peuple que sa trahison ou sa soumission. L’Allemagne est tombée suite à la trahison de sa social-démocratie, l’Europe du Sud et l’Amérique latine suite à une stratégie du choc pendant une crise économique. La France a cédé suite à une crise démocratique faite d’alternances vides et Godin met l’accent sur cette dimension politique. Convainquant quand il est question d’économie, il se montre aussi fin politiste, comme Bruno Amable et Stefano Palombarini, les auteurs de L’Illusion du bloc bourgeois (2) dont il est proche. Le système politique français, plus présidentiel qu’aucun autre (3), ne force pas au compromis. Et le scrutin majoritaire encourage les vainqueurs… ou supposés futurs vainqueurs par les médias, les autres votes étant inutiles par prophétie auto-réalisatrice. Une fois l’élection gagnée en deux temps (chaque élection législative se jouant avec les mêmes règles que la présidentielle), le président dispose de tous les pouvoirs. Macron, arrivé au pouvoir avec 8,6 millions de suffrages suite à une élection à un tour face à Marine Le Pen, a pu se payer le luxe d’abandonner la gauche de son électorat (acquis par des promesses d’accueil des migrant·es, de réformes sociétales, de présidence féministe, etc.). 5 millions, un « bloc bourgeois » de classes aisées, lui suffisent pour gouverner. Sur 47 millions d’inscrit·es.
Godin décrit l’arrogance de Macron non pas comme une erreur politique mais comme une arme de plus destinée à casser le peuple et les corps intermédiaires qu’il méprise. Trop longtemps la France l’a attendu pour adopter la seule politique possible à ses yeux, un thatchérisme avec trente-cinq ans de décalage : il frappe vite et fort, ne cède rien, humilie et quand cela ne suffit pas, il frappe, espérant gagner au final un combat culturel. Godin démontre le caractère autoritaire du néolibéralisme, dans la foulée de l’excellent livre de Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable (4) et de la publication récente par le même d’un texte de 1932 où Hermann Heller utilise cet oxymore de « libéralisme autoritaire ». Le néolibéralisme est par essence impopulaire, puisqu’il libère le capital de ses obligations envers la société, puisqu’il défend la liberté du capital aux dépens du bien-être d’une majorité de personnes. Il est par essence anti-démocratique, puisqu’il suppose une vérité scientifique (douteuse, on l’a vu) qui doit être imposée de gré ou de force aux malcomprenant·es qui composent le peuple et qu’il s’agit de rééduquer pour leur faire accepter la baisse de leurs rémunérations (directes, indirectes et socialisées par le service public) – ou à défaut de faire taire. C’est une vraie guerre sociale sous oripeaux démocratiques.
Ce « libéralisme autoritaire » franchit la frontière poreuse entre droite et extrême droite, en Hongrie, Pologne, Turquie mais aussi en France : assis sur le chantage à l’extrême droite lors des seuls scrutins qui comptent dans une France centralisée, Macron use et abuse des aspects les plus autoritaires et monarchiques de la Ve République (Parlement aux ordres et épidémie de 49.3 dont Godin note la survenue lors des plus dures réformes néolibérales), laisse la bride sur le col à des policiers accusés de violences racistes, réprime illégalement les manifestations… soit ce que l’on peut craindre de Le Pen. L’« extrême centre », qui tire sa légitimité du refus des « populismes » nationalistes ou de gauche et de sa défense de la « démocratie » libérale, s’avère la force politique la moins favorable à la démocratie (voir cette enquête sur les valeurs peu démocratiques des centristes) et la plus complaisante désormais envers la violence politique, des trolls LREM qui pratiquent la haine en ligne à un président refusant tout compromis et draguant un conservatisme rance (avec des ministres comme Darmanin, Dupont-Moretti, Blanquer pour les plus connus)… Mais une question taraude la lectrice que je suis : derrière cette intransigeance, quelle est la part du fanatisme idéologique et quelle est la part de la simple prédation organisées des ressources publiques (et naturelles) au profit des plus grandes entreprises du pays ? Car Godin ne documente ni la réalité sordide des nombreuses affaires du régime, ni la collusion systémique entre élite politiques et capital, seulement la partie du macronisme qui constitue une théorie exprimable.
Jour après jour dans Mediapart, Romaric Godin poursuit son analyse sans complaisance de la suite du mandat de Macron : le dépeçage en règle de l’hôpital qui se poursuit pendant que nous comptons nos mort·es, les réformes austéritaires qui continuent, comme la destruction des fondamentaux de la recherche publique, le choix constant, malgré l’insécurité alimentaire, de ne pas soutenir la demande (soit les besoins essentiels de celles et ceux qui ont été le plus touché·es économiquement par les mesures sanitaires) mais l’offre, soit d’arroser le capital en prétendant que ça ruisselle, avec un emprunt que nous rembourserons dans la douleur les vingt prochaines années et surtout le choix systématique pendant la pandémie de Covid de prioriser l’économie aux dépens de la santé. Une « stratégie perdante à coup sûr parce qu’elle conduit au pire des deux mondes : un désastre économique et un désastre sanitaire ». Conséquence des go-and-stop-and-go-and-stop-and-go (en attendant un troisième stop ?) qui détruisent toute confiance en l’avenir, « l’économie s’effondre au moment même où il est déjà trop tard pour sauver des vies. Autrement dit : en voulant ménager "l’économie", on provoque un choc négatif violent en même temps que l’on a déjà perdu la bataille contre le virus ».
Revenons à cet ouvrage d’une grande richesse, bien qu’accessible aux non-économistes, que Godin cherche à clore en explorant des pistes plus encourageantes. Les échéances électorales de 2022 pourraient-elles nous débarrasser d’un président mal élu et encore plus mal aimé ? Le Pen, bien qu’elle vote les lois du gouvernement, sert toujours de repoussoir et les forces de gauche ne s’entendent pas sur les alternatives économiques (encore moins sur les ambitions personnelles, ajouté-je). Rien à attendre. La rue ? Les Gilets jaunes ont beaucoup donné et subissent encore aujourd’hui une répression féroce, sans avoir réussi à arracher aucune inflexion. Pourtant le néolibéralisme est en cours de désaveu et du sein de la discipline économique surgissent d’autres manières de penser. Leur relais par les mouvements sociaux, espère Godin, pourrait nous sortir de l’impasse. Si un jour nous arrivions jusque là, il resterait encore à envisager cette question sur laquelle ce livre reste très discret : la crise écologique, qui est une autre guerre sociale.
(1) Lire à ce sujet Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière. Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde, Fayard, 2004.
(2) Bruno Amable et Stefano Palombarini, L’Illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français, Raisons d’agir, 2018 pour la réédition.
(3) La constitution chilienne lui faisait de l’ombre en matière de monarchie mais elle est sur le point d’être réécrite.
(4) Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, 2018.