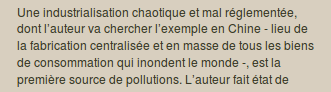A propos de L'Avion. Le Rêve, la puissance et le doute,
Alain Gras et Gérard Dubey (dir.), publications de la Sorbonne, 2009, 312
pages, 30 euros
Paru dans le n°15 de la Revue internationale des
livres et des idées, décembre 2009
Le lecteur qui connaît Alain Gras pour ses textes écrits dans un cadre
« décroissant » pourra être surpris à la découverte de L'Avion.
Le Rêve, la puissance et le doute. Cet ouvrage, qu'il dirige avec Gérard
Dubey, recueille les interventions d'un colloque tenu les 13 et 14 mars 2008 en
Sorbonne et consacré à l'aviation, civile et militaire. Il faudra ainsi
accepter de se plonger dans le monde des hub and spoke, glass
cockpits, SESAR et autres visions tête-haute, notions qui ne sont pas
expliquées au néophyte, pour avoir accès à ces travaux.
Le Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques
(CETCOPRA), dont Alain Gras est le directeur, a invité pour l'occasion un large
panel de contributeurs et de contributrices qui laissent le plus souvent de
côté les questions socio-environnementales pour se consacrer à des
interrogations plus abstraites sur la place de l'être humain dans les
« macro-systèmes techniques » (voir encadré), mais aussi au
témoignage issu de l'un ou l'autre secteur du monde aéronautique ou à des
exercices de prospective assez convenus. Les retours sur des pratiques
professionnelles (ou amateures) sont variés, aussi bien en ce qui concerne leur
angle de vue que leur qualité. Le contrôleur aérien Walter Eggert reprend
clairement les positions de son syndicat, peu enthousiaste sur
l'automatisation, quand Sébastien Perrot, philosophe et vice-président de la
fédération française d'ULM, prend un peu plus de hauteur pour décrire sa
pratique et l'usage qui y est fait du corps. Mais l'intervention de Jean
Frémond (Dassault aviation), à peine rédigée, est une suite de remarques
péremptoires qui ont surtout valeur documentaire. Et celle de Gilles
Bordes-Pagès (Air France) flirte avec l'insulte à l'attention des
« éco-intégristes » (coupables d'« intoxications
partisanes », « tsunami vert », on appréciera les métaphores) ou
regrette les parts de marché prises par les compagnies low-cost sans
bien nous dire au nom de quoi, si ce n'est des intérêts de son employeur, dont
par ailleurs il détaille honnêtement la stratégie de développement :
rester en mesure d'accompagner la croissance attendue de la demande.
A ces contributions brut de décoffrage, on préférera souvent celles qui sont
issues des sciences humaines... et le plus souvent des chercheurs du CETCOPRA.
Le colloque, aussi bien que le livre, se décline en trois temps – le rêve, la
puissance et le doute – et le troisième semble avoir suscité de nombreuses
interrogations. Mais le doute est bel est bien là dès les deux premiers temps,
et le premier chapitre rend déjà compte d'une « liberté contrariée ».
Ainsi le philosophe Xavier Guchet consacre-t-il la première intervention à la
biométrie dans les aéroports, interrogeant ce dispositif et doutant de la
capacité de « faire monde » devant la généralisation de ces machines
et des processus automatisés, déshumanisés, qu'elles induisent pour les
voyageurs comme pour les douaniers. Il fait appel à Hanna Arendt et à sa
description d'un monde délabré par de tels usages, ainsi qu'à un George Orwell
qu'il cite avec précision, au-delà de l'emblématique Big Brother, pour
sa description d'une histoire qui a fait place au processus. Gilbert Simondon
est aussi mis à contribution pour le dialogue qu'il promeut avec les machines
(1). Arendt et Simondon, deux références qui reviendront dans les contributions
suivantes, la seconde étant – de l'aveu même d'Alain Gras (2) – peu critique.
On regrette donc l'absence ici d'autres penseurs de la technique. Ivan Illich
par exemple, dont le concept simplissime de contre-productivité de la
technique, qu'il a utilisé et fait connaître, semble ignoré d'un bout à
l'autre. Pourtant, la contre-productivité explique à merveille certains
phénomènes dont parlent les intervenants : « C'est comme si tout le
progrès technique était immédiatement consommé par quelque phénomène insidieux
et pervers » (François Fabre). Passé un certain seuil, chaque étape d'un
progrès technique voit les améliorations qu'elle a recherchées accompagnées
d'autant d'effets indésirables, sans qu'on arrive à refuser les seconds pour
n'avoir que les premiers. Une contre-productivité qui vaut pour les structures
techniques au sens large, c'est à dire aussi pour tous ces règlements dont
l'abondance et la complexité mêmes pourraient faire obstacle à un surcroît de
sécurité, qu'« un excès de lois incite au
contournement » (Victor Scardigli) ou qu'il bride par des cadres trop
stricts les capacités de réponse des êtres humains (pilotes et
contrôleurs).
Bien qu'au tout début du colloque la disparition définitive de l'être humain
dans l'avion soit tempérée par l'ancienneté de cette prophétie, qui devait déjà
se réaliser dans les années 1980, c'est un horizon qui reste prégnant. Les
drones volent et tuent dans le ciel afghan sans présence humaine à bord, mais
ils restent pilotés depuis les États-Unis par des hommes, et tous les
intervenants nous rappellent les capacités de réaction exceptionnelles des
acteurs humains et leur efficacité encore impossible à dépasser en matière de
sécurité, face aux éléments ou au hasard aussi bien que face aux surprises que
peuvent leur réserver les robots, programmés par des concepteurs eux aussi
humains. Les chercheurs du CETCOPRA ont produit au fil des ans une
bibliographie impressionnante, rappelée au début du livre, travaillant sur un
monde aéronautique gagné par l'automatisation, mais où s'exprime encore – avec
profit – le corps des pilotes (Caroline Moricot) ou les capacités cognitives
des contrôleurs (Sophie Poirot-Delpech). Il est néanmoins utile que s'expriment
aussi des points de vue plus éloignés de la culture de ce laboratoire. On
imagine le dialogue qui a pu avoir lieu entre le philosophe Frédéric Gros
(Paris 12) et le sociologue Gérard Dubey (CETCOPRA) : le premier met
l'accent sur le caractère asymétrique de la guerre moderne, le pilote de drone
étant à l'abri dans son pays pendant qu'il distribue la mort, tandis que le
second tente de nous faire sentir tout le désarroi du même, sommé par la
« quasi-instantanéité des images » de voir les effets de ses actes et
affecté de si douloureux « états dépressifs »...
C'est la troisième partie, « L'avion dans un monde incertain »,
qui aborde les thèmes les plus variés et les plus proches des interrogations de
ce qu'on appelle la société civile, écologistes ou usagers de l'aviation. Mais
avec des biais que nous prenons la peine de noter ici : les questions
issues du monde écologiste restent hélas traitées d'une manière un peu
réductrice, et les usagers sont envisagés dans le seul cas de l'accident
mortel, événement spectaculaire mais dont tous les intervenants rappellent la
rareté, comparée ou non avec d'autres moyens de transport.
Philippe Mahaud analyse les partis pris de la presse écrite européenne dans
le cas de trois accidents mortels et de leurs suites judiciaires, et l'accent
qu'elle met sur la structure ou sur l'erreur humaine selon son ancrage à gauche
ou à droite n'est pas qu'anecdotique. Il essaie d'en dégager les grands axes de
la compréhension par le public des questions de sécurité aérienne. Les
sociologues Nicolas Dodier et Janine Barbot font état de leurs travaux sur la
structuration des associations de victimes, ici les familles d'enfants
contaminés par des hormones de croissance, et du statut dont elles bénéficient.
Leur présence dans ce colloque peut étonner, car lors de la même table ronde
Philippe Mahaud et Jean Paries (tous deux consultants) stigmatisent
l'intolérance nouvelle au risque, se faisant les avocats d'une limitation des
procès au pénal aux cas extraordinaires de malveillance et de sabotage.
L'affaire des hormones de croissance semble être la conséquence d'exigences
sanitaires étonnamment faibles et qui ont attendu des années pour être remises
en cause, elle ne rentre décidément pas dans le cadre de ces défaillances
humaines – et qui ne font pas système – où se joue en quelques secondes le
destin d'une centaine de familles. On a du mal à imaginer qu'avec ce contexte
très différent, auquel il faut ajouter le caractère collectif de chaque
catastrophe aérienne, les victimes de crash s'organisent d'une manière
comparable à celles de l'hormone de croissance... Et la présidente de séance
Françoise Deygout (direction générale de l'aviation civile, DGAC) ne prend pas
la peine d'expliquer les liens entre ces deux expériences, à savoir un
arbitrage difficile entre le refus du risque et les aléas de l'industrie.
La réponse de Jean Paries à la demande sociale en cas de crash consiste dans le
souhait que les suites judiciaires n'aillent que rarement au-delà de l'enquête
technique... mais que les victimes soient associées à son déroulement. Les
conclusions de ce type d'enquête sont selon lui assez précises et justes pour
permettre au public de comprendre ce qui s'est passé, et aux professionnels de
réformer le système en cas de défaut. Paries s'appuie d'autre part sur une
étude du MIT (3), qui fait état d'une corrélation négative entre le nombre des
incidents et celui des accidents mortels dans la même compagnie d'aviation,
pour démontrer la capacité de réforme spontanée du personnel aéronautique et
l'efficacité de l'appui sur sa culture de sécurité. Culture dont il faut
permettre l'expression et qui serait perdue par des règles de sécurité
hétéronomes trop rigoureusement appliquées, qui deviendraient ainsi
contre-productives.
Si la demande sociale était au cœur de l'avant-dernière table ronde, celle
qui suit et clôt le colloque penche plutôt du côté de la gestion technicienne
de l'environnement. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de
l'aviation civile (et ses factures d'énergie, devenues depuis 2006 son poste de
frais le plus important, suite au renchérissement constant du pétrole sur le
marché mondial) ? Sa part dans les émissions globales est estimée à 2,5 ou
3 % selon les intervenants, mais l'effet de « forçage radiatif » de
son émission à haute altitude, nous signale Alain Morcheoine (ADEME)
multiplierait cet impact d'une valeur de 2 à 4 selon le GIEC. Et le chiffre est
livré brut, jamais rapporté au nombre de voyageurs ou de kilomètres. Gilles
Bordes-Pagès (Air France) avait beau jeu dans une table ronde précédente de le
comparer avec celui du transport routier, plus quotidien et qui concerne bien
plus de passagers et de marchandises.
Yves Cochet, ancien ministre Vert de l'Environnement, insiste sur
l'impossibilité à imaginer que « demain n'est plus la continuation
d'aujourd'hui ». Il note la myopie de ce système et son propos se voit
illustré par Philippe Ayoun (DGAC), pour qui le « très long terme »
en matière d'effet de serre se situe à 2050, soit une date à laquelle les
enfants d'aujourd'hui ne seront pas encore grands-parents. Seulement, au-delà
du tableau toujours concis et efficace que Cochet est habitué à présenter –
celui de la finitude des ressources pétrolières (pic de Hubbert) et du prix
toujours plus élevé du pétrole qui ici mettra à mal aussi bien la capacité des
compagnies à offrir des billets à un prix correct que celle de consommateurs
touchés par les crises économiques à les leur acheter – quelle réflexion sur
l'organisation et les imaginaires sociaux qui pourraient se substituer à ce
monde où la croissance du PIB et celle du trafic aérien sont si étroitement
corrélées ? Un report modal – c'est à dire l'usage d'un moyen de transport
différent pour un trafic et des exigences de mobilité inchangés – ne suffira
pas...
Les compagnies ont réussi à restreindre de 60 % leur consommation
énergétique par voyageur par kilomètre entre 1960 et 2000, et elles comptent
continuer leurs efforts en optimisant leurs activités : taux de
remplissage plus forts, plans de vol rationalisés, décollages à poussée
réduite, chasse aux kilos en trop sur les avions, achat de modèles plus
économes (mais quid de leur coût environnemental à la
construction ?), etc. Si les résultats sont impressionnants, ils restent
décevants face à la croissance constante de l'usage de l'avion. Gilbert Rovetto
(Air France) mentionne un outil de réduction des émissions bien moins
anecdotique, l'abandon des dessertes régionales en concurrence avec le TGV.
Celle entre Paris et Lyon sera sous peu quasiment délaissée, plus d'un quart de
siècle après la mise en service du TGV entre ces deux villes ! Une
réaction qui s'est fait attendre, mais qui semble faire partie d'une nouvelle
stratégie commerciale misant tout sur le « hub » (plateforme
aéroportuaire) de Roissy et imaginant un report modal vers le TGV pour
l'alimenter depuis les grandes villes de France. Ce qui permettrait d'alléger
ce hub francilien au profit des vols internationaux. Morcheoine suggère même,
sous forme de boutade mais cela a bel et bien été envisagé, qu'Air France
devienne opérateur ferroviaire ! Une note divergente, celle de la DGAC qui
à travers l'intervention de Philippe Ayoun présente comme nécessaire la
redynamisation des aéroports régionaux.
La déclaration d'utilité publique du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes
près de Nantes – l'actuel devant être saturé dans une dizaine d'années –
sera-t-elle remise en cause, puisqu'Air France avoue ne pas vouloir
l'investir ? Les opposants à ce nouveau projet d'infrastructure de
transport, auxquels il n'est pas fait allusion ici, aimeraient sans doute voir
ce regrettable malentendu éclairci...
Même divergence de vues sur la question des agrocarburants. Alors que
Rovetto se gausse de la noix de coco de Richard Branson (Virgin Airlines) en
expliquant qu'il en faudrait 3 milliards par jour pour alimenter Heathrow, et
que Raphaël Larrère (INRA) rappelle en passant les limites – sociales et
environnementales – évidentes des carburants « verts », Ayoun en fait
l'un des outils nécessaires de la réduction des émissions. Ce dernier étant
absent le jour du colloque, la discussion n'a pas pu avoir lieu. Mais on
imagine que d'autres sujets ont été soumis à une discussion acharnée qui n'est
pas retranscrite ici. Limite regrettable de l'édition des actes d'un
colloque...
Dans cet univers intellectuel, aujourd'hui fait référence et demain ne peut
en être que l'extrapolation mathématique (suivant la croissance du PIB). Alain
Gras rappelle bien en conclusion la difficulté de l'exercice prospectif. La
remise en cause du caractère inexorable des besoins de mobilité ne vient
paradoxalement pas de Cochet mais de Bordes-Pagès et d'Ayoun – sont-ils
conscients de ce que leur propos implique ? Le premier oppose
« transport utile » et « transport futile » et le second
rappelle que « la multiplication des possibilités de voyages, permise
notamment par les compagnies à bas coût, crée des comportements
opportunistes : on voyage là où c'est possible au moindre
coût ». L'offre ne serait donc pas simple ajustement aux besoins
exprimés de la société, mais elle serait aussi un facteur d'évolution de ces
besoins ? Même si le propos de l'auteur, qui cite l'autorité de l'aviation
civile britannique, s'applique aux destinations offertes plus qu'à leur
éloignement, il y a là matière à réflexion sur la possible interrogation
collective de ces besoins de mobilité dans le cadre d'une réelle
« démocratisation » des transports aériens...
Et c'est le même Ayoun – dont la présence aurait décidément été précieuse –
qui pose les questions qui fâchent le plus. « La légitimité de
certains déplacements aériens est posée : faut-il consommer des aliments
hors saison importés d'autres hémisphères ? Le tourisme lointain ne se
fait-il pas au détriment de nos propres ressources touristiques ? L'afflux
de voyageurs en low cost dans nos régions ne provoque-t-il pas des
excès dans les prix immobiliers ? Ne serait-il pas justifié en cas de pic
de pollution de restreindre l'avion au profit du TGV pour un déplacement entre
Paris et les régions, comme cela a pu être envisagé dans les conclusions de
l'enquête publique du plan de protection de l'atmosphère de
l'Île-de-France ? » Soit des questions non pas sur le
comment, mais sur le pourquoi de la généralisation du recours
à l'avion. Certes l'auteur ne les prend pas à son compte, et même les réfute
d'un revers de main... plutôt gêné : « il est, en apparence,
assez aisé de réfuter la plupart de ces contestations ». En
apparence.
Ajoutons donc aux questions pas ou mal abordées dans cette table ronde celle
d'un report modal non plus sur le seul TGV, gros consommateur d'énergie comme
c'est parfois noté, mais par exemple sur le train de nuit, qui permet de se
coucher à Paris pour se réveiller à Toulouse, Prague ou Venise et y passer le
week-end rigoureusement indispensable à une vie épanouie. Une magie
low-tech qui semble ne plus être à l'agenda d'aucun acteur du
développement durable : les prix paraissent aujourd'hui moins attractifs
que l'avion, certaines dessertes Lunéa ont d'ors et déjà disparu4. Un
imaginaire hypermobile s'est répandu de longue date dans les classes moyennes
occidentales, que ce soit au détriment de la vie quotidienne des classes
populaires ou des économies des pays du Sud en tirant vers le haut les prix de
la ressource pétrolière dont elles aussi ont besoin. La sortie de cet
imaginaire, notion chère à Alain Gras, pourrait ouvrir sur d'autres réflexions
un colloque et un livre où l'on est un peu à l'étroit.
(1) Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques
(1958).
(2) France Culture, « Terre à terre » de Ruth Stegassy, 9 février
2008.
(3) Wang (1998), Airline Safety: The Recent Record, NEXTOR Research
Report RR-98-7, Cambridge, MIT.