Remplacer l'humain
Par Aude le mardi, 19 septembre, 2017, 17h42 - Lectures - Lien permanent
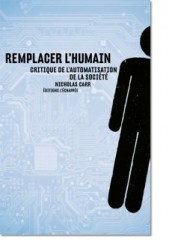 Nicholas Carr, Remplacer l'humain.
Critique de l'automatisation de la société, traduit de l'anglais
(États-Unis) par Édouard Jacquemoud, 272 pages, 19 euros, L'Échappée,
2017
Nicholas Carr, Remplacer l'humain.
Critique de l'automatisation de la société, traduit de l'anglais
(États-Unis) par Édouard Jacquemoud, 272 pages, 19 euros, L'Échappée,
2017
Résister à l’automatisation, voilà une entreprise qui semble insensée. Ce serait résister à la logique selon laquelle les investissements dans les machines sont très vite plus rentables que le recours à du travail humain (et que l’argent décide de la marche du monde). Ce serait résister également à notre goût pour l’économie de moyens, une tendance presque naturelle à s’éviter de la peine. Il est toujours possible de s’en désoler à longueur de pages, de la documenter de manière intéressante mais à quoi bon ? Nicholas Carr réussit pourtant à livrer avec Remplacer l’humain un livre passionnant.
Carr remonte loin dans l’histoire de l’automatisation : en faisant le détour par le métier à tisser honni par les luddites ou par Frederick Taylor, il rappelle à quel point l’automatisation est une arme de guerre contre les travailleurs dans la longue lutte entre capital et travail. Les machines ne font pas grève, répètent à l’envi les patrons. Il documente également un fait moins connu, l’automatisation des professions intellectuelles les plus prestigieuses : médecin, architecte ou expert-comptable. Le passage, largement promu par l’industrie informatique, au dossier de santé électronique aux États-Unis appauvrit le contenu de celui-ci. Dès lors que les médecins remplissent des formulaires, la tentation est grande de copier-coller les entrées, d’utiliser des formules stéréotypées plutôt que de prendre le temps de trouver la bonne formulation. En conséquence de quoi les dossiers ne sont plus lus : le contenu a perdu beaucoup d’intérêt et il n’est plus possible de le survoler entièrement, d’apprécier l’épaisseur du dossier papier ou d’y constater d’un coup d’œil la proportion d’écritures manuscrites différentes. Tout au plus les médecins prennent-ils la peine de lire les dernières entrées. Les suggestions du logiciel n’ont d’autre pertinence que statistique (l’occurrence d’une condition au vu d’un symptôme) et les alertes, utiles mais trop systématiques, sont perçues comme des parasites que les usager·es s’empressent de faire disparaître. L’intelligence du métier n’est plus requise et elle dépérit, affirment des professionnel·les.
L’affaire est rentable à court terme puisque les automatismes de pensée, de diagnostic ou de conception, font gagner du temps mais c’est dans ce temps-là que se fait l’essentiel de la réflexion. Et les générations de professionnels qui n’ont pas le loisir d’effectuer l’apprentissage du métier « à la main » sont certes diplômés mais ne pourront jamais acquérir une expérience digne de ce nom. Quand les jeunes Inuits naviguent sur GPS, ils n’apprennent pas à se saisir d’un paysage, à deviner une faille sous une couverture de neige, ils se privent d’autres informations, plus fines, que celles que la navigation par satellite peut leur apporter – tant que leur smartphone ne gèle pas ou n’est pas à court de batterie. Même perte de résilience en cas d’avarie dans le cas des pilotes de ligne, responsables d’accidents récents au cours desquels un simple défaut d’information les fait réagir de manière inappropriée. Aujourd’hui, nous apprend Carr, un pilote peut se targuer de milliers d’heures de vol mais exercer ses talents moins de trois minutes par vol et être pris au dépourvu par la moindre inconnue, au point de crasher un avion.
Ivan Illich, penseur critique du développement, parlait à ce sujet de contre-productivité : la technique n’est plus outil multiplicateur des efforts humains mais cadre contraignant qui réduit à néant ses talents. Carr donne des exemples intéressants de réactions qui prônent un moindre recours à la technique. Les autorités de l’aviation civile demandent la désactivation du pilote automatique aussi souvent que possible, des architectes reprennent l’habitude de dessiner leurs premières esquisses sur carnet au lieu de s’engager trop vite dans une conception assistée par ordinateur. Certaines innovations techniques sont conçues pour nécessiter la collaboration de l’humain et non plus son remplacement, qui (même au critère le plus pauvre et sordide d’efficacité) serait une perte. Compléter l’humain plutôt que le remplacer. C’est toujours ça de pris, devant la catastrophe écologique que constitue l’automatisation et qui est l’un des angles morts du livre.
L’apport le plus intéressant de Carr me semble être celui-ci : rappelez-vous, le goût du moindre effort qui justifie l’adoption de l’automatisation y compris en l’absence de contrainte économique (et y compris quand le coût est élevé : ok, Google, allume la lumière)… Carr suggère que c’est une supercherie, que nous croyons être plus heureux et heureuses à ne rien faire mais qu’exercer nos talents est un plus grand plaisir. Il cite une enquête (1) qui a recueilli les appréciations générales sur leur travail et leurs loisirs de personnes dans des emplois divers et leur a demandé de noter la qualité de leur expérience à tous moments de la vie… Au contraire de leurs déclarations générales, elles étaient globalement plus heureuses au travail. Il faut dire que si aller pousser un chariot le samedi après-midi peut être qualifié de loisir, la démonstration perd un peu de sa force mais, de fait, les loisirs les plus agréables impliquent des efforts parfois considérables : courir, voyager, créer, coopérer. Faire un effort n’est pas une pente naturelle mais nous fait nous sentir plus vivant·es. Pour pouvoir produire une critique digne de ce nom de l’automatisation, nous devons prendre acte de ce fait, ne pas nous contenter d’une condamnation paresseuse d’un capitalisme qui ne cesse de nous proposer des services que nous acceptons de si bonne grâce (ok, Google, éteins la lumière). Réclamer un revenu pour surnuméraires écarté·es des processus de production, sans plus rien espérer changer aux conditions concrètes de travail, c’est se résigner à ce que cette vie inhumaine devienne la nôtre.
(1) Mihály Csíkszentmihályi et Judith LeFevre, « Optimal experience in work and leisure », Journal of Personality and Social Psychology, 1989, vol. 56, n°5.