Refuser de parvenir
Par Aude le mardi, 5 avril, 2016, 16h52 - Lectures - Lien permanent
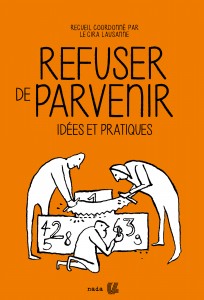 Refuser de
parvenir. Idées et pratiques, Centre international de recherches sur
l'anarchisme (CIRA) de Lausanne, Nada et CIRA, Paris et Lausanne, 2016, 300
pages, 20 euros
Refuser de
parvenir. Idées et pratiques, Centre international de recherches sur
l'anarchisme (CIRA) de Lausanne, Nada et CIRA, Paris et Lausanne, 2016, 300
pages, 20 euros
Voici un bouquin qui devrait faire écho chez les militant-e-s qui se sont posé
la question de l'articulation entre leurs engagements et leur vie
professionnelle. Peut-être pas les cadres supérieurs qui trouvent quelques
heures par mois pour leurs loisirs associatifs et font exactement les mêmes
carrières que leurs collègues qui votent PS. Plutôt à ceux et celles qui se
sont posé la question de comment être utiles et ont fait des choix de vie en
fonction. Le livre commence fièrement avec le rappel de l’œuvre d'Albert
Thierry, brillant étudiant choisissant le métier de maître d'école alors que
des fonctions d'enseignement plus prestigieuses lui sont ouvertes. C'est lui
qui théorise le « refus de parvenir » qui fait l'objet de ce recueil.
Principaux objectifs : ne pas trahir sa classe et travailler à une
émancipation qui ne soit pas individuelle mais collective. Le refus de parvenir
n'est pas le choix solitaire d'une belle âme mais une stratégie politique
visant une amélioration des conditions de travail et de vie de toute une classe
sociale. L'égalité des chances (de parvenir) ne les intéresse pas, ils et elles
visent une égalité des conditions.
Les exemples plus contemporains montrent des choix moins offensifs, des artistes ou des intellectuels (chercheuses féministes, architectes) à la recherche de modes de vie qui ne reproduisent ni les dominations ni la lutte des places dans des univers compétitifs qui élèvent les plus brillants (ou les plus capables de passer pour tels) pour mieux exploiter les autres. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, comment fait-on pour créer des collectifs qui refusent la machine à broyer les personnes ? Il est question de travail dont le crédit reste au collectif, d'efforts et de pensée collectives qui ne peuvent être appropriés pour servir de marchepied à l'un ou à l'autre de ses membres. Les exemples en question sont plus diserts sur la question de la subsistance : à chacun-e d'assurer son revenu à côté ou est-il possible de poser de manière également collective la question économique ? gratuité ou création d'une économie autour de l'œuvre collective ? Au vu de ces exemples contemporains, il semble que la lutte des classes ait vécu et qu'il s'agisse plus aujourd’hui pour des « classes moyennes » de ne pas nuire en ne parvenant pas. La sociologie des mouvements anarchistes et de gauche a changé, les ouvriers sont moins présents dans les rangs, laissant la place à une petite bourgeoisie intellectuelle (enseignants, etc.) qui peine à accueillir les membres de classes populaires, comme nous le rappellent deux interventions suédoises.
Que s'est-il passé ? Dans ce qui m'apparaît comme le texte le plus éclairant de ce riche recueil, parce qu'il aide à saisir ce qui différencie l'âge d'or des luttes ouvrières et l'héritage des Trente Glorieuses, Anne Steiner revient sur la démocratisation puis la massification de l'enseignement supérieur. Le système scolaire discriminant les classes populaires, il n'offrait aucune, ou si peu, possibilité de parvenir. En se démocratisant, l'école inaugure un « ascenseur social » qui propose d'élever quelques éléments des classes dominées pour résoudre à moindres frais la question de l'exploitation, n'en faisant plus que le sort mérité de qui n'a pas pu se hisser dans les classes dominantes grâce à son talent et à ses efforts. « L'école démocratique, en privatisant les biographies, en faisant de chacun le responsable de sa destiné, a affaibli la perception des rapports de classe. » Après cette démocratisation (qui produit une « classe moyenne » difficilement identifiable mais dotée d'une force certaine d'inertie politique), l'accès à l'université va jusqu'à se massifier. Comme le besoin d'emplois d'encadrement ne justifie plus une telle production de diplômé-e-s, nous sommes revenu-e-s au point de départ et « d'autres critères [que le diplôme] rentrent en compte [pour la lutte des places] comme le capital social (les relations), les compétences linguistiques, l'apparence physique. » Les déclassé-e-s que l'université met sur le marché ont un diplôme dévalué ou bien ils et elles se savaient déjà inemployables par la machine productive et ont investi des disciplines qui ne donnent pas accès à des emplois bien rémunérés (arts, lettres, etc.). Ces derniers pourront-ils se rendre utiles dans d'autres champs ? Quitte à ce que l'université ne joue plus son rôle de sélection dans des sociétés inégalitaires, Steiner remet en cause le « monopole radical » (1) qu'elle exerce et en appelle à une redéfinition de son rôle social, soit que l'institution devienne moins inutile, soit que les savoirs se partagent dans d'autres structures moins rigides.
Aujourd'hui, si dans les milieux radicaux on constate une grande disponibilité, acquise aux dépens du travail productif, c'est surtout le fait de personnes jeunes. Passé quarante ans, il semble qu'assurer individuellement sa subsistance et avoir quelque chose qui ressemble vaguement à une carrière soit un préalable, même pour des militant-e-s, à une vie épanouie (ah merde, on ne t'avait pas dit ?) et que le collectif n'ait plus grand-chose à faire miroiter. Une vie d'engagement paraît avoir plus de chances de se réaliser dans une carrière de salarié-e associatif encadrant des bénévoles (comme les permanents syndicaux leurs ouailles), un mode d'organisation que les membres du CIRA récusent. Tout comme ces carrières militantes individuelles qui n'ont plus l'air de choquer grand monde. Les milieux anarchistes font mieux que ceux que je critique sur ce blog et où les initiatives collectives renvoient chacun-e à des responsabilités personnelles (croûter, « travailler sur soi »). Mais à quel point « mieux » est-il seulement décent et prometteur ? Si cet ouvrage pose la question de nos carrières sans complaisance ni injonction moralisatrice, il reste à s'en saisir pour y répondre avec plus d'exigence que ce que je ne peux m'empêcher de constater autour de moi.
(1) Voir Ivan Illich, l'auteur d'Une société sans école.